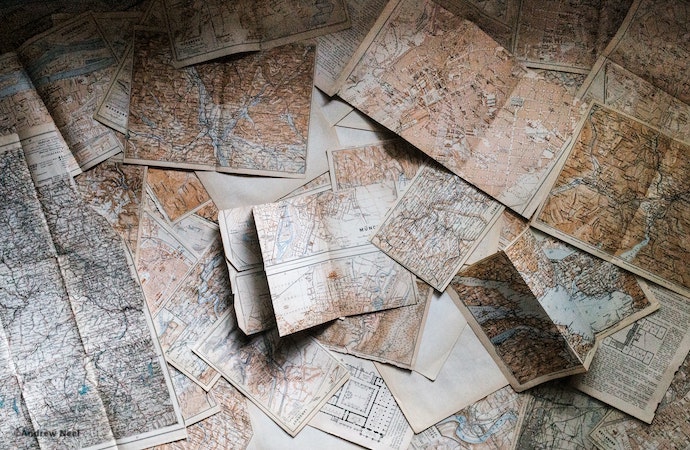Serge Cottet, grand lecteur de Freud, soulignait que les « concepts n’ont pas à être fétichisés, ils sont conventionnels et provisoires, et sont destinés à surmonter une contradiction, un paradoxe, une aberration rencontrés dans la clinique » [1].
En évoquant à des praticiens le cas de Freud au titre éloquent « Un cas de paranoïa en contradiction avec la théorie », S. Cottet rappelait qu’il y a « une voie méthodologique fructueuse. Au lieu de dire : mon patient est joycien, et d’attraper tous les symptômes qui en font un joycien ou un président Schreber, il va s’agir au contraire, de montrer en quoi une invention symptomatique résiste au syntagme auquel on est invité à le comparer, au syntagme qui s’impose dans la doctrine » [2].
Ce cas nous montre comment Freud se laissait enseigner par le cas. Il met en tension, voire même nettement en contradiction, un paradigme connu, la paranoïa, et un cas de paranoïa féminine. Il prend appui sur le témoignage du sujet pour vérifier les bases posées d’une conceptualisation de la paranoïa et cela, au plus près de l’expérience. Et comme le premier entretien est insuffisant, il en imposera un autre, toujours au plus près des dires du sujet. Cela implique un certain respect du discours, jusqu’au point où un certain nombre de limites sont quand même à poser.
Le cas est celui d’une jeune femme qu’un avocat, embarrassé par « le caractère morbide » de la plainte de sa cliente, conduit chez Freud. Celle-ci raconte à Freud qu’elle s’est laissée courtiser par un collègue de travail et, lors de leurs premiers ébats amoureux, il l’aurait fait photographier par un complice. Elle est persuadée d’avoir entendu le « clic » de l’appareil et il chercherait maintenant à l’éconduire par cette photo compromettante. Le sujet se sent visé personnellement par un phénomène et en tire une signification, une interprétation délirante. Le regard de l’Autre, associé au bruit, joue un rôle central et la figure de l’Autre jouisseur s’impose. Cette jeune femme se trouve confrontée à un impossible, l’amour pour cet homme, que traite le délire. Pour Freud, il s’agit bien d’un délire de persécution. Mais ce cas va à l’encontre de sa conception de la paranoïa selon laquelle le persécuteur, qui dans un premier temps fut aimé, est toujours du même sexe que le sujet. Là, le persécuteur est un homme. C’est son compagnon qui devient le persécuteur. Pour Freud, ce n’est absolument pas normal ! Confronté à cette butée, il lui faut poursuivre l’investigation.
Il provoque un second entretien pour se laisser mieux « instruire » par la patiente et « obtient de nouvelles informations » : elle a la certitude que son amant a dévoilé leur aventure amoureuse à leur supérieure hiérarchique ; ou pire, qu’il entretient une relation amoureuse avec cette vielle dame qui serait finalement l’agent du complot. Sa supérieure représenterait une figure maternelle et l’amant, en dépit de son jeune âge, une figure paternelle. Freud constate que même si la jeune femme est attirée par le substitut paternel, elle n’en reste pas moins sous la domination de son attachement à sa mère, figurée ici par sa supérieure, pour laquelle elle éprouverait des pulsions homosexuelles. Ce qui confirme sa thèse majeure : le sujet et son persécuteur sont de même sexe et le déclenchement de la paranoïa opère comme la mise en place d’une défense contre une homosexualité excessivement forte. Cependant, Freud est sensible à la singularité du sujet, à cette particularité qui rend difficile la construction du cas ainsi que l’extraction du mode de jouissance : « La clé du mystère est donnée par l’histoire du développement de ce délire. Celui-ci était à l’origine dirigé, comme nous pouvions nous y attendre, contre la femme, mais maintenant, sur le terrain de la paranoïa, était accompli le passage de la femme à l’homme comme objet. Un tel passage n’est pas habituel, dans le cas de la paranoïa » [3].
Freud n’oublie pas ce qu’il a appris, mais il ne cherche pas à placer ce qu’il sait a priori sur ce qu’il découvre : « je me rappelais combien il était fréquent qu’on soit amené à juger faussement les malades mentaux faute […] de s’être mieux laissé instruire par eux » [4].
La mise en tension des habitudes cliniques incarnées dans un paradigme a permis de souligner l’invention, l’inventivité du symptôme.
On peut appliquer cette voie méthodologique à l’ensemble de la clinique de notre modernité : « La tension est interne à la clinique, entre le concept et le cas. Et deux voies s’ouvrent alors : ou bien fourrer le cas dans un concept, à titre de cas particulier ; ou bien hausser le cas au paradigme, comme singularité. Ces deux voies ne s’excluent pas, mais la seconde est plus intéressante que la première, plus lacanienne. » [5]
[*] Freud S., « Communication d’un cas de paranoïa en contradiction avec la théorie psychanalytique », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1981.
[1] Cottet S., « Un bien dire épistémologique », La Cause du désir, n°80, février 2012, p. 17, disponible sur le site de Cairn.
[2] Cottet S., « Élever le cas à la dignité du paradigme », Ironik, 19 décembre 2017, publication en ligne.
[3] Freud S., « Communication d’un cas de paranoïa… », op. cit., p. 217.
[4] Ibid., p. 212.
[5] Miller J.-A., « En ligne avec Jacques-Alain Miller », entretien, La Cause du désir, n°80, op. cit., p. 9, disponible sur le site de Cairn.