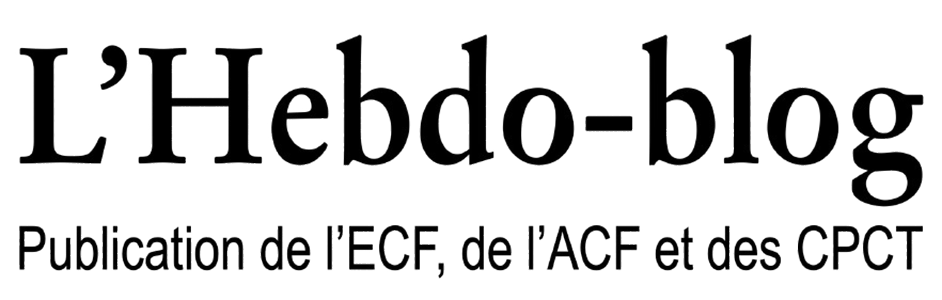Le chef d’état-major des armées expose sa vision stratégique depuis sa prise de fonction en 2021 : que les armées soient « prêtes en permanence à faire face à un conflit majeur […] pour “gagner la guerre avant la guerre” ». La guerre en Ukraine a donc accéléré ce processus de préparation. Des exercices de grande ampleur engagent des milliers de soldats français, dans la perspective d’un conflit de haute intensité en Europe ou sur le territoire national.
Mais les soldats, aussi entraînés et volontaires soient-ils, peuvent-ils être jamais prêts à cette rencontre avec la guerre ?
Comme l’écrit Guy Briole : « C’est toujours un autre fraternel que l’on tue dans une guerre, toute guerre est fratricide.1 » Et la logique d’une altérité radicale s’impose alors. Les militaires que nous recevons, revenus de théâtres d’opérations, témoignent d’une certaine étrangeté au monde qui les entoure, à eux-mêmes. Le sujet n’est plus tout à fait comme avant, touché dans son histoire singulière. « Tout ça n’a plus aucun sens » : le quotidien, les liens familiaux, le sens même de la vie est remis en question. Un temps long, est nécessaire pour tenter de s’extraire de cette solitude, écho d’une expérience extra-ordinaire et non partageable.
La blessure provoquée par les combats, la terreur, les corps en morceaux, la mort d’un camarade, ne cicatrise jamais tout à fait. Comment alors trouver de nouveaux nouages, aux autres, à ses proches, à sa famille ?
Certains s’adressent à nous pour ces symptômes que la psychiatrie range sous le nom de « trouble de stress post-traumatique ». L’institution militaire communique tellement sur ces « blessures psychiques » que les patients se présentent à nous avec un savoir déjà-là : « je suis un blessé psychique », « j’ai un SPT2 ». L’enjeu sera alors d’intéresser le sujet, davantage à ce qui lui est propre, à sa particularité subjective voilée par le fait traumatique.
Et l’horreur rencontrée peut resurgir après des mois, voire des années d’apparente tranquillité. Comme pour cette patiente qui s’aperçoit dans une fulgurance qu’elle n’a sauvé personne, là-bas, mais qu’elle a sans doute tué beaucoup d’hommes. Et le pire dit-elle, c’est qu’elle a aimé ça. Cette expérience vécue a provoqué une irruption de jouissance jusque-là ignorée et qui lui fait aujourd’hui horreur. Le réel rencontré a pulvérisé un nouage qui tenait.
Le hasard de la mauvaise rencontre, qui aurait pu ne pas se produire, peut revêtir un caractère désastreux pour le sujet. L’évènement dit traumatique contient une part de réel qui relève de la contingence, de l’accident, et une part de concernement intime qui implique définitivement le sujet.3
Le temps opérationnel est un temps préparé, rétro évalué, anticipé, qui mobilise toutes les attentions. Et même si cette préparation est indiscutablement indispensable, elle s’avère toutefois insuffisante à traiter ce qui pourra se jouer pour le sujet qui se trouvera impliqué dans un conflit armé : un choix éthique face à l’effroyable de l’acte.
Il revient au psychanalyste de faire face, en acte ; et de l’éthique de sa réponse à l’urgence à laquelle il sera convoqué, dépendra le devenir du sujet qui s’adressera à lui.
Vanessa Wroblewski-Berlie
[1] Briole G., « Dans les mâchoires de la guerre : arrachement », in Brousse M.-H. (s./dir), La psychanalyse à l’épreuve de la guerre, Paris, Berg International, 2015, p. 76.
[2] SPT est l’acronyme du stress post-traumatique.
[3] Cf. Lahutte B., « Du concernement subjectif au traitement par la parole », intervention prononcée au Centre Pompidou dans le cadre du cycle « Psychanalyse, psychiatrie et malaise social », 2018.