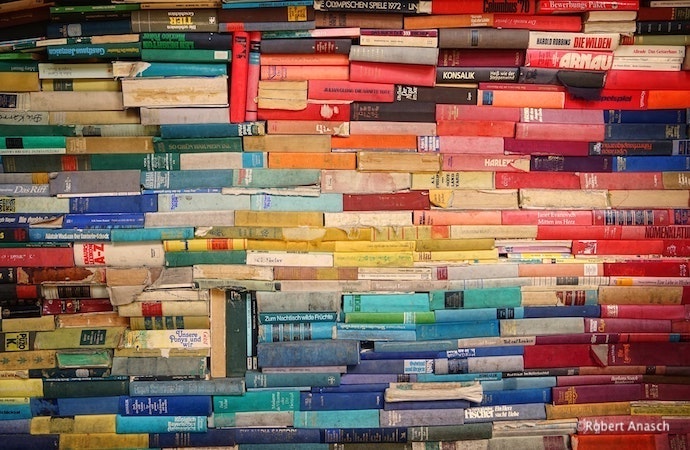Lecture et immigration sont les deux fils qui ont sous-tendu mon désir d’écrire ce texte et je l’articulerai à ceci : « l’artiste toujours précède l’analyste » [1], phrase de Lacan que j’entends ainsi : en quoi l’analyste peut-il s’enseigner de l’artiste ?
Dans son roman Eldorado, Laurent Gaudé [2] nous conte l’histoire de deux hommes que tout oppose : l’un policier des frontières qui perd le sens de sa mission, l’autre, migrant soudanais, qui tente la grande aventure vers une vie meilleure.
Depuis vingt ans, Salvatore, garde-côte sicilien, sillonne la Méditerranée afin d’intercepter, et parfois sauver, les émigrés clandestins pour les remettre aux autorités. Un jour, dans les rues de Catane, une femme qu’il a sauvée d’un de ces bateaux naufragés le reconnaît. Elle l’aborde et lui demande de lui procurer une arme pour tuer celui qui a abandonné le bateau dans lequel elle et son fils se trouvaient. Bien qu’à ce moment de sa vie il trouve son travail juste et bon, cette rencontre, « ce quelque chose d’imprévisible qui introduit une coupure entre un avant et un après » [3], va bouleverser sa vie. Divisé par ce que cette rencontre a produit comme rupture avec un savoir, il démissionne de son poste, brûle ses papiers d’identité et décide de traverser la mer Méditerranée à bord d’une barque pour effectuer le chemin inverse de celui pris par les migrants : « je suis nu […] comme seul un homme sans identité peut l’être » [4].
C’est à Ghardaïa, ville d’Algérie, que les destins des deux personnages se croisent. Parti du Soudan avec son frère, Soleiman poursuit seul le voyage. Après avoir été abandonné sur une plage par les passeurs, il aperçoit Boubakar, émigrant malien qui va devenir son compagnon de voyage. Soleiman dépouillera à son tour un homme et ne se reconnaissant pas dans celui qu’il est devenu, il ne trouve plus de sens à ce voyage. Alors qu’il déambule dans les rues de Ghardaïa – « je vais me perdre ici et ne bougerai plus » [5] –, il croise Salvatore qu’il prend pour l’ombre de Massambalo [6]. C’est cette rencontre contingente qui relance son désir de poursuivre le voyage – « je sais qui j’ai rencontré. Son œil m’a enveloppé […] et je me sens maintenant la force de mordre et de courir » – et qui donne à Salvatore, parce qu’il consent à « être » l’ombre de Massambalo, un nouveau sens à sa vie : « les hommes allaient peut-être continuer à mourir en mer, mais cela ne dépendait plus de lui. Il lui était donné de pouvoir souffler sur le désir des hommes pour qu’il grandisse ». Pour que ça fasse rencontre, il faut y mettre du sien !
À partir d’une réalité, celle de l’immigration clandestine, L. Gaudé nous fait entendre comment chaque sujet traite le réel auquel il a affaire, comment chacun des personnages se saisit des effets de la rencontre dans la quête de son Eldorado.
Pierre Naveau souligne que « la rencontre confronte nécessairement au désir de l’Autre » [7], désir décidé que chaque personnage du roman lit tour à tour dans le regard de l’autre. « La rencontre vient aussi ébranler la position de l’être » [8]. Clotilde Leguil [9] précise également que quand le sujet rencontre un évènement qui fait vaciller son identité sociale, cela l’amène à se poser une question sur son être. Il y a rencontre avec son être comme énigme pour lui-même. Il interroge son identité, s’en détache, pour chercher sa singularité.
N’est-ce pas ce qui se passe pour les personnages de ce livre ? La recherche de l’Eldorado ne renvoie-t-elle pas aussi à cette quête subjective de sa singularité, au-delà des identifications sociales, communautaires, familiales, etc. ?
Éric Laurent, lors de son intervention au forum de Rome, soulignait que « le migrant n’est pas seulement victime de la jouissance de l’Autre, mais il peut aussi montrer la part de libido en jeu chez lui, part qui lui appartient dans son parcours d’exil » [10]. Cette boussole est précieuse pour s’orienter dans la clinique des migrants : elle permet de ne pas se laisser fasciner par le pathos de la situation et de ne pas réduire les sujets décidés que nous accueillons aux drames qu’ils traversent.
[1] « Le seul avantage qu’un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position […] c’est de se rappeler avec Freud qu’en sa matière, l’artiste toujours le précède » (Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 192).
[2] Gaudé L., Eldorado, Paris, J’ai Lu, 2009.
[3] Naveau P., Ce qui de la rencontre s’écrit, Paris, Michèle, 2004, quatrième de couverture.
[4] Gaudé L., Eldorado, op. cit., p. 136.
[5] Ibid., p. 151.
[6] Dieu des émigrés qui lance à travers le continent des ombres pour veiller sur les peuples en souffrance, légende véhiculée par les migrants.
[7] Naveau P., Ce qui de la rencontre s’écrit, op. cit., p. 16.
[8] Ibid.
[9] Leguil C., « Je ». Une traversée des identités, Paris, PUF, 2018.
[10] Laurent É., intervention lors du forum européen de Rome « L’étranger. Inquiétude subjective et malaise social dans le phénomène de l’immigration en Europe », 24 février 2018, disponible sur le site de Radio Lacan : radiolacan.com