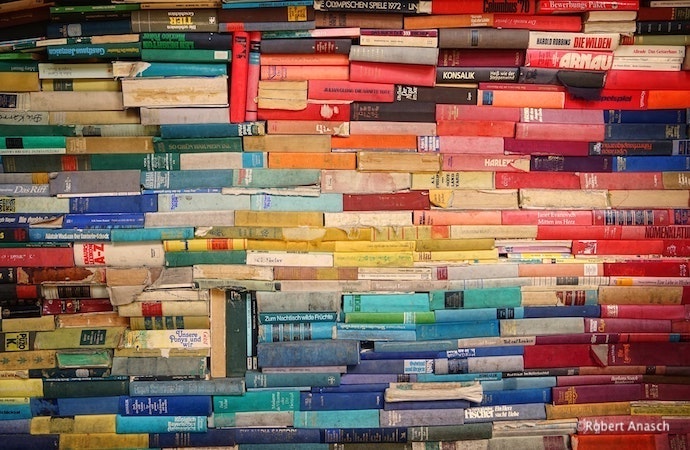« Le se taire n’est pas le silence » [1]. C’est avec cette phrase de Lacan dans le Séminaire XII que j’épinglerai l’œuvre de Santiago H. Amigorena : Une Enfance laconique (1998), Une Jeunesse aphone (2000), Une Adolescence taciturne (2002), Une Maturité coite (2004-2012), Mes derniers mots (2015). Autant de déclinaisons des effets non pas tant d’un silence sur l’histoire que de la transmission d’un se taire du côté d’un père. C’est avec Le Ghetto intérieur que nous en trouvons l’origine. Wincenty, le grand-père maternel, quitte la Pologne en 1928 pour se construire une nouvelle vie en Argentine. Il s’y fait une place de dandy, épouse cinq ans plus tard Rosita avec laquelle il a trois enfants et devient Vicente, un brin magouilleur mais mari aimant, père attentionné, et ami fidèle. Au fur et à mesure, insensiblement, il délaisse sa judéité, la Pologne et sa langue, privilégiant le plaisir, le jeu, et une certaine facilité. Il ne tient pas sérieusement sa promesse d’écrire à sa mère toutes les semaines, mais il entretient néanmoins avec elle une relation épistolaire, et un espoir qu’elle et son frère le rejoignent.
Cependant, les journaux se font l’écho de la montée du nazisme et de ses conséquences en Europe. Vicente refuse de les lire, cultivant un certain « ne rien vouloir savoir ». Mais l’angoisse ressurgit avec une lettre de sa mère témoignant des restrictions et violences qu’ils subissent avec l’installation du ghetto de Varsovie. Vicente décide alors de ne plus parler, plongeant son entourage dans une certaine perplexité. Il se tait et s’absente, s’enfermant, comme le titre du livre l’évoque, dans un ghetto intérieur, en compassion à l’épreuve maternelle. « L’acte de se taire ne libère pas le sujet du langage. Même si l’essence du sujet, dans cet acte, culmine – s’il agit l’ombre de sa liberté – ce se taire reste lourd d’une énigme » [2]. Vicente croit reprendre la main sur son impuissance et sa lâcheté en ne parlant plus et en s’excluant du lien social, mais il se retrouve confronté à un afflux de pensées qui alimente sa culpabilité. Toutes les raisons de son émigration lui semblent futiles. Il aperçoit sa surdité aux prémisses d’une guerre à venir. Il entend le reproche de n’avoir pas été chercher sa famille. Il s’abandonne dans le silence, qu’il inflige également à la famille qu’il a créée. C’est « quand la demande se tait, que la pulsion commence » [3]. Plus rien ne peut se dire et surtout pas la trahison et la honte qui en découlent. Ni le Yiddish qu’il a cessé de parler, ni l’espagnol qu’il a adopté, aucune langue ne peut s’en faire le support, l’élaboration ou le vecteur. C’est à une autre génération, dans un autre exil et une nouvelle exclusion de la langue maternelle, que la nécessité de reprendre la parole s’impose. Cette fois, c’est l’écrit qui en est le ferment, ce que Vicente refusait (lire les journaux, écrire à sa mère, …). Après Mopi, son cousin, S. H. Amigorena, à la première personne, retrace, déplie, interprète, construit autour de ce refus de parole du grand-père et autour du trou dans l’histoire que fut la Shoah. « C’est du silence même que centre ce cri, que surgit la présence de l’être le plus proche […]. Le prochain, c’est l’imminence intolérable de la jouissance » [4]. Cette jouissance qui nous vient de l’Autre, mais aussi celle en creux, à l’intérieur de nous-mêmes, « et dont nous ne pouvons qu’à peine nous approcher » [5].
S. H. Amigorena emprunte une autre voie, fait résonner une autre voix, et tisse une nouvelle trame signifiante pour s’y retrouver. « Je ne sais pas si, épuisé par son propre silence, il a songé, comme je songe à présent, que pour ne pas être complices de la tentative d’assassinat du langage des nazis, cet impensable, il nous faut pourtant, absolument le penser. » [6]
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XII, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », leçon du 17 mars 1965, inédit.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, « La logique du fantasme », leçon du 12 avril 1967, inédit.
[3] Ibid.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 225.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XII, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », op. cit.
[6] Amigorena S. H., Le Ghetto intérieur, Paris, POL, 2019.