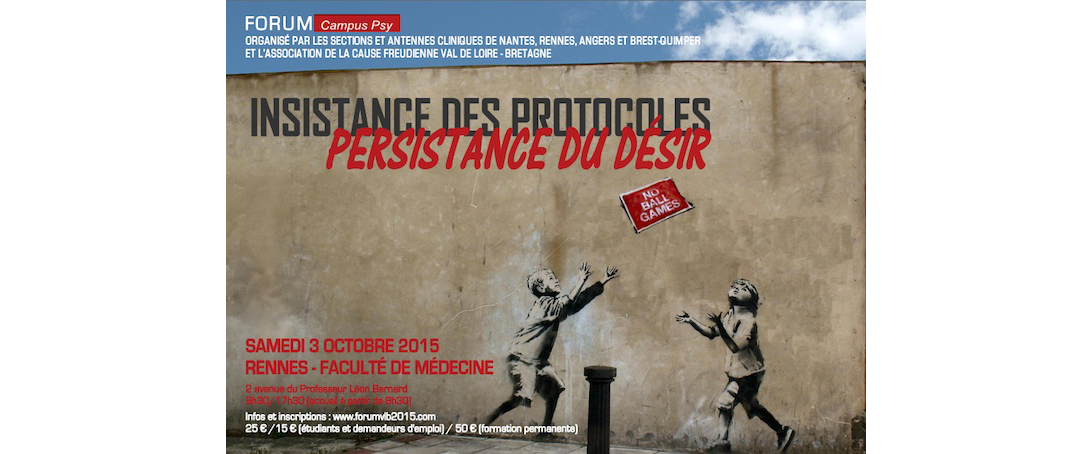Un couple, un roman. Une rupture. Ils s’aiment encore mais ne se supportent plus, ils se quittent, se désirent plus que jamais. Est-ce fini?
Il ne faut pas se méprendre à propos du titre du premier des quatre romans de Jean-Philippe Toussaint qui composent le cycle de Marie : Faire l’amour[1]. Il est ici question, en effet, du moment même d’une rupture.
Peu de temps après leur rencontre, Marie avait expliqué au narrateur qu’elle était tombée amoureuse de lui à l’instant où il avait fait un geste, un simple geste. Au cours de leur premier dîner, il avait rapproché très lentement son verre du sien. Ce geste lui était alors apparu élégant et délicat, mais explicite.
Sept ans plus tard, les deux amants se retrouvent dans une chambre d’hôtel à Tokyo, alors qu’ils sont en train de se séparer. C’est Marie qui a proposé ce voyage au narrateur. Il se pose, en fait, la question : « Était-ce la meilleure solution de voyager ensemble, si c’était pour rompre ? »[2] Le narrateur a plutôt l’idée que « la présence de l’autre à nos côtés ne [peut] qu’accélérer le déchirement en cours et sceller notre rupture »[3].
Ébauche d’un échange :
« – Pourquoi tu ne veux pas m’embrasser ?
– Je n’ai jamais dit que je voulais t’embrasser.
– Alors, pourquoi tu ne m’embrasses pas ?
– Je n’ai jamais dit non plus que je voulais t’embrasser.
Marie le regarde longuement et lui dit :
– Tu ne m’aimes plus. »[4]
Une pointe d’acidité se fait en effet entendre dans les répliques du narrateur. Il a une façon de parler à Marie qui montre qu’à travers les phrases mêmes qu’il prononce, il la laisse tomber et s’éloigne d’elle. C’est pourquoi, d’ailleurs, Marie se laisse tomber sur le lit et se met à pleurer. Le narrateur s’approche d’elle. Ils font à ce moment-là l’amour, précise le narrateur, comme si c’était la dernière fois. Mais, remarque-t-il, n’ont-ils pas fait souvent l’amour comme si c’était la dernière fois ? Souvent, se dit-il. La pensée vient alors au narrateur que, peut-être, il n’aime plus Marie. Mais, ce qui le frappe, le narrateur, c’est surtout la violence de leur étreinte : « J’avais le sentiment qu’elle frottait sa détresse contre mon corps pour se perdre dans la recherche d’une jouissance (…) incandescente et solitaire, douloureuse comme une longue brûlure, tragique comme le feu de la rupture que nous étions en train de consommer. »[5]
Là-dessus, le narrateur quitte Marie, puis la rejoint un peu plus tard dans le hall de l’hôtel. Ils sortent dans la rue. Il fait nuit et il pleut. Ils marchent sans un mot et, au premier mot de Marie – elle lui adresse un reproche – il accélère le pas et la plante là. Or, un incident se produit. Elle lui demande de lui laisser le parapluie. Il le lui tend. Mais le parapluie tombe par terre. « – Ramasse-le. Il ne dit rien. – Ramasse-le. Il ne bouge pas. »[6] Commentaire du narrateur : « Nous nous aimions, mais nous ne nous supportions plus. Il y avait ceci, maintenant, dans notre amour, que, même si nous continuions à nous faire plus de bien que de mal, le peu de mal que nous nous faisions nous était devenu insupportable. »[7]
Ce moment de rupture à Tokyo se ponctue ainsi dans l’esprit du narrateur : « Et pourtant dieu sait combien j’avais envie de l’embrasser maintenant – et tellement plus / maintenant que nous nous séparions pour toujours / que la première fois que je l’avais embrassée. »[8] Cette ponctuation s’achève ainsi par un « aveu » qui surprend le narrateur lui-même : « Le jour se levait et je la désirais très fortement maintenant. »[9]
[1] Toussaint J.-P., Faire l’amour, Paris, Éditions de Minuit, 2002.
[2] Ibid., p. 25.
[3] Ibid., p. 25.
[4] Ibid., p. 19.
[5] Ibid., p. 33.
[6] Ibid., p. 81.
[7] Ibid., p. 82.
[8] Ibid., p. 89.
[9] Ibid., p. 90.




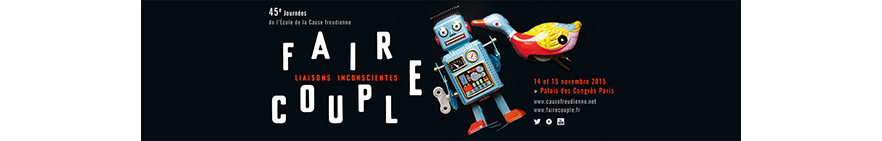

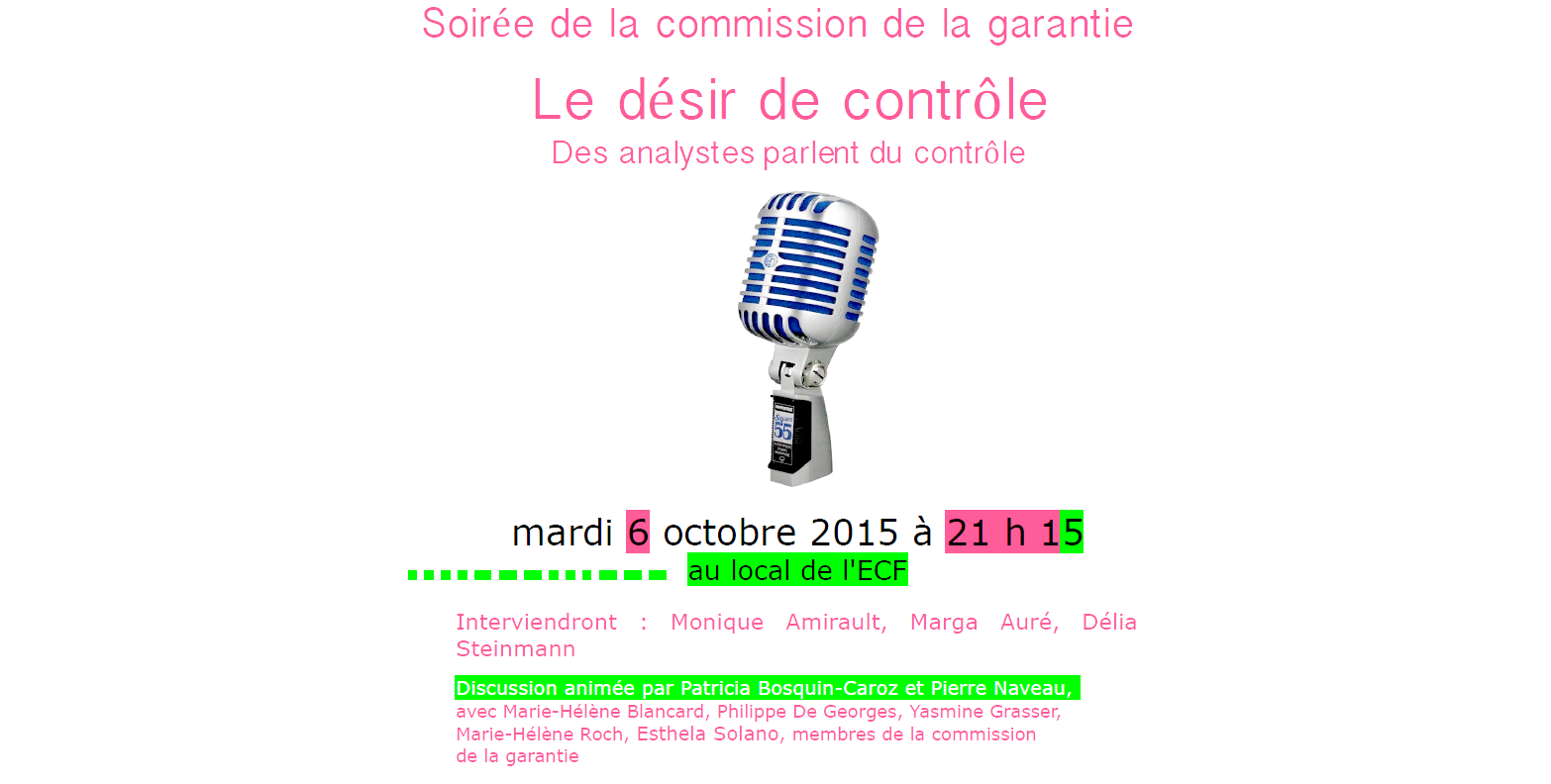

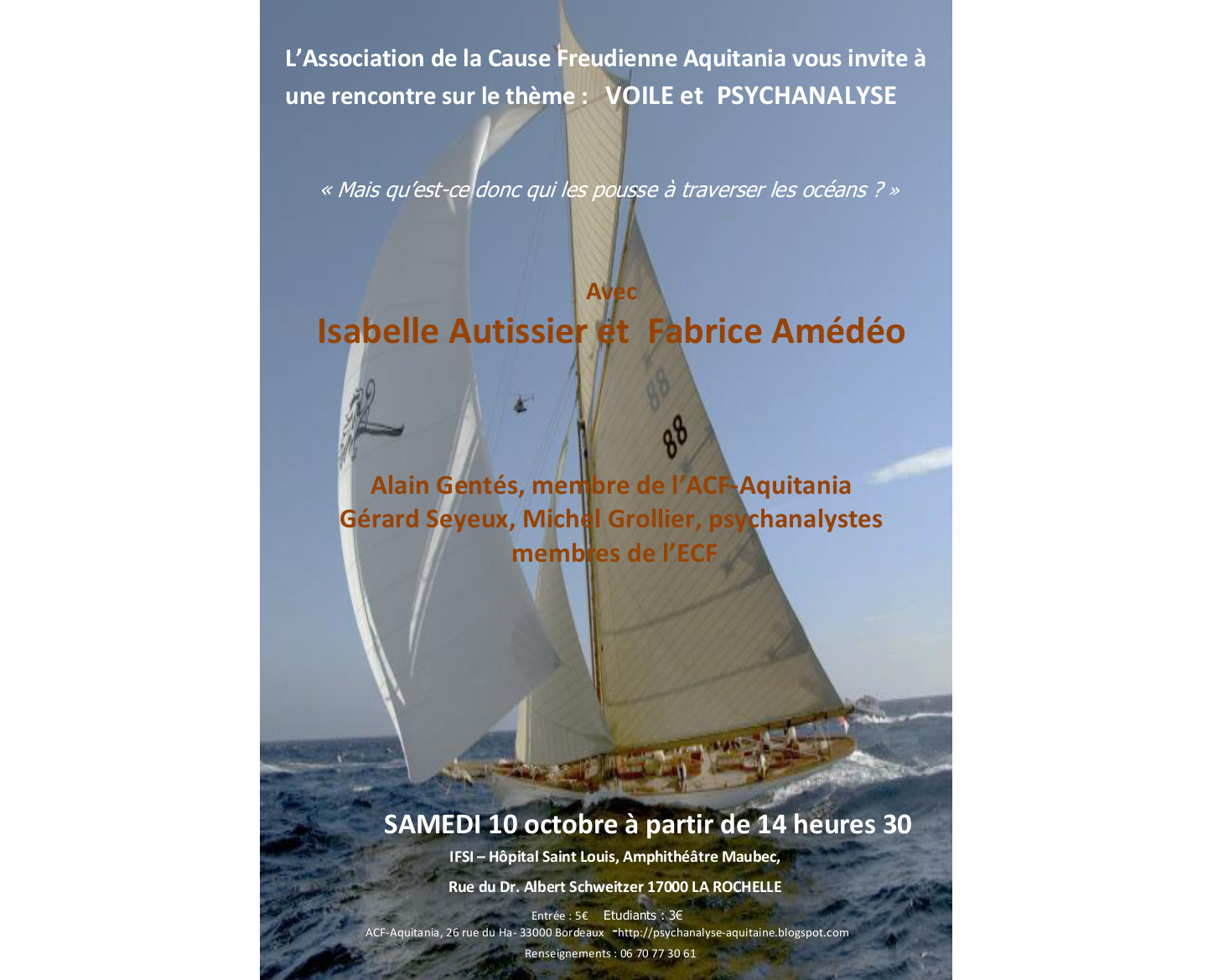
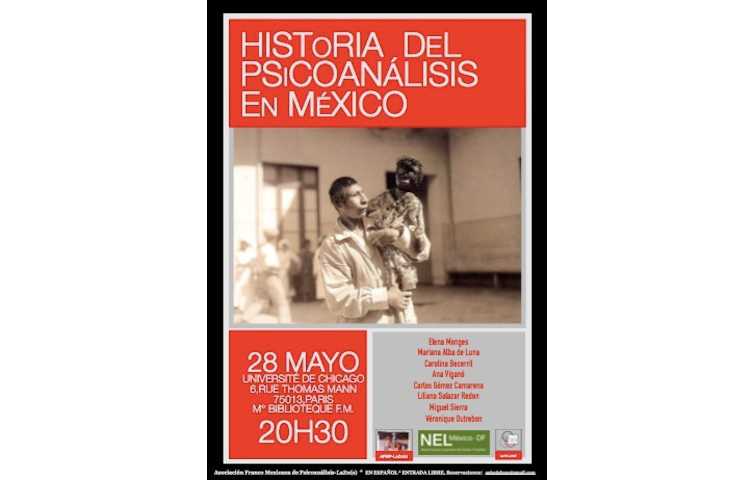
![À propos du livre de Philippe Mengue, Marcher, courir, nager. Le corps en fuite[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/10/image-Cottet2.png)