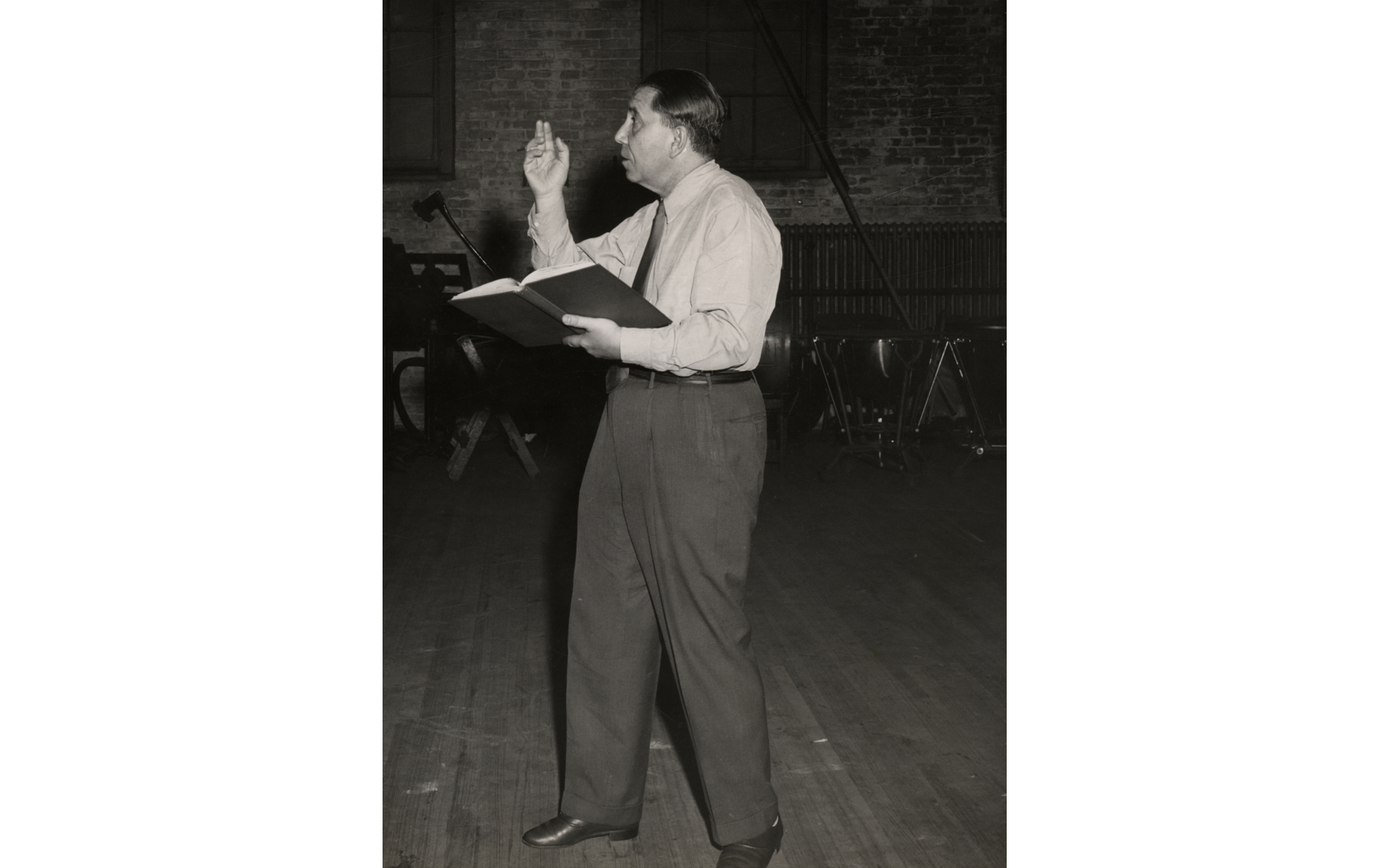C’est une image insolite, déconcertante, qui accueillera le visiteur de l’exposition qui se tient à Paris au Grand Palais[1], du 17 septembre 2014 au 2 février 2015. Celle d’une affiche où Niki de Saint Phalle semble tenir en joue, avec un fusil, celui qui la regarde. Mais qu’on ne se méprenne pas sur la cible. Cette image renvoie à la période[2] où l’artiste crée ses œuvres en tirant au fusil sur des surfaces verticales auxquelles sont fixés des objets divers et des sacs de peinture, le tout couvert de plâtre immaculé, tout comme l’artiste elle-même le plus souvent tout de blanc vêtue. Au-delà du spectaculaire de la performance qui a lieu en public, c’est ici la structure créative, dynamique, de l’artiste, qui nous est donnée à voir. Depuis l’instant d’appuyer sur la gâchette jusqu’au moment où les sacs explosés déversent leur couleur au rythme des déflagrations de l’arme, un point de rebroussement s’est réalisé entre la propre violence intime du sujet, sa véritable cible, et la création de l’œuvre qui se fait sous nos yeux, et qui le fait renaître artiste. « Un assassinat sans victime »[3] comme l’exprime Niki de Saint Phalle.
Car c’est dès les premiers mois de sa naissance que se fait vive cette violence, lorsque ses parents envoient celle qui se prénomme encore Catherine, Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, dans la Nièvre, passer les trois premières années de sa vie dans le château de ses grands-parents[4], cependant que son frère Jean reste avec eux à New-York. Le choix du prénom d’Agnès par son père, du nom de sa première maîtresse, s’avérera un acte de mauvais augure. C’est sa mère qui, lorsqu’elle revient vivre aux États-Unis, lui fait changer son prénom pour celui de Niki. La performance des tirs au fusil au principe de sa création manifeste une autre caractéristique subjective : « Ce qui est dehors est dedans et ce qui est dedans est dehors »[5]. Circularité im-médiate entre le corps et la réalisation artistique, mais réversible aussi avec ses effets funestes. Lorsque Niki réalisera et projettera la première version de son film Daddy, elle sombrera de nouveau dans une dépression. C’est un « film à l’humour noir, intitulé Daddy, dans lequel je tue symboliquement mon père 17 fois : toute la famille est à la fois indignée et horrifiée et m’accuse de salir la mémoire de mon père. Une seule personne me défend…ma mère »[6]. Oui, sa mère, à laquelle son mari avait dû avouer sa conduite incestueuse à l’égard de leur fille. Quelques rares critiques, et Jacques Lacan, prendront alors publiquement la défense du film. C’est en décembre 1992, âgée de soixante-cinq ans que Niki de Saint Phalle relatera dans un livre, Mon secret,[7] spécialement écrit à l’intention de sa fille Laura, les actes incestueux qu’elle avait subis à l’âge de onze ans de la part de son propre père. Ce dernier lui avait adressé une lettre de confession et de repentir, quand il avait appris l’entrée de sa fille en hôpital psychiatrique, faisant pour elle ainsi trauma de ce qui était, jusque-là, refoulé, oublié. Niki était alors âgée de vingt-deux ans et mariée depuis trois ans à l’écrivain Harry Matthews, talentueux écrivain qui sera longtemps le seul membre américain d’OULIPO, dont son ami Georges Perec faisait aussi partie. C’est Harry qui surprit le délire de sa femme : « Harry me suit et se poste dans le couloir juste devant notre porte : il m’observe en silence tandis que je soulève d’un geste brusque un des bords du matelas, les draps et tout… pour y planquer, en hâte, un couteau. C’est à ce moment précis que Harry scrute le magot d’objets tranchants que j’ai amassés là : tout un assortiment de couteaux, de ciseaux, de rasoirs, de tournevis […] Cet arsenal me donne un sentiment si aigu de protection que je place, dans mon sac à main, une seconde collection du même genre dont Harry n’a pas encore connaissance »[8]. Les tentatives de suicide, et les idées suicidaires se feront récurrentes. Tout comme les évènements de corps et les maladies : automatisme de ronger sa lèvre supérieure qui donnera lieu, à vingt-ans, à une opération de restauration, appendicite, complications pulmonaires, tuberculose, hyperthyroïdie nécessitant l’ablation de la thyroïde, tachycardie et fébrilité extrême, typhoïde. Tout comme elle ne cessera d’être rongée par la culpabilité de n’avoir pu offrir à ses deux enfants, Laura et Philip, une présence de mère.
Puis en 1967, c’est la réalisation de Hon – Elle, en suédois – sur une commande de Pontus Hulten, alors directeur du Moderna Museet de Stockholm, qui suit ses premières réalisations de la série des Nanas, par lesquelles le visiteur de l’exposition commence la visite. Ces Nanas qui manifestent elles aussi ce point de rebroussement : volumineuses et équilibrées, surpondérées et aériennes, massives et élancées, informes et voluptueuses, plantureuses et élégantes. Depuis plusieurs années déjà, Niki vit avec l’artiste Jean Tinguely. Sur ce point aussi, l’amour l’accompagnera tout au long de sa vie. D’abord avec le prévenant H. Matthews, père de ses deux enfants, puis à partir de 1960 avec le facétieux et exubérant J. Tinguely[9], disparu en 1991. C’est lui qui, réalisant les armatures en métal, permit aux œuvres monumentales de Niki de tenir debout[10]. Elles essaiment les lieux du monde entier : jardins, forêts, fontaines, places publiques, un avion ; en Italie, en Suède, en Israël, aux USA, en Allemagne, en France. Le visiteur de l’exposition peut les découvrir sous forme photographique ou cinématographique, avec les films des entretiens avec l’artiste. Il faut ajouter à ses réalisations films et décors de films, costumes et pièce de théâtre, architecture, parfum, meubles, fontaines, piscine… sans oublier l’écriture. Niki de Saint Phalle était, envers et contre tout, amoureuse, optimiste, vive, gaie, tonique, entraînante pour son entourage, a contrario de sa sœur Élisabeth qui, après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, s’était suicidée, jeune adulte, dans la maison familiale.
C’est à la ville de Nice que Niki de Saint Phalle fera don de ses œuvres. Cette ville où elle avait vécu et avec laquelle, comme l’écrit sa fille Laura, elle partage l’étymologie de son prénom, Niké, la victoire. Mais Nice fut surtout la ville où, internée sur proposition de son mari et avec son accord, sous traitement par insuline et électrochocs, elle avait découvert comment ses dessins au crayon et ses collages étaient un traitement autrement efficace pour la raccorder à la vie. Par un retour de bâton, c’est cette même activité artistique dans laquelle elle propulsait son énergie, et qui était pour elle d’une nécessité vitale, qui causera aussi sa perte. En effet, les émanations du polyester avec lequel elle travaillait, brûleront ses poumons, brûlures dont elle finira par décéder en 2002.
[1] Lire aussi Bélilos M., « Niki de Saint Phalle ou la guerrière blessée », Lacan Quotidien n° 433, octobre 2014.
[2] Saint Phalle (de) N., Lettre à Jean (Tinguely) ; Lettre à Pontus (Hulten), Catalogue, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1992, Musée d’Art Moderne de Paris, 1993, p 156-160.
[3] Saint Phalle (de) N., Traces, Paris, La différence, 2014.
[4] Ibid., p. 14.
[5] Ibid., p. 121.
[6] Saint Phalle (de) N., Mon secret, Paris, La différence, 2010.
[7] Ibid.
[8] Saint Phalle (de) N., 1950-1960, Les années en famille, préface de Laura Gabriel Duke, Paris, La différence, 2014.
[9] Saint Phalle (de) N., Aventure suisse, Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg, Fribourg, 1993, p. 18.
[10] Lire aussi Christiane Terrisse « Le temps de l’œuvre » : https://apprendredelartiste.wordpress.com/2003/04/26/les-temps-de-l%E2%80%99oeuvre-par-christiane-terrisse/