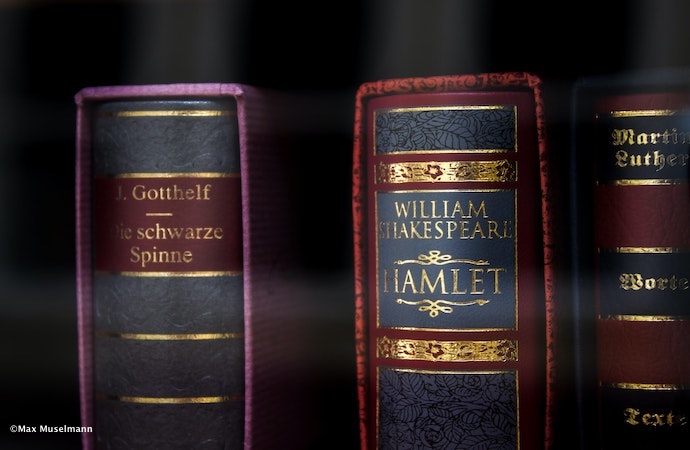Nous dira-t-il le sens de ce spectacle ?
William Shakespeare, Hamlet
« Quelle est-elle donc cette œuvre, qui fait de chaque universitaire, de chaque chercheur, de chaque poète qui s’y attelle un véritable metteur en scène ? » [*] [1] Chacun en convient, la pièce agit comme un « filet d’oiseleur » [2], où vient se prendre le désir de l’homme et chacun tombe dans le piège. À l’illusion, préférons la présence réelle d’Hamlet tout entière dans l’instant de sa représentation.
Lire Hamlet n’est pas la même chose que de voir la pièce jouée, car la représentation ajoute quelque chose : la fonction de l’interprète. L’acteur prête son corps au texte, au discours inconscient, « non pas simplement comme une marionnette, mais avec son inconscient bel et bien réel » [3]. Cette thèse de Lacan sur la présence de l’acteur et sa fonction de modèle donne à l’interprétation un corps à trois dimensions. D’abord, imaginaire, car l’acteur prête son corps, sa marionnette, ses membres et sa grammaire pulsionnelle au discours de l’Autre. Et le texte qui est symbolique, avec son inconscient que Lacan qualifie de bel et bien réel. Les trois dimensions de l’être parlant sont ainsi nouées ensemble de façon borroméenne par ce qui fait nœud d’interprétation, plus ou moins réussi, avec plus ou moins de grâce. Il y a donc autant d’Hamlet que d’interprètes. La topologie lacanienne, c’est-à-dire la réunion de l’imaginaire, du symbolique et du réel, apporte une lecture de la pièce, au-delà de l’Œdipe [4].
Il y eût et il y a encore de nombreuses études sur Hamlet, trop sans Lacan. Et trop peu de mises en scènes d’Hamlet qui ont osé parier sur les sept leçons que Lacan y consacre en 1959 dans son Séminaire VI, Le Désir et son interprétation, établi par Jacques-Alain Miller, paru en 2013, de sorte qu’il est maintenant impossible de les ignorer.
Leçon d’interprétation, où lire se fait avec de l’écrit et convoque lettres, poinçons, parenthèses, point d’interrogation, itinéraire, lignes de l’être et de l’existence. La lecture de Lacan est strictement homologue à la composition de ce qu’il appelle alors le gramme. Commencé dans son Séminaire V, Les Formations de l’inconscient [5], le gramme trouve son aboutissement en 1967 sous le nom de graphe du désir dans « Subversion du sujet et dialectique du désir » [6]. Hamlet réalise le graphe du désir.
Leçon de topologie, où l’espace d’« une structure telle que, là, le désir puisse trouver sa place » [7] revient ici à ce cheminement d’Hamlet, flottant, en zigzag [8]. Où le temps (Father Time) par l’effet de la chose spectrale est hors de ses gonds, où l’espace temps devient vertical, en étage, feuilleté, de plans superposés, ouvert. L’itinéraire d’Hamlet est un entrelacement d’actions qui ne mènent nulle part, le temps a quelque chose d’épuisé, d’inachevé, d’inachevable où l’acte finit par s’accomplir in extremis [9]. Le temps devient kairos c’est-à-dire, instant, occasion quand il se précipite, mobilise la hâte : « Puisque rien dans cette pièce ne l’est jamais [crucial] – sauf sa terminaison mortelle, car en quelques instants s’accumule, sous forme de cadavres, tout ce qui, des nœuds de l’action, était jusqu’alors retardé » [10].
Leçon sur la tragédie moderne contemporaine d’une crise. Elle fut écrite en 1601 au plus fort d’une crise majeure des représentations – littéraire, psychologique, scientifique, politique – qui affecte l’Europe tout entière entre 1550 et 1650 et signe l’entrée dans l’ère moderne. La tragédie d’Hamlet nous fait accéder au sens de S(Ⱥ). C’est le secret de la psychanalyse : « Le grand secret [de la psychanalyse], c’est – il n’y a pas d’Autre de l’Autre. » [11] C’est ce qui fait la modernité d’Hamlet. La révélation faite au prince par le Ghost, le spectre du père, vient comme une véritable intrusion du réel. Ce qui est signifié à Hamlet en ce point S(Ⱥ) sur la ligne de son existence, son père ne peut plus en répondre. C’est sans aucune garantie.
Lacan fixe son mathème comme point de capiton du discours inconscient et tranche : le seul point de raccord entre Œdipe et Hamlet est un point de différence structurale. S’il y a de l’insu chez Œdipe, Hamlet, lui, sait : « Autrement dit, il a la réponse. » [12] Le message d’ordinaire voilé est clairement inscrit sur la ligne de l’articulation inconsciente. Hamlet sait « la trahison de l’amour » [13]. Ce dévoilement est de l’ordre d’une vérité rencontrée et la rencontre avec le Ghost a toutes les caractéristiques de l’horreur. Lacan ajoute que si nous pouvons nous, spectateurs, y croire, c’est que Shakespeare a rencontré la mort (la mort de son père, caractère inaugural de la pièce). Par-là, le dramaturge nous fait accéder à une vérité sans figure, « sans espoir » [14], sans rachat. Notons que ce savoir ne pousse pas à l’action, Hamlet musarde. Lacan fait de ce savoir le ressort de la procrastination, elle est une dimension essentielle de la tragédie du désir du prince. C’est ainsi que la pièce se présente comme une énigme, le conflit est atypique et concerne le rapport d’Hamlet avec son acte, cet acte qu’il renvoie toujours à plus tard. Il doit tuer Claudius, meurtrier de son père, il veut le tuer, il veut le faire et il répugne à le faire.
Le problème se formule ainsi : comment la procrastination d’Hamlet pourra-t-elle être levée ? Au-delà de S(Ⱥ), comment Hamlet pourra-t-il retrouver la voie de son désir, comment le message va-t-il poursuivre son chemin jusqu’à son terme ? (Et Lacan continue le schéma du graphe arrêté en ce point). Dans sa présentation du Séminaire VI, J.-A. Miller apporte une réponse en faisant apparaître qu’Hamlet a recours au fantasme [15] (dont l’usage est de mettre à niveau le désir, et de l’y maintenir). Le fantasme vient comme défense face à l’opacité de ce qui est rencontré, laissant le sujet sans repère de nomination, et dans un état de panique et d’Hilflosigkeit.
Lacan inscrit son interprétation de la pièce dans ce qu’il appelle l’articulation moderne de l’analyse, celle qui cherche à articuler l’objet et la relation d’objet. Ce qui s’écrit : $ ◇ a. Lacan poursuit : « À nous avancer dans cette exploration en utilisant nos appareils symboliques, nous verrons qu’ils sont seuls à faire apparaître, concernant la fonction du deuil, des conséquences que je crois nouvelles » [16].
[*] Version réduite et revue d’un texte préalablement paru dans L’a-graphe. Section clinique de Rennes 2013-2014, novembre 2014, p. 49-57.
[1] Chéreau P. & Stratz C., « Avant-propos », in Wilson J. D., Vous avez dit Hamlet ?, Paris/Nanterre, Aubier/Amandiers, 1988, p. VIL.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La Martinière/Le Champ freudien, 2013, p. 297.
[3] Ibid., p. 328.
[4] Cf. Miller J.-A., « Une réflexion sur l’Œdipe et son au-delà », Mental, n°31, avril 2014, p. 135-142.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les Formations de l’inconscient, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1998.
[6] Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 793-827.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 327.
[8] Cf. ibid., p. 296.
[9] Ibid., p. 295.
[10] Ibid., p. 283.
[11] Ibid., p. 353.
[12] Ibid., p. 351.
[13] Ibid., p. 352.
[14] Ibid., p. 353.
[15] Cf. Miller J.-A., « Une réflexion sur l’Œdipe… », op. cit., p. 135-142.
[16] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 397.