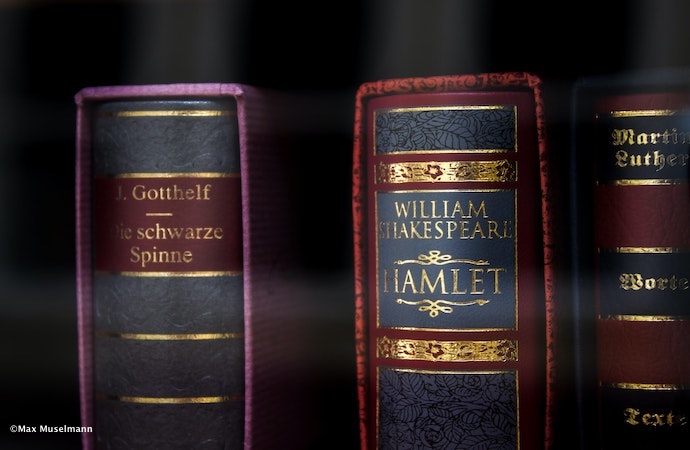Nulle ontologie absolue ne se dégage de l’enseignement lacanien. Cependant, la question de l’être y est présente et convoquée à travers des références. À partir de la tirade d’Hamlet « To be, or not to be » [1], Lacan interroge les rapports de l’être au désir.
Vérité sans espoir
La pièce shakespearienne s’ouvre sur la visite d’outre-tombe d’Hamlet père. Le Ghost révèle à son fils que la vérité véhiculée sur sa mort est fausse, Claudius est un félon. La vérité choit au pied de la trahison, laissant le pauvre Hamlet désemparé : à quelle vérité se fier ? D’autant plus qu’un Autre qui « revient des limbes pour dire que l’Autre n’est pas fiable, ne serait-ce pas un Autre trompeur ? » [2] La vérité devient « sans espoir » [3].
La perte de la boussole du désir
Après cette réponse reçue de l’Autre, où chute toute garantie dernière, le prince du Danemark rencontre sa promise, Ophelia. C’est une rencontre qui s’avère aussi funeste que la précédente. En effet, le père mort ayant révélé la tromperie de la reine et chargé son fils de veiller sur la jouissance féminine de celle-ci, le prince éprouve alors : « l’irrémédiable, absolue, insondable, trahison de l’amour » [4], comme le dit poétiquement Lacan. Dès lors, « quelque chose […] ne va pas dans le désir d’Hamlet » [5]. Ayant appris la coucherie de sa mère, il éconduit celle qui était, jusque-là, sa dulcinée. Il opère « la destruction ou la perte de l’objet [phallique] », « le rejette de tout son être » [6]. En effet, et c’est le génie de Shakespeare, Ophelia est littéralement le phallus – ce que signifie, d’une part, sa racine grecque omphalos [7] et ce que redouble, d’autre part, la mention des « doigts d’hommes morts » [8] à son propos.
Le désir, comme « bouclier », s’évanouit. Il ne s’« interpos[e] [plus] entre [le sujet] et l’existence insoutenable » [9], laissant le prince en proie à une douleur d’exister.
To be, or not to be
Cette souffrance, c’est ce qu’expose la célèbre tirade d’Hamlet où il clame : « To be, or not to be, that is the question » [10]. Car l’aveu paternel d’avoir été « fauché dans la pleine fleur de [s]es péchés » [11], donc de n’être pas en règle, conduit le fils, qui n’a pas le luxe de l’ignorance d’Œdipe, de se savoir « coupable d’être. Il lui est insupportable d’être. Avant tout commencement du drame, il connaît le crime d’exister. C’est à partir de ce commencement qu’il est devant un choix à faire, où le problème d’exister se pose dans les termes qui sont les siens, à savoir, To be, or not to be, ce qui l’engage irrémédiablement dans l’être, comme il l’articule fort bien » [12].
La division du prince entre to be et not to be témoigne de l’impossible choix entre les deux. D’un côté le to be implique de supporter les aléas de la vie et, de l’autre côté, le not to be suppose de mourir en s’opposant à ceux-ci :
« Est-il plus noble pour l’esprit d’endurer
Les frondes et les flèches de l’injuste fortune,
Ou de prendre les armes contre les flots adverses
Et de leur faire face pour en finir. Mourir… dormir » [13].
L’impasse d’Hamlet, c’est que, face à son tourment de l’être, la solution du not to be, c’est-à-dire de la mort, n’est pas envisageable, puisque son « drame […], c’est la rencontre […], non avec le mort, mais avec la mort » [14]. En effet, le Ghost a fait de la mort une forme de vie, puisqu’il a témoigné être au purgatoire pour expier ses péchés. Il n’y a donc plus de certitude que ça finisse un jour. Hamlet a perdu foi en la mort [15] et son désir est mis à l’arrêt.
Leurrer l’être
L’issue sera celle du désir. Le rapport d’Hamlet comme sujet à l’objet a se rétablit lors de l’enterrement d’Ophelia où le frère de celle-ci, Laertes, fou de chagrin, saute dans la tombe. Hamlet entend le « verbe de douleur » [16] de ce dernier et le rejoint. Par cette identification, se rétablit le rapport du sujet à l’objet, conduisant le prince à « retrouver […] son désir dans sa totalité » [17]. Car, c’est en tant qu’Ophelia devient « un objet impossible » [18], dont « le sujet est privé […], que ce quelque chose devient objet dans le désir » [19]. Ainsi, cet objet opère, pour Hamlet, comme un « leurre de l’être » [20], tenant à distance la douleur qui lui est liée.
Consentant à une identification, le prince pousse le cri de son énonciation : « This is I, Hamlet the Dane » [21]. Il peut et redire je et réinvestir une croyance en l’Autre, en la providence. Alors qu’il est sur le point de livrer un combat truqué, il énonce un : « Let be » [22], qui signe le choix fait d’un certain to be. Ainsi, Hamlet, cette « tragédie du désir » [23] et de l’existence, se scelle sur une ouverture : la croyance réinvestie du prince dans le signifiant, chargeant son frère d’arme, Horatio, de transmettre son histoire [24].
[1] Shakespeare W., Hamlet, Paris, Flammarion, 1995, acte III, scene 1, p. 204.
[2] Hoornaert G., « Hamlet et la douleur d’exister », L’a-graphe. Section clinique de Rennes 2013-2014, novembre 2014, p. 64.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La Martinière/Le Champ freudien, 2013, p. 353.
[4] Ibid., p. 352.
[5] Ibid., p. 291.
[6] Ibid., p. 380.
[7] Sur le lien Ophelia–phallus, cf. Aflalo A., « Raison et ruses du désir chez Hamlet », Mental, n°32, octobre 2014, p. 104.
[8] « dead men’s fingers » (Shakespeare W., Hamlet, op. cit., acte IV, scène 7, p. 346, et p. 347 pour la traduction).
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 144.
[10] Shakespeare W., Hamlet, op. cit., acte III, scene 1, p. 204.
[11] « Cut off even in the blossoms of my sin » (ibid., acte I, scene 5, p. 118, et p. 119 pour la traduction).
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 293.
[13] « Whether ’tis nobler in the mind to suffer | The slings and arrows of outrageous fortune, | Or to take arms against a sea of troubles, | And by opposing end them. To die, to sleep » (Shakespeare W., Hamlet, op. cit., acte III, scène 1, p. 204 & 206, et p. 205 & 207 pour la traduction).
[14] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 346.
[15] « La mort est du domaine de la foi » (Lacan J., « Conférence à Louvain », texte établi par J.-A. Miller, La Cause du désir, n°96, juin 2017, p. 11, disponible sur le site de Cairn).
[16] « phrase of sorrow » (Shakespeare W., Hamlet, op. cit., acte V, scène 1, p. 376, et p. 377 pour la traduction).
[17] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 318.
[18] Ibid., p. 396.
[19] Ibid., p. 387.
[20] Ibid., p. 370.
[21] « Oui, c’est moi, Hamlet le Danois ! » (Shakespeare W., Hamlet, op. cit., acte V, scène 1, p. 376, et p. 377 pour la traduction).
[22] Ibid., acte V, scène 2, p. 404.
[23] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 297.
[24] « draw thy breath in pain, | To tell my story » (Shakespeare W., Hamlet, op. cit., acte V, scène 2, p. 420).