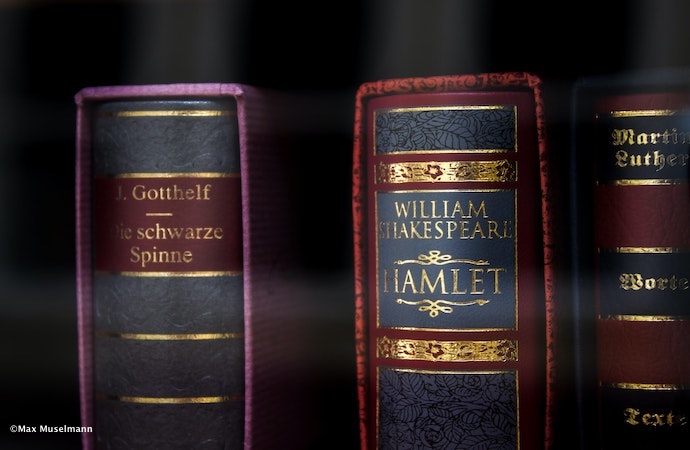Le retour à Freud de Lacan s’est fondé sur une critique des dérives du postfreudisme, au centre de laquelle se trouvait le refus de son puritanisme et de sa théorisation du « désir génital », pensé comme la normalité produite à la fin d’une analyse. C’est contre cette conception du désir – présentée notamment dans un ouvrage [1] publié sous la direction de Sacha Nacht en 1956 et sur lequel il ironise souvent en parlant des « psychanalystes d’aujourd’hui » – que Lacan a proposé une élaboration radicalement nouvelle de la structure du désir dans son Séminaire Le Désir et son interprétation. Lacan fait entendre que le désir n’est pas un aboutissement pacifié d’une relation d’objet normalisée mais, avant tout, un « tourment » [2] que le sujet rencontre quand il n’oriente pas son existence à partir de l’éthique du bien et du plaisir.
Pour en illustrer une des difficultés, Lacan aborde le problème d’Hamlet, son énigme, qui a fait le lit de siècles de commentaires : pourquoi le prince est-il incapable d’accomplir l’acte que son désir devrait lui commander, à savoir venger son père admiré en assassinant son meurtrier, son oncle Claudius qui a épousé sa mère et pris sa place sur le trône ? Lacan lit mot à mot le texte et construit une interprétation de cette énigme à partir du constat qu’Hamlet a été « définitivement aboli dans son désir » [3]. À partir des articulations de la pièce, nous pouvons suivre ce qui donne la raison de cet acte impossible comme des voies de détour qui permettront toutefois son accomplissement, au prix de la mort du héros.
Lacan remarque qu’Hamlet n’est pas incapable d’agir dans sa vie, mais que, pour lui, la castration n’est pas advenue, ce qui lui rend impossible la constitution d’un désir décidé. La raison de cette impossibilité, Lacan l’identifie au désir de la mère qui, comme il le dira pour Antigone l’année suivante, est « l’origine de tout […], une impasse semblable à celle d’Hamlet » [4]. La pièce de Shakespeare est « le drame du désir dans son rapport au désir de l’Autre » [5]. Comment qualifier la particularité de ce désir maternel qui a le pouvoir de faire fléchir le désir de son fils et de lui rendre impossible le deuil du phallus, soit l’assomption de la castration ? Lacan choisit de le dire à partir des traits qu’il fait porter à Gertrude, « abyssal[e], féroc[e] et trist[e] » [6]. Ce qui donne à ce désir une puissance de mortification c’est d’être en fait « moins désir que gloutonnerie, voire engloutissement » [7]. Disons qu’il s’agit davantage d’une jouissance qui ravale le désir en manquant à distinguer entre « un objet digne et un objet indigne » [8] entre le père et son frère, jouissance qu’Hamlet dénonce ainsi : « vivre dans la sueur rance d’un lit poisseux, mariner dans le stupre, faire le câlin et l’amour dans une bauge infecte » [9]. Gertrude, par son remariage précoce, a fait monstration d’une « trahison de l’amour » [10], qui est le message qu’Hamlet reçoit et auquel il consent à l’issue de l’acte III, consentement qui dit la destruction dont son désir a fait l’objet.
Certes, Hamlet avait-t-il fait d’Ophélie l’objet de son désir, mais ce désir il ne peut le soutenir dès lors qu’il sait que sa mère a trahi. Ophélie n’est alors plus qu’un objet de mépris et de rejet et il ne retrouvera ce désir qu’après son suicide, par l’identification au deuil du frère de la jeune fille, Laërte. C’est encore avec lui, double imaginaire, qu’il s’affrontera lors du combat final. Affrontement qui voit Hamlet, mortellement blessé, pouvoir enfin accomplir l’acte commandé par son père. Combat qui est l’heure de vérité où s’affirme l’être du sujet comme sujet de désir, désir dont la particularité, démontrée par Lacan, fait qu’il ne peut plus y accéder qu’au prix de sa vie.
[1] Nacht S. (s/dir.), La Psychanalyse d’aujourd’hui, Paris, PUF, 1956.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La Martinière/Le Champ freudien, 2013, p. 425.
[3] Ibid., p. 488.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 329.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 365.
[6] Ibid., p. 356.
[7] Ibid.
[8] Ibid., p. 339.
[9] Shakespeare W., Hamlet, in Tragédies, t. I, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2002, p. 865.
[10] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 352.