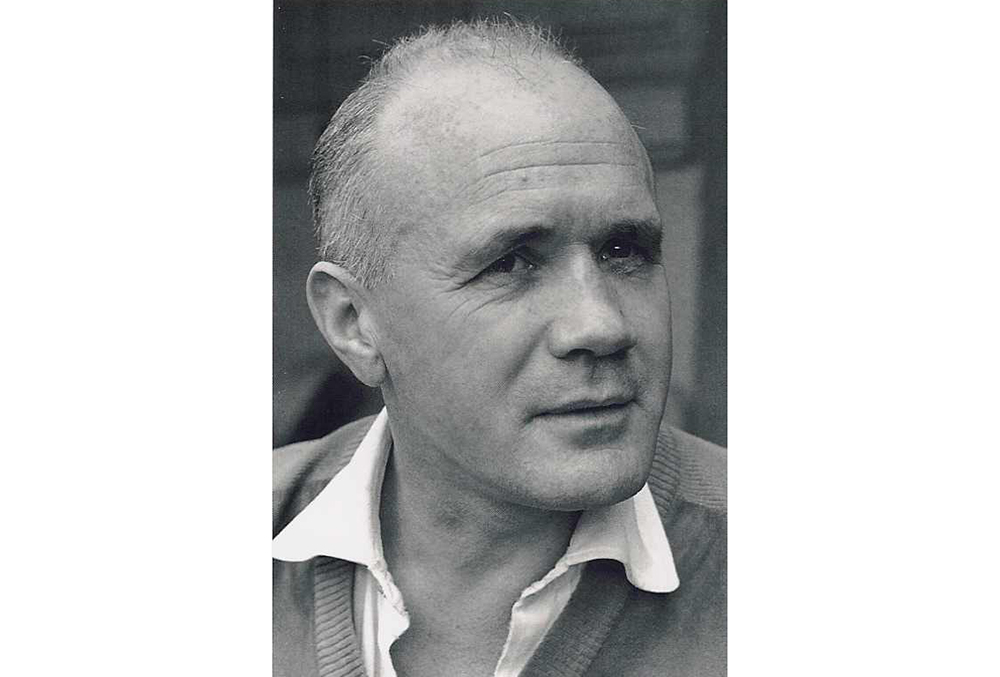Paola Bolgiani, membre du comité de pilotage du troisième Congrès européen Pipol sur le thème Victime !, a accepté de répondre à une question pour l’Hebdo-Blog afin de nous mettre en marche vers cet événement européen majeur qui aura lieu les 4 et 5 juillet à Bruxelles.
HB – La figure de la victime fascine et émeut si l’on en croit les foules que drainent les fictions les mettant en scène. Pourtant dans la vie, les victimes suscitent aussi le rejet et peuvent voir se déchaîner à leur endroit une haine sans limite. Est-ce là un point que Pipol 7 va nous permettre d’appréhender ?
P. B. – À partir du moment où j’ai lu votre question, ce qui m’est venu à l’esprit c’est le livre de Primo Levi qui s’intitule I sommersi e i salvati (Les naufragés et les rescapés)[1]. C’est un livre que j’ai lu il y a longtemps et qui, à l’époque, m’avait fait très grande impression, mais je ne me rappelais pas bien pourquoi. Je l’ai pris dans mes mains, je l’ai un peu parcouru, et je me suis dit « mais non, ce n’est pas pertinent pour cette question ». Cependant, à chaque fois que je pensais à la question, ce livre me revenait à l’esprit. Alors, j’ai décidé de le relire à la lumière de cette question qui touche celle du rejet et de la haine que peut susciter quelqu’un qui a été réellement une victime.
Ce livre a été publié en 1986, un an avant la mort de Primo Levi, et quarante ans après la fin de la guerre et la fin de son internement à Auschwitz. C’est un livre – comme Primo Levi nous le dit lui même, au regard de tous ses livres – qui vaut comme témoignage, comme une manière de maintenir la mémoire de ce qu’a été la shoah, contre toute tentative de l’effacer ou d’en réduire la dimension et la logique. C’était là l’action des nazis, à savoir détruire toute preuve et faire en sorte que « Quando anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti […]. La storia dei Lager saremo noi a dettarla »[2]. Les nazis, de même que les prisonniers qui pourraient encore le faire, savaient bien que la monstruosité du camp était telle que le monde ne pourrait pas croire à l’histoire des éventuels survivants, parce que, comme Primo Levi le met bien en évidence, face à une telle monstruosité ce qui prévaut c’est horreur et le « n’en rien vouloir savoir ».
On peut se demander ce que précisément on ne veut pas savoir face à la victime, qu’est-ce qui produit l’horreur et parfois la haine, dont les survivants des camps témoignent. Peut-être s’agit-il d’une honte liée à la sensation d’être en quelque sorte coupables, ou au moins complices par le seul fait d’être des êtres parlants comme l’étaient les nazis. À chaque fois que l’on apprend quelque acte féroce et cruel, la tentation est grande de nommer celui qui l’a commis fou, sadique, barbare, bref, de l’épingler comme n’étant pas vraiment humain. C’est peut-être insupportable d’avoir à faire à quelque chose que nous avons du mal à considérer comme humain – l’extermination systématique et scientifiquement menée de tout un peuple, et la violence « inutile »[3] avec laquelle cela a été effectué – et qui pourtant est totalement interne à la dite « nature humaine ». Primo Levi nous indique un point que j’ai trouvé fondamental pour comprendre d’une manière plus profonde pourquoi une victime peut susciter l’horreur et la haine. Il critique ce qu’on appelle l’« incommunicabilité »[4], en indiquant avec clarté que l’incommunicabilité dont on se plaint généralement – il fait référence ici à la question de l’incommunicabilité telle qu’elle était traitée dans les années 70 – c’est plutôt la dimension de l’équivoque, corrélée à la communication même, c’est-à-dire à la relation à l’Autre. Ce qu’il a rencontré dans son expérience du camp était d’un autre ordre. C’était, pourrait-on dire en lisant son livre, la rencontre avec la langue réduite à sa dimension de pure violence sur le corps : « A distanza di quarant’anni ricordiamo ancora, in forma puramente acustica, parole e frasi pronunciate intorno a noi. […] Non ci ha aiutati a ricordarle il loro senso, perchè per noi non ne avevano. Erano frammenti strappati all’indistinto, frutto di uno sforzo […] di ritagliare un senso entro l’insensato »[5].
Peut-être retrouvons nous cette dimension extrême dans l’expérience de la victime en général quand est aboli le recours d’un lien à l’Autre du langage, réduit à l’occasion à sa dimension « purement acoustique », ce qui produit un être dans une détresse absolue. D’où sans doute l’importance – pas seulement pour Primo Levi et les autres survivants des camps, mais aussi pour d’autres victime – de pouvoir témoigner, de pouvoir faire acte de parole et ainsi retrouver avec la parole, le lien à l’Autre qui s’était interrompu.
Peut-être la racine de l’horreur et de la haine se situe t-elle dans le fait qu’une victime dévoile d’une manière traumatique le réel en jeu dans la relation à l’Autre.
[1] Levi P., I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986.
[2] Ibid., p. 5. « Alors même que quelques preuves pourraient rester et certains d’entre vous survivre, les gens diront que les faits que vous racontez sont trop monstrueux pour être crus […] L’histoire des Lager, c’est nous qui allons la dicter ».
[3] Ibid., p. 83.
[4] Ibid., p. 68.
[5] Ibid., p. 73. « Quarante ans plus tard, on se souvient encore, sous une forme purement acoustique, des mots et des phrases parlés autour de nous. […] Ce n’est pas leur sens qui a contribué à ce souvenir, parce que pour nous, ils n’en avaient pas. […] C’était des fragments arrachés à l’indistinct, le résultat d’un effort […] pour découper un sens dans l’insensé ».