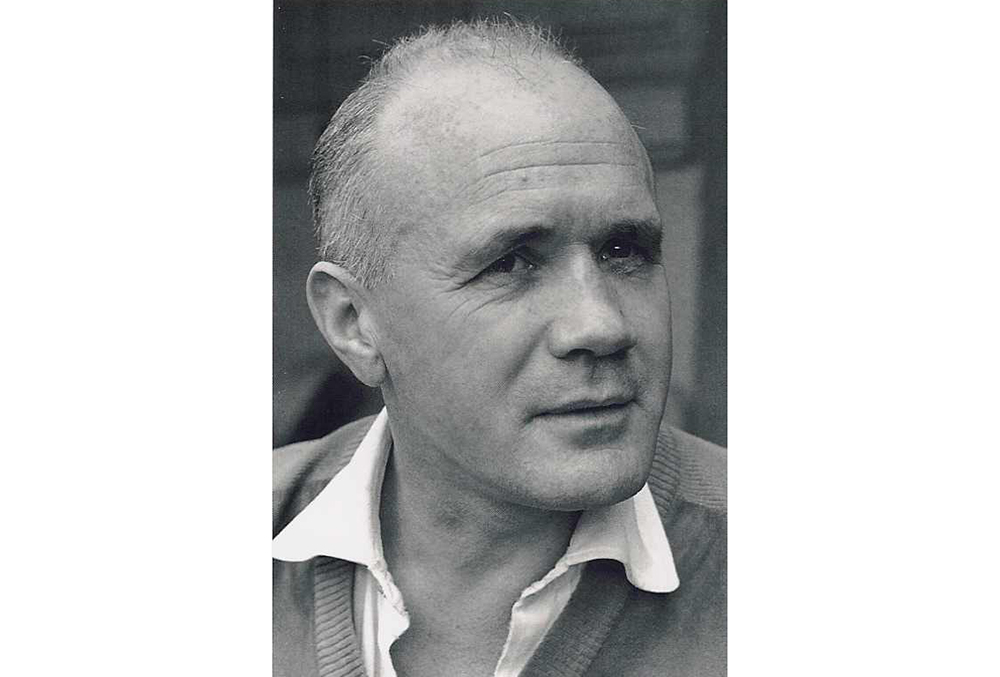« Psychanalyse et cinéma » à Nice
L’ACF-ECA a eu l’honneur et la joie d’accueillir Gérard Wajcman à Nice, le samedi 28 mars, pour la première projection-débat de l’année organisée par le cartel « Psychanalyse et cinéma » autour du film d’Andrew Niccol : Bienvenue à Gattaca.
G. Wajcman qui a écrit que « le monde est une série ininterrompue de crimes »[2], ce que corrobore notre actualité, n’a pas manqué de souligner l’hommage rendu à Edmond Locard, l’inventeur de la criminalistique, et son principe : tout criminel qui agit laisse une trace de son passage. Le film débute sur la façon dont le héros procède pour effacer toute identification de son ADN. Mais un crime a lieu à Gattaca qui demande une enquête. Tout se transforme, comme ces ordures devenues soudain de précieux indices sur la scène du crime. La trace génétique et l’image falsifiées interrogent l’identité d’un sujet. Sur le plan judiciaire, l’identité s’est d’abord constituée par l’image, la photographie. Le rapport du sujet à son image a évolué avec les techniques. Si les portraits des peintres devaient être conformes à leurs modèles, ce rapport s’est inversé avec la photographie d’identité où le sujet doit ressembler à sa photographie. Les avancées de la science ont éloigné l’identité de l’image au profit des empreintes, digitales puis génétiques. Au cinéma, les inspecteurs de police ont tronqué leurs révolvers pour des cotons tiges.
L’image et le regard peuvent-ils être remplacés par la certitude des techniques biologiques d’identification ? Le héros a recours au piratage génétique, il utilise les marqueurs d’un autre. « Ce n’est pas toi qu’ils voient, ils ne voient plus que moi », dit celui qui lui prête son corps. Alors, ce n’est plus l’image qui trompe, mais la certitude qui aveugle.
Le débat s’est ouvert sur la question d’un désir plus fort que la science : est-ce une fiction ? Un réel ? Le héros est prêt au sacrifice de son propre corps pour réaliser son rêve : aller sur Titan. Pour Gérard Wajcman, qui débusque les récits d’une société jusque dans ses créations cinématographiques, c’est un « film de garçon » où le héros ne se laisse pas détourner de sa quête d’un ailleurs, fût-ce pour Uma Thurman !
Dans son commentaire, il a mis en valeur l’actualité de ce film (1997). La science, en place de maître des lois de la nature, ici par la sélection génétique des individus, prend la place d’un Dieu leibnizien qui calcule tout. Une conception bien loin du réel sans loi qui oriente la psychanalyse et de la question de l’inconscient qui se loge dans un petit détail, un ratage, mis en valeur, à la fin du film, par une remarque du médecin : « un droitier ne tient pas son “outil” de la main gauche ». Face à la perfection des machines à identifier l’ADN, ce médecin avait découvert, dès le début, d’un simple coup d’œil, l’usurpation d’identité sur laquelle est bâtie l’histoire. G. Wajcman pointe la place centrale de ce personnage qui sait voir ce que les machines ne détectent pas. Ce médecin n’est pas dupe, et choisit, délibérément, de ne pas dénoncer le héros. Une dimension politique se profile dans la trame du film avec ce personnage qui résiste à un système qui fonctionne sans aucune contestation, pas même celle du héros qui en a été la première victime.
Ce film glacial, « un zéro pointé au thermomètre de la jouissance » pour G. Wajcman, nous fait trembler par son eugénisme décomplexé, irréfutable parce que présenté comme porteur d’un monde meilleur. Il illustre aussi comment, quand le système symbolique ne tient plus, on se tourne vers le corps pour trouver des réponses. La vérité est située dans le corps, et l’on sait combien ce modèle s’impose : recherches sur le cerveau pour approcher l’inconscient, recherches paléoanthropologiques pour expliquer la vie sociale. Ici le salut passe par la perfection des corps.
[1] Ce texte reprend les thèmes développés lors de cette rencontre, C. Bonneau est le Plus-un du cartel et les membres sont : A. Ardisson, P. Bouda, M. Harroch, S. Kernachi, B. Lacasse.
[2] Wajcman G., Les Experts. La police des morts, PUF, Paris, 2012, p. 39.