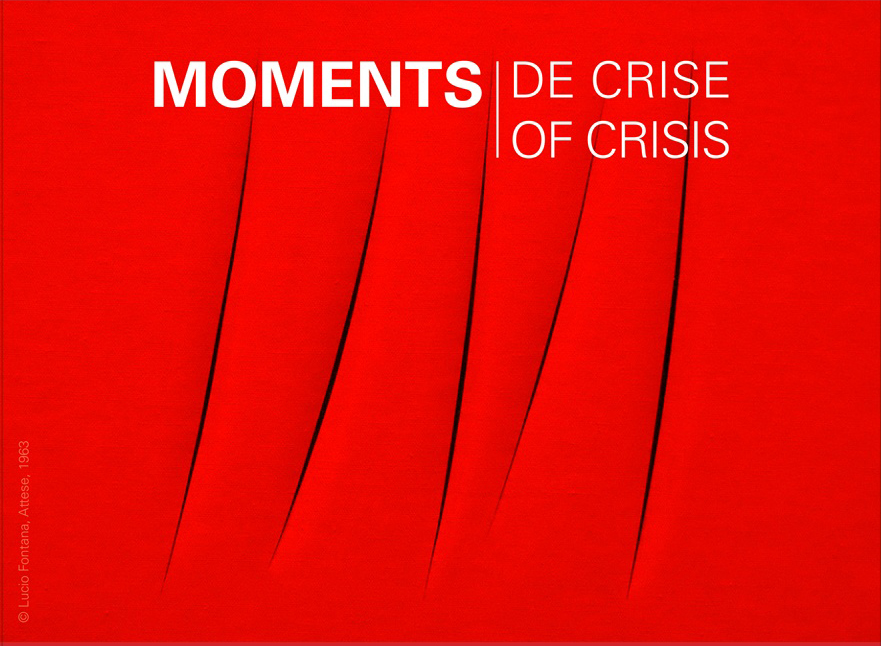Introduire un dossier sur ce mot « expressif d’ “escabeau” »[1] est un pari difficile. Une association qui fait résonner deux signifiants : escabeau et corbeau sera mon point de départ. C’est en m’avançant sur ce maigre fil que j’ai lu la séance du 27 janvier 1982 du cours de Jacques-Alain Miller « La clinique lacanienne ». Lors de cette séance, J.-A. Miller s’interroge sur « la passion » qui anime les enseignants, depuis la nuit des temps, à faire apprendre par coeur aux enfants la fable « Le corbeau et le renard » de Jean de la Fontaine. Il note : « Le flatteur est supposé être celui qui parle et l’Autre celui qui l’écoute. Mais l’essentiel de la démonstration concerne la voix. C’est finalement le corbeau qui veut montrer sa belle voix et c’est ce qui est là opératoire. L’important n’est pas tellement le discours du flatteur. »[2] Nous pouvons conclure que l’enjeu tourne autour de l’envie folle du corbeau de montrer sa belle voix.
Les animaux, dans les fables de Jean de la Fontaine, sont des parlêtres. Ils causent, ils ne font que ça. Dans les fables, ils hâblent. Si la jouissance du blabla est au rendez-vous, ils parlent aussi avec leur corps, comme tous les parlêtres. Se faire un corps, ici, passe par la belle voix. Il pense qu’il a une belle voix et il veut la montrer. Le corbeau veut que sa belle voix soit vue, si l’on peut dire. Lacan note dans son Séminaire Le sinthome : « L’amour-propre est le principe de l’imagination. Le parlêtre adore son corps, parce qu’il croit qu’il l’a. En réalité, il ne l’a pas, mais son corps est sa seule consistance – consistance mentale, bien entendu, car son corps fout le camp à tout instant. »[3] Le corbeau trouve consistance dans ce qu’il pense avoir : une belle voix. Il est perché sur l’idée d’avoir une belle voix. Imaginer qu’il a une belle voix, c’est son escabeau. Il jouit de sa voix.
Le lecteur connaît sans doute la fable de mémoire : « Maître corbeau sur un arbre perché, / Tenait en son bec un fromage ». La scène, reproduite mille et une fois dans les multiples éditions des Fables de La Fontaine, montre le corbeau se tenant fier sur la branche d’un arbre. Il règne posé en hauteur, de plus il tient un précieux objet dans son bec, un appétissant morceau de fromage. C’est à cet instant de fierté narcissique qu’arrive Maître Renard qui, « par l’odeur alléché », interpelle le corbeau. Le rusé renard se montre tout d’abord très poli et tente le corbeau pour qu’il lâche son bout de fromage. Il fait l’éloge de son corps beau : « Que vous êtes joli ! / Que vous me semblez beau ! » Des compli(ments) qui cherchent à flatter l’image du corbeau. Le parlêtre, nous apprend Lacan, « aime son image comme celui qui est le plus prochain, c’est-à-dire son corps »[4]. Un enjeu narcissique s’installe dès lors que le corbeau est happé par ce qui lui est dit. Il s’agit d’un narcissisme « où le corps est idolâtré dans un rapport de méconnaissance particulier », comme le relève Éric Laurent[5]
Lacan souligne que le corps, le parlêtre ne l’est pas, il l’a : « l’homme dit que le corps, son corps, il l’a. Déjà dire son, c’est dire qu’il le possède, comme un meuble, bien entendu »[6]. Le corbeau croit posséder sa belle voix. L’être se nourrit de paroles qui viennent combler un manque, un trou, le trou du trauma de la rencontre entre le corps et le langage. Ce trou, c’est le lot du parlêtre. « À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie », dit la fable. Et c’est de cette jubilation que se nourrit la ruse du renard : « Sans mentir, si votre ramage / Se rapporte à votre plumage, / Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » Le mot est lâché : ramage. C’est la question de la belle voix qui fait vibrer le Corbeau qui s’empresse d’ouvrir « un large bec » et laisse « tomber sa proie ». Ébloui par le sens, se croyant « un maître beau »[7], le corbeau s’y perd. « En croyant à son escabeau le parlêtre s’oublie pour se penser maître de lui-même, maître de son corps »[8], note É. Laurent.
Dans son texte d’orientation vers le prochain Congrès de l’AMP, J.-A. Miller introduit une différence entre l’escabeau et le sinthome. Existe t-il d’autres manières de faire avec le trou qui ne soient pas emprisonnées par les mirages du beau plumage ? Tel que l’indique Hervé Castanet, dans son étonnant ouvrage S.K.beau : « certains créent des mots, d’autres des images, d’autres encore des fictions utopiques […] Ce pas-tout visible […] pousse le peintre, le photographe ou le cinéaste à montrer. Pareillement pour l’écrivain, les mots ne disent pas tout. Ils sont aussi marques, traces, ratures de ce qui échappe à être dit… un mi-dit demeure ».[9] La tension entre la jouissance de la parole – côté pousse-au-sens – et le mi-dit semble être le cœur de l’enjeu. Vous connaissez la fin de la fable : « Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, / Apprenez que tout flatteur / Vit aux dépens de celui qui l’écoute. / Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. / Le Corbeau, honteux et confus, / Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. » La honte et la confusion ne serviront à rien à celui qui, sans une analyse, risque d’être pris à jamais par les mirages de son corps-escabeau.
[1] Miller J.-A., « Notice de fil en aiguille » in Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 209.
[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. La Clinique Lacanienne », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, leçon du 27 janvier 1982, inédit.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit., p. 66.
[4] Lacan J., « Le phénomène lacanien » – Conférence prononcée au Centre universitaire méditerranéen de Nice, le 30 novembre 1974, texte établi par J.-A. Miller, tiré à part des Cahiers Cliniques de Nice 2011. Citation extraite de l’argument de la soirée Enseignement de la passe, 13 janvier 2015, « L’adoration du Corps ».
[5] Laurent É., « Parler lalangue du corps », soirée Études lacaniennes, séance du 3 février 2015, http://www.radiolacan.com/fr/topic/470/3
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit., p. 154.
[7] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du Désir, Paris, Navarin Éditeur, n° 88, 2014, p. 111.
[8] Laurent É., « Parler lalangue du corps », op. cit., http://www.radiolacan.com/fr/topic/470/3
[9] Castanet H., S.K.beau, Paris, Éditions de la différence, 2011, p. 9.