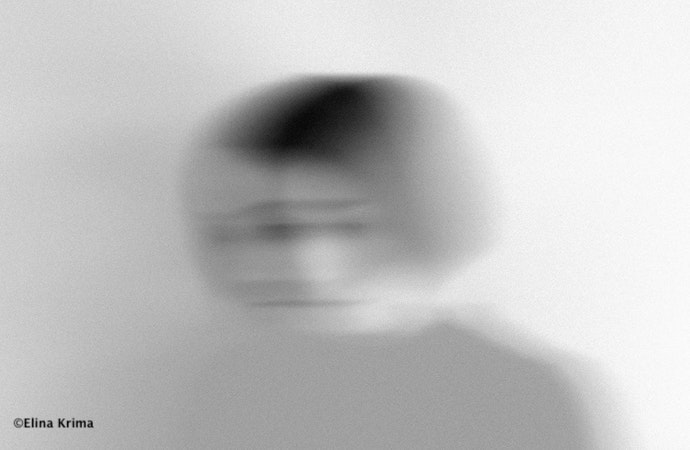« Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une Botte d’Asperges. Elles sont même restées ici quelques jours. Il n’y avait que cela dans le tableau, une botte d’asperges précisément semblables à celles que vous êtes en train d’avaler. Mais moi, je me suis refusé à avaler les asperges de M. Elstir. Il en demandait trois cents francs. Trois cent francs une botte d’asperges ! Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeurs ! » [1]
Cette scène fameuse d’un repas chez le Duc de Guermantes hors de lui dans À la recherche du temps perdu a été inspirée à Marcel Proust par l’histoire réelle d’un tableau d’Édouard Manet. Charles Ephrussi, grand collectionneur d’art, avait acheté à Manet, pour la somme de huit cents francs, une nature morte représentant une botte d’asperges, et lui avait fait parvenir un chèque supérieur à la somme convenue. En retour, Manet lui avait adressé un autre tableau représentant une seule asperge, accompagné de ce mot magnifique : « il en manquait une à votre botte ».
Georges Bataille épingle ce trait d’esprit pour faire valoir la nouveauté de Manet : « Ce n’est pas une nature morte comme les autres : morte, elle est en même temps enjouée » [2]. En effet, il ne s’agit en rien d’une vanité. L’œuvre de Manet n’est pas chargée d’une signification de cet ordre, ni d’aucune autre.
Les deux tableaux datent de 1880. Manet a 48 ans. Atteint d’ataxie, conséquence d’une syphilis contractée dans la vingtaine, il lui reste à peine trois ans à vivre. Diminué certes, mais plus sûr que jamais dans ses choix, il revisite la nature morte, qu’il tenait pour « la pierre de touche du peintre ». Dès les années 1860, notons que Manet s’est beaucoup consacré au genre. Admirateur des bodegones espagnols, des stelleven hollandais (les still life [3]), ou de Chardin, on peut repérer dans les peintures de cette période ces influences respectives.
La Botte d’asperges [4], elle aussi, fait référence à une de ces traditions, celle de la nature morte hollandaise du Siècle d’or, et plus précisément à un de ses représentants, tardif mais pas le moins grand, Adriaen Coorte [5]. De celui-ci, existent plusieurs tableaux dont l’objet central est une botte d’asperges. Et parmi eux, il en est un particulièrement remarquable, que Manet n’a pu qu’admirer en juillet 1852, date attestée de sa visite du Rijksmuseum d’Amsterdam.
On retrouve dans le tableau de Manet la simplicité extrême du tableau d’Adriaen Coorte : un seul objet sur un même fond sombre, une composition réduite à l’élémentaire, aucun apprêt : ni vaisselle ni nappe ni aucun autre fruit, fleur ou légume, si ce n’est la verdure sur laquelle repose la botte. Le dépouillement est pareil dans le second tableau, où l’unique asperge est disposée sur un marbre substitué au coin de table de cuisine en bois brut peint par Coorte.
Mais il y a plus. Dans le tableau de celui-ci, une asperge semble bien ne pas appartenir à la botte. La botte d’asperges peinte par Coorte repose donc, en déséquilibre, sur une seule asperge. Si bien que l’évidence nous frappe : le tableau du maître hollandais contient les deux tableaux peints par Manet : la Botte à 800 francs, payée 1000, et L’Asperge [6], qui manquait dans celle-ci, pour faire le compte.
Une asperge manquait dans le tableau livré à C. Ephrussi. C’est en somme l’asperge qui représente dans L’Asperge le sujet Manet auprès de la botte, dont en vérité il se décompte. Mais cette asperge manquait déjà dans la Botte d’asperges, dès avant que ce premier tableau fût livré à son acquéreur et qu’un prix fût convenu.
Soustraite dans un premier temps au tableau d’Adriaan Coorte, l’asperge manquante fait donc retour dans le second tableau, mais c’est pour faire signe de la fleur absente de tous bouquets chère à Stéphane Mallarmé [7]. Manet songeait-il à ce vers en exécutant L’Asperge ? Il est au moins un indice qui permet de penser à l’ombre de Mallarmé dans cette œuvre simplement « enjouée » comme disait Bataille : les tonalités du marbre sur lequel repose l’asperge sont en effet extraordinairement semblables à celles du mur à l’arrière du portait de Mallarmé par Manet quelques années plus tôt [8].
Étranges chemins de la création, épousant la structure du Witz, et tournant autour d’un objet foncièrement manquant. « Un peintre peut dire tout ce qu’il veut avec des fruits, des fleurs ou des nuages », professait Manet. Ainsi avec un simple citron, peint la même année que la Botte, histoire là encore de faire rire. L’allusion visait cette fois un critique qu’il n’appréciait pas, le citron désignant un « faux ami ». Bataille, encore lui, considérait que les portraits de Manet étaient en vérité des natures mortes. Le contraire est peut-être plus juste, et pas seulement dans le sens de la dérision.
Ainsi regardons cette unique asperge, à la tête qui semble se redresser, bander ses muscles, se tordre telle une anguille, comme dans cet autre très beau tableau du Musée d’Orsay : Anguille et rouget [9]. Manet fait bel et bien un portrait de cette asperge. C’est un nu plus qu’une nature morte. Ou plutôt c’est un nu et une nature morte, la turgescence vitale et l’hallali de cette anguille végétale. Et comme dirait Pascal Quignard, « les plaisirs du monde qui se retirent en nous disant adieu » [10].
[1] Proust M., « Le Côté des Guermantes », À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1999, p. 1130.
[2] Bataille G., Manet, Genève, Skira, 1955, p. 104.
[3] Bodegones, stelleven et still life servent à désigner, en espagnol, en hollandais et en anglais, le genre artistique principalement pictural que sont les natures mortes.
[4] Manet É., Une botte d’asperges, 1880, Musée Wallraf Richartz.
[5] Adriaen Coorte (Middelbourg, 1665-1707). Outre le tableau conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam évoqué ici, mentionnons : Asperges et groseilles rouges, 1696, National Gallery of Art (États-Unis) ; Asperges, fraises et groseilles, 1698, Dordrechts Museum ; et Asperges,artichaut et papillon, 1699, collection privée.
[6] Manet É., L’Asperge, 1880, Musée d’Orsay.
[7] « une fleur […], l’absente de tous bouquets » (Cf. Mallarmé S., « Avant-dire », in Ghil R., Traité du verbe, Paris, Chez Giraud, 1886, p. 5-7.)
[8] Manet É., Portrait de Stéphane Mallarmé, 1876, Musée d’Orsay.
[9] Manet É., Anguille et rouget, 1864, Musée d’Orsay.
[10] Cf. Quignard P., Tous les matins du monde, Paris, Gallimard, 1993.