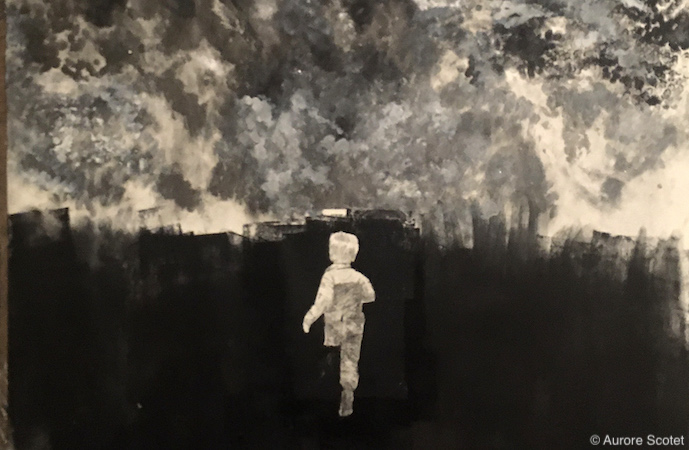La règle fondamentale offre à la parole de l’analysant un espace inédit de liberté. Il suffit cependant de le laisser parler assez longtemps pour constater qu’il dit non seulement toujours la même chose, mais qu’il le dit aussi toujours de la même façon et avec la même ferveur. Quelque chose se répète « de l’ordre d’une inertie, d’une polarisation, d’une orientation » [1] à laquelle Lacan donne à l’occasion « le nom de jouissance » [2].
On peut raisonnablement penser que cette polarisation tient aux signifiants que l’analysant a reçus et au sens qu’ils ont dans la langue qu’il parle. Il est cependant évident que cela ne suffit pas. Le bain de langage dans lequel il baigne dès avant sa naissance est aussi un bain de langue. Lacan le qualifie de « “lalangue” qui mérite d’être appelée, à juste titre, maternelle » [3]. Ce bain de langue véhicule un certain nombre de choses qui concernent notamment la manière dont il a été investi et désiré ou non. Le sujet en analyse parle de lui à partir de la place qui lui a été assignée. Il parle de lui d’une manière qu’on pourrait dire orale, anale, scopique ou invoquante.
La séance analytique s’avère être, au fil d’une analyse, le lieu d’une tension constante entre ce qui ne cesse pas de se créer du fait de la parole et ce qui ramène cette parole dans les mêmes sillons. Et il est légitime de se demander s’il est possible d’introduire « du nouveau » [4] dans cette conjoncture.
Une formule récente d’éric Laurent apporte un éclairage précieux sur cette question : « Extraire des dits nouveaux sur la jouissance suppose de pouvoir interpréter motériellement. » [5] Le terme de motérialisme inventé par Lacan désigne « la façon dont lalangue a été parlé et aussi entendu pour tel ou tel dans sa particularité » [6]. L’accent est mis ici sur la face réelle du signifiant. Il est mis sur ce qui se joue au joint de la matière sonore ou visuelle des mots et de l’impact que certains bouts de lalangue ont eu sur le corps.
La formule interpréter motériellement invite à concevoir et à pratiquer un usage du signifiant qui soit susceptible de toucher ce qui se joue de réel dans la parole elle-même. Cet usage que Lacan qualifie d’« extrême » [7] implique que soit rompue la parenté presque naturelle que la parole entretient avec le sens. Pour obtenir un effet de sens qui rejoindrait le réel, il faut aller « beaucoup plus loin que la parole » [8], prendre distance par rapport à elle et trouver dans cet intervalle de quoi faire jouer une interprétation [9].
Les mots que nous utilisons en parlant sont habituellement articulés les uns aux autres. Cette articulation confère à chacun d’eux un indéniable effet de suggestion [10]. Lacan soutient que c’est précisément cette « logique articulée » [11] du signifiant « qu’il nous faudrait surmonter » [12]. Se distancer de la parole veut dire alors toucher à la logique de contiguïté, de continuité ou de relation, qui articule les mots les uns aux autres, et ramener l’effet de suggestion du signifiant à son « fondement premier » [13]. Ce qui porte cet effet, ce n’est pas l’assise qu’un signifiant reçoit de son immersion dans une chaîne de signifiants. Ce qui le porte, c’est sa motérialité et partant l’écho qu’elle continue à offrir aux bouts de lalangue qui ont eu un impact sur le corps. L’intervalle qui peut s’ouvrir au sein de la parole elle-même, entre ce qu’elle dit et la matérialité réelle qui la supporte, se présente alors comme une opportunité dont une interprétation peut se saisir.
Pierre Malengreau
________________________
[1] Lacan J., « Conférence à la Columbia University », Scilicet, n°6/7, Paris, Seuil, p. 44.
[2] Lacan J., Je parle aux murs, Paris, Seuil, 2011, p. 29.
[3] Lacan J., « Conférence à la Columbia University », op. cit., p. 47.
[4] Miller J.-A., … du nouveau ! Introduction au Séminaire V de Lacan, Paris, ECF, 2000, p. 10.
[5] Laurent É., « Rire des normes », La Cause du désir, n°110, mars 2022, p. 97.
[6] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », La Cause du désir, n°95, avril 2017, p. 12.
[7] Lacan J., « L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre », Ornicar ? n°17/18, printemps 1979, p. 23.
[8] Lacan J., « R.S.I. », Ornicar ?, n°4, rentrée 1975, p. 96
[9] Lacan J., « Radiophonie », Autres écrits, Paris, Seuil, 2006, p. 428.
[10] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris 8, cours du 14 mars 2007, inédit.
[11] Lacan J., « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », op. cit., p. 16.
[12] Ibid.
[13] Laurent É., « Le traitement psychanalytique », in Miller J.-A. (s/dir.), La Conversation clinique, Paris, Le Champ freudien, 2020, p. 52.