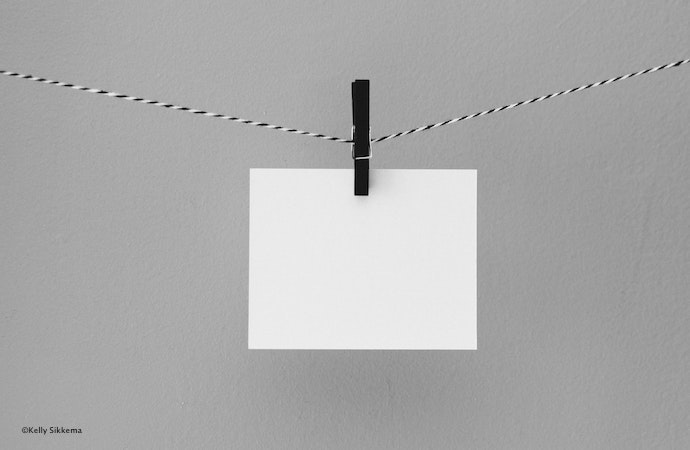[…] L’« identification fait […] lien social. […] Et c’est pourquoi Freud a pu glisser sans peine de l’analyse subjective à la Massenpsychologie » [*][1] : ce concept permet de saisir 1’articulation du sujet de l’inconscient à l’Autre comme champ, en un temps donné, une époque, un état des discours. À l’heure de la globalisation, de la remise en cause par le discours de la science et du capitalisme de la transmission et de la tradition, « [q]u’est-ce qui reste invariable […] et qu’est-ce qui change, quand l’Autre social […] fait désormais accueil [à des] norme[s] nouvelle[s] ? » [2] Quelles identifications se proposent au sujet ? […]
Captation imaginaire, réponse symbolique
L’identification est d’abord située par Lacan comme un phénomène par excellence imaginaire. C’est l’époque du « Stade du miroir… »[3], de « L’agressivité en psychanalyse » [4], du moi idéal, des images et mirages de l’identification narcissique. Elle se verra – à l’instar de bien d’autres concepts centraux, comme le souligne J.-A. Miller – progressivement dégagée dans sa valeur symbolique. L’identification n’est dès lors plus seulement « captation » du sujet par l’image, mais implique les trois registres imaginaire, symbolique et réel.
« L’assise pulsionnelle » des identifications
En 1921, dans le chapitre VII de sa Massenpsychologie, Freud indique que l’« identification est connue de la psychanalyse comme expression première d’un lien affectif à une autre personne. Elle joue un rôle dans la préhistoire de l’Œdipe » [5]. « Simultanément à cette identification au père, ajoute-t-il, […] le garçon a commencé à effectuer un véritable investissement objectal de la mère » [6]. Freud souligne ainsi que le sujet « présente donc alors deux liens psychologiquement différents, avec la mère un investissement objectal nettement sexuel, avec le père une identification exemplaire » [7]. Ces deux champs conflueront par la suite vers le complexe d’Œdipe.
En distinguant investissement d’objet et identification, Freud vise à articuler « l’assise pulsionnelle » de ce qui « régit de façon déterminante la vie psychique » [8]. S’appuyant sur la clinique, il indique soit que « l’identification prend la place du choix d’objet » (quand Dora imite symptomatiquement la toux du père, par exemple), soit qu’elle « se fait à l’objet » (homosexualité masculine) ou encore que « l’ombre de ce dernier tombe sur le moi » (mélancolie), etc. Comme l’indique J.-A. Miller, l’identification se révèle donc « impensable » sinon « sur le fond de la relation d’objet » [9] et de la satisfaction que le sujet y trouve.
La première identification freudienne au père primitif, par exemple, une fois tamponnée par l’opération du Nom-du-Père, « laisse des traces dans les exigences d’un Surmoi, parfois “obscène et féroce” » [10]. De même, la toux de Dora, qui relève de l’identification à un trait prélevé sur le père comme objet d’amour, ne laisse pas quitte le sujet de cette marque de jouissance. Enfin, dans son article sur « Le racisme 2.0 » [11], Éric Laurent nous fait saisir, au sujet de la troisième identification freudienne, qu’une foule stable, telle l’armée par exemple, peut comporter en elle-même une exigence de jouissance illimitée, telle celle de la horde… Saisir l’assise pulsionnelle de l’identification peut éclairer le reste de l’opération identificatoire.
L’identification « multiple et impossible »
« L’effacement des grands récits identificatoires et la multiplication des petites histoires mettent en évidence les paradoxes de l’individualisme démocratique de masse » [12], indique É. Laurent dans L’Envers de la biopolitique. Les grands repères, comme l’Idéal du moi du sujet, ont une « fonction essentiellement pacifiante » [13]. Ils comblent le manque-à-être du sujet, répondent à sa division structurale. Quand l’assise même de l’Autre de la tradition et de la transmission vacille sur ses bases, quand le discours de l’Autre apparaît toujours davantage pluralisé, éclaté, multiple, que devient l’identification ? « Que se passe-t-il lorsque l’inconsistance descend au niveau de l’identification ? » [14]
Lacan et J.-A. Miller nous donnent, de ce point de vue, des repères : « l’idéal, comme le rappelle É. Laurent, apparaît toujours présent dans son exigence, mais ne trait[e] plus la jouissance dont il s’agit » [15], laissant toujours davantage le sujet aux prises avec sa jouissance autistique, celle des Uns-tout-seuls… « C’est l’enjeu de la proposition de Lacan, souligne É. Laurent : passer d’un régime de l’inconscient fondé sur l’identification, […] à un inconscient fait des équivoques par lesquelles le corps déchiffre le traumatisme en tant que lieu d’où émergent la jouissance et son scandale » [16].
Une cure analytique révèle donc que « tandis que se déroulent les identifications qui ont tramé l’histoire du sujet, […] non seulement l’identification est multiple, mais, surtout, qu’elle est impossible. […] La séparation d’avec l’Autre ne gîte pas dans la chaîne signifiante, même réduite à son trognon. Il reste impossible au sujet de se signifier lui-même » [17]. Elle permet de mettre le doigt sur ce point, crucial pour le sujet comme pour l’Autre : « tout ensemble humain comporte en son fonds une jouissance égarée, un non savoir fondamental sur la jouissance qui correspondrait à une identification » [18].
[*] Version réduite et revue d’un texte initialement publié dans les actes 2016-2017 du bureau de Rennes de l’ACF-VLB, Suites & Variations.
[1] Miller J.-A., « L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique », La Cause freudienne, n°35, février 1997, version CD-ROM, Paris, Eurl-Huysmans, 2007, p 8.
[2] Ibid.
[3] Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 93-100.
[4] Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse », Écrits, op. cit., p. 101-124.
[5] Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi » (Massenpsychologie), Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 167.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Laurent É., « Le racisme 2.0 », Lacan Quotidien, n°371, 26 janvier 2014, publication en ligne.
[9] Miller J.-A., in Miller J.-A. & Laurent É., « L’orientation lacanienne. L’Autre qui n’existe pas… », op. cit., cours du 27 novembre 1996.
[10] Stevens A., « Deux destins pour le sujet : identifications dans la névrose et pétrification dans la psychose », Les Feuillets du Courtil, n°2, mai 1990, disponible sur internet.
[11] Laurent É., « Le racisme 2.0 », op. cit.
[12] Laurent É., L’Envers de la biopolitique. Une écriture pour la jouissance, Paris, Navarin, 2016, p. 9.
[13] Miller J.-A., in Miller J.-A. & Laurent É., « L’orientation lacanienne. L’Autre qui n’existe pas… », op. cit., cours du 27 novembre 1996.
[14] Ibid., cours du 4 décembre 1996.
[15] Laurent É., in Miller J.-A. & Laurent É., « L’orientation lacanienne. L’Autre qui n’existe pas… », op. cit., cours du 4 décembre 1996.
[16] Laurent É., L’Envers de la biopolitique, op. cit., p. 69.
[17] Laurent É., « La passe et ses restes d’identification », La Cause freudienne, n°76, décembre 2010, p. 46, disponible sur Cairn.
[18] Laurent É., « Le racisme 2.0 », op. cit.