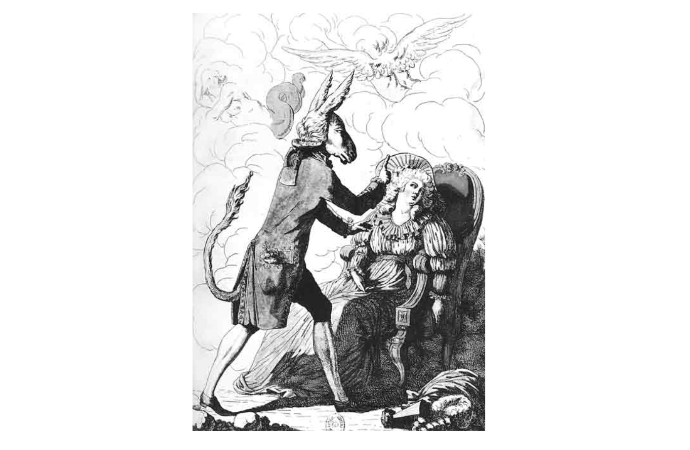Pour qui s’y engage, l’expérience analytique est une épreuve. Freud en témoigne dans sa difficulté d’éclairer ce qu’il en serait d’une fin possible de la cure analytique dans « Analyse finie, analyse infinie »[1]. Lacan le souligne dans « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien » : « Ce que le névrosé ne veut pas, et ce qu’il refuse avec acharnement jusqu’à la fin de l’analyse, c’est de sacrifier sa castration à la jouissance de l’Autre (…) qui ne l’oublions pas n’existe pas. Oui, mais si par hasard il existait, il en jouirait. Et c’est cela que le névrosé ne veut pas. Car, il se figure que l’Autre demande sa castration »[2]. Refus acharné du névrosé jusqu’à la fin ! Le prix à payer est donc à la mesure de son refus.
Engagement dans la cure et refus acharné semblent antinomiques mais pas si l’on considère que l’analysant doit s’engager à rendre compte des coordonnées de ce refus. Ceci selon une temporalité qui lui est propre. « Faut le temps »[3] nous dit Lacan dans « Radiophonie » à propos de ce temps logique. Et il précise : « C’est ainsi que l’inconscient s’articule de ce qui de l’être vient au dire »[4]. Ouverture, fermeture de l’inconscient donc. Pour l’analyste, il s’agit de maintenir toujours en tension ce qui d’un dire de l’analysant peut surgir. Cela suppose qu’il ne se laisse pas prendre dans les rets des dits, fussent-ils énoncés en toute bonne foi. Pour l’analysant, croire à ses dits, combien de foi(s), de tours, de dits, détours-dits, assez dit ! L’analysant tente, à partir de ces tours de déchiffrage, de trouver sa vérité. Il cherche à donner une explication à ce qui grince, insiste, fait symptôme. Puis les tours dits sur le divan le conduisent à se confronter à ce qui lui avait servi jusqu’alors de bouchon, le fantasme. Le fantasme qui règle l’expérience de jouissance dans l’inertie et la répétition. On s’appuie dessus, longtemps, on s’y mure. Il se construit pas à pas dans la cure en déroulant la chaine signifiante. Et vient le moment, un éclair, qui conduit l’analysant à apercevoir subitement ce qui gouvernait sa vie. C’est comme un voile qui se déchire, un écran traversé, une fenêtre qui s’ouvre sur le réel. L’équilibre du sujet ordonné par le fantasme bascule alors. Moment de destitution subjective, de désêtre d’où surgit le désir de l’analyste. Saisir ce qui sous-tendait la logique de son existence a des effets lumineux, enthousiasmants. Virage et mirage car il faut encore à l’analysant prendre la juste mesure de ce qu’à l’Autre et au rapport sexuel qui n’existent pas vient faire bord le fantasme comme construction imaginaire. Saisir la fonction de leurre du fantasme. Encore des tours !
« Le témoignage essentiel des mystiques c’est justement de dire qu’ils l’éprouvent mais qu’ils n’en savent rien »[5], nous dit Lacan, à propos d’une jouissance qui serait autre, au-delà du signifiant phallique. Manière de viser la part d’insu qui insiste et échappe, au cours de l’expérience analytique ? En dehors de l’éprouver, d’en être affecté, on ne pourrait donc rien en dire ? Un dire est possible et nécessaire pour contenir cette jouissance, la pacifier, l’apprivoiser. Mais tout n’est pas traitable par le sens. Car, si le symptôme comporte des effets de sens, susceptibles d’être interprétés, il comporte aussi une fixation de jouissance qui se satisfait dans la répétition : une lettre de jouissance dont la trace se trouve dans le corps et qui se répète, identique à elle-même, et fait énigme. L’addiction est à la racine même du symptôme, nous dit J.-A Miller dans son texte « Lire un symptôme » : « on boit toujours le même verre une fois de plus »[6], « on a bouffé toute la pomme imaginaire, on dit qu’il n’y a plus rien à dire, on jette le trognon, mais le trognon est là ; et ce trognon est un peu boomerang, il nous revient dans la figure »[7]. Pas moyen de venir à bout de ce symptôme donc ! Et pas-toute la jouissance du symptôme ne peut être déchiffrée. Une part irréductible au sens est réelle, aussi indéchiffrable qu’irréductible. L’étourdit-sens qui a animé le sujet rencontre soudain ce hors sens indéchiffrable, ininterprétable. Moment où s’isole le réel du sinthome avec lequel se débrouiller. Moment étourdissant du côté de l’excès de lalangue… non articulable. Etourdit-se-ment du sujet qui entrevoit le mirage de la vérité. Ce qui s’était dévoilé, difficilement, ce qu’il avait saisi de ce qui marque sa différence, sa singularité-même s’avère une vérité menteuse !
Poussé par le désir d’en communiquer quelque chose à la communauté analytique, l’analysant se risque à en témoigner, dans la Passe. Il s’avance, dès la première rencontre avec les passeurs, sans texte préalablement établi, se heurtant alors à une nouvelle difficulté : Quoi dire ? Comment le dire ? Comment élucubrer un savoir, à partir des petits restes de l’expérience, séquences, rêves, interprétations ?
Nommé A.E., il tente de cerner, serrer chaque fois un peu plus, ce qui échappe, toujours… Car, si la morsure du réel devient plus effective à chaque nouveau tour, il n’en demeure pas moins « qu’il ne peut s’approcher qu’entre les lignes »[8]. Cerner le trou, du fond duquel il ne s’agit plus d’attendre un don du ciel et autour duquel les témoignages successifs ne cessent de tourner, est une « opération qui relève du transfini »[9].
Alors rêve ou folie ? L’A.E. ne délire-t-il pas un peu en s’évertuant à essayer de transmettre l’impossible à transmettre ?
Probablement, mais sans doute s’agit-il aussi pour lui d’un effort pour tirer les conséquences d’une expérience qui l’a transformé radicalement, et dont la satisfaction conclusive ne vient justement que de l’aperçu qu’il a pris du réel d’un savoir joui qui résiste à la vérité. Consentir à l’épreuve du réel, avoir pris la mesure de l’impossible à garantir aucune vérité : il en fait cette trou-vaille, celle par laquelle c’est le non-su qui ordonne le cadre du savoir[10]. Le non-su dès lors n’est plus source d’horreur mais source du désir de savoir, point vide à partir duquel le sujet s’offre à ce qu’on pourrait appeler la « liberté lacanienne » : liberté de dire et d’agir, de penser, de faire silence, sans inertie ni suffisance.
[1] Freud S., « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », Résultats, idées, problèmes, Paris, PUF, 1985.
[2] Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.826.
[3] Lacan J., « Radiophonie », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p.426.
[4] Ibid.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1975, p.71.
[6] Miller J.-A., « Lire un symptôme », Mental, n°26, Paris, Huysmans, août 2011, p.58.
[7] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Etre et l’Un », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII, leçon du 9/02/2011, inédit.
[8] Laurent E., « Ce qui sert (serre) la psychanalyse », La Cause freudienne, n°48, Paris, Navarin/Seuil, juin 2001, p 31.
[9] Solano E., « L’expérience clinique et politique de l’École », La Cause freudienne, n°42, Paris, Navarin/Seuil, mai 1999, p 22.
[10] Lacan J., « Proposition du 9 octobre1967 », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.