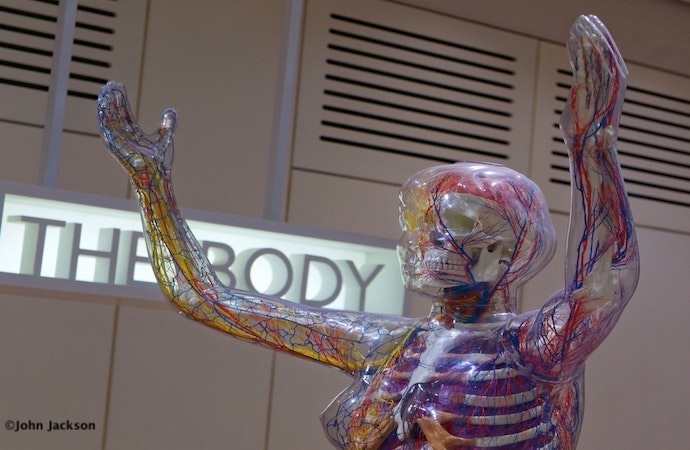Pas plus qu’avoir un corps, éprouver des affects ne va de soi. Le type d’indifférence qu’on connait à Joyce, et que l’épisode de la raclée illustre spécialement, n’est pourtant pas universel, tant s’en faut. Une courte vignette clinique nous le montrera. Mais revenons un moment à Joyce et à son rapport aux affects pour mettre en valeur la fonction de l’indifférence dans ces deux cas.
Joyce
La pensée de se faire tourmenter en classe, dévêtu, par un camarade efféminé, suscite chez Joyce un plaisir étrange qui le fait frissonner. S’associe à ce fantasme le souvenir de scènes de fustigation par des prêtres. Ces souvenirs lui reviennent d’autant plus facilement que leurs menaces, qu’il ressent sans danger pour son intégrité corporelle, leur donne un air stupide. Mais le souvenir d’un mendiant menaçant les enfants doit, lui, être chassé, car la cruauté de son regard le terrorise comme s’il y avait là un péril qui pouvait l’atteindre dans sa chair.
Joyce se laissait tourmenter plus souvent qu’à son tour, notamment par Connolly qui traquait les aveux de sa vie amoureuse et lui extorquait le nom de ses poètes favoris. Il se souvient de sa lâcheté méchante lors de l’épisode de la raclée. Mais, très vite, il se sent surtout dépouillé de sa colère comme un « fruit se dépouille de sa peau tendre et mûre » [1]. Cette fois-là, il ressent seulement du dégout, pas la moindre jouissance, comme Lacan le relève. L’indifférence de Joyce est originaire et définitive comme tend à le montrer le souvenir d’une autre punition injuste – des coups de fouets sur les mains, administrés par le préfet d’études – qui l’avait déjà plongé dans un excès de frayeur secouant tout son corps et durant lequel il avait plaint ses mains « comme si elles n’étaient pas à lui, mais à quelqu’un d’autre » [2]. Une fois l’humiliation passée, il n’en voudra pas plus à ce préfet qu’à Wells de lui avoir plongé la tête « dans le fossé des cabinets » [3].
Si l’amour et la haine, décrits dans les livres qu’il lit, ont peu de réalité pour Joyce, c’est qu’ils sont toujours éprouvés trop furtivement pour se constituer en passion durable. Faute de rencontrer l’amour qui le transfigurerait en lui permettant de surmonter sa faiblesse, sa timidité et son inexpérience, il renouvelle sans cesse le choix de la femme humiliée qui le laisse trop vite indifférent, mais lucide. Il jouit ainsi lui-même de tourmenter l’autre en lui prouvant son égoïsme. Quand il se plaint de l’Autre indifférent qui voisine avec l’Autre méchant, c’est pour mieux faire l’impasse sur sa propre indifférence qui lui permet de neutraliser ses passions. Aussi, ce qui apparait comme son égoïsme indéracinable et rédempteur le rend insensible au destin de la nation. Notons toutefois que si l’indifférence de Joyce trouve une limite, elle se rencontre dans son rapport à la langue : on le sait sensible à l’ignominie d’un vers.
Jean
Jean s’est effondré, il y a deux ans, à la suite d’une chute dans la rue. L’immobilisation longue qui s’en est suivie lui donne le sentiment que la vie le laisse tomber. Avant cette chute, et en dehors de moments très épisodiques, il s’était toujours senti protégé par la vie. Depuis, ça ne va plus. Il retrouve alors en séances le souvenir d’un double laissé tomber dont il a pâti très jeune quand sa mère a failli perdre la vie et que son père en a profité pour quitter la maison. Il apparaît également que son usage du silence le préserve depuis toujours d’une séparation d’avec sa mère qui ne supportait pas une sœur trop bavarde et l’avait éloignée de la maison.
Deux effets notables surviennent alors : d’une part, il éprouve ce qu’il nomme « des émotions directes » et, d’autre part, il renouvelle son lien à son fils. Jusque-là, il n’éprouvait les émotions qu’après-coup. Il ne pouvait ainsi « vider son sac que hors émotion ». Il n’est donc plus indifférent. Au moment même où un corps vivant s’attache à lui, son rapport au temps change également. Il peut désormais anticiper la séparation d’avec son fils sans se sentir laissé en plan.
Joyce a un corps. Jean, pas. Leur indifférence n’est pas la même. Pour Joyce, cette indifférence originaire signale la perte du corps qu’il a, alors que la même indifférence témoigne de ce que Jean n’en a jamais eu du fait de la forclusion. L’égo indéracinable de Joyce répare la faute, alors que Jean, qui n’a pas d’autre ego salvateur que son fils, peut basculer en place de déchet. La version du père de Joyce, en passe par un amour conditionnel pour le père, alors que Jean ne pardonne pas au sien de l’avoir laissé tomber. Pour Jean, le rejet concomitant du souvenir et de l’affect concerne un point de forclusion. Il n’en est pas question pour Joyce qui chasse le souvenir tandis que l’affect tend à se détacher. Le détachement est autre chose qu’un point de forclusion.
[1] Joyce J., « Portrait de l’artiste en jeune homme », Œuvres, t. I, 1901-1915, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1982, p. 611.
[2] Ibid., p. 580.
[3] Ibid., p. 544-545.