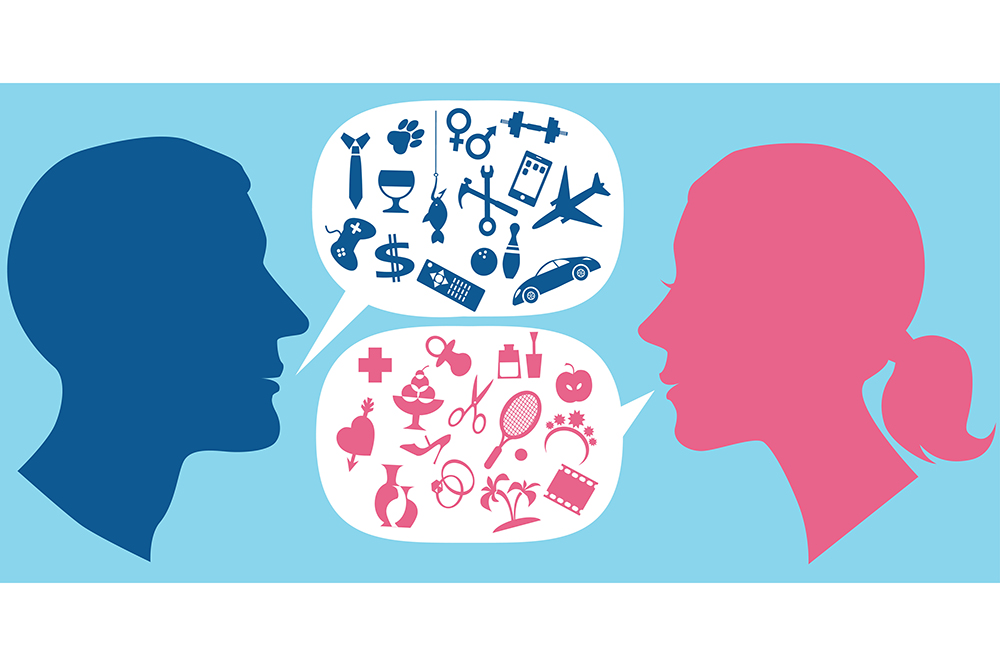« Adolescents, sujets de désordre », une interview croisée de M-C Ségalen , A. Oger et J.-N. Donnart
A l’adolescence, il est moins question de symptôme que d’évènement qui fait discontinuité. L’accueil de cette discontinuité – reflet de...
Lire la suiteDetails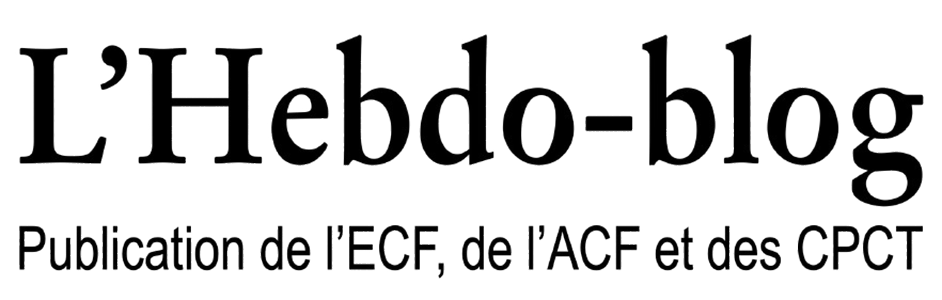


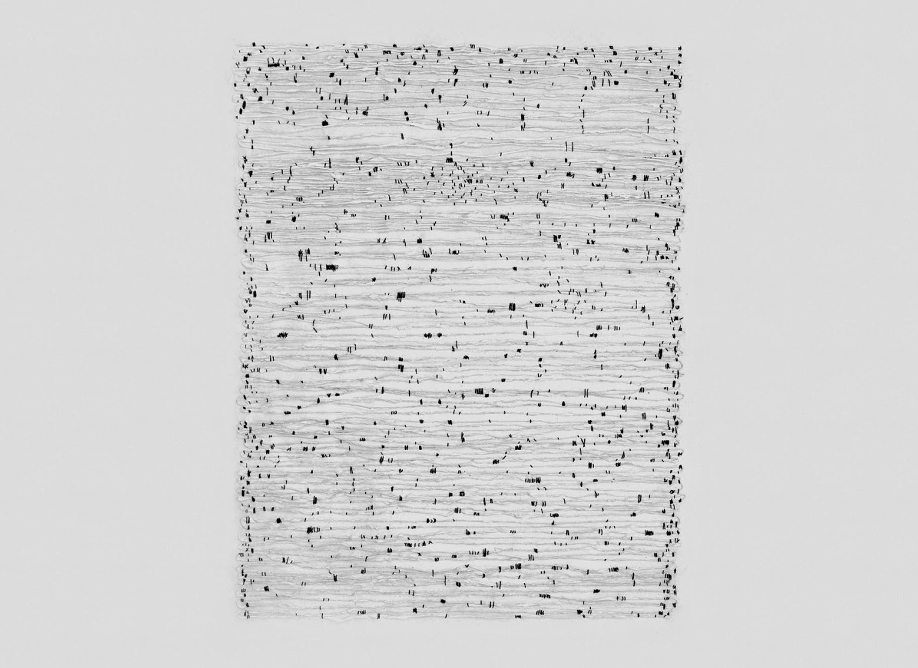

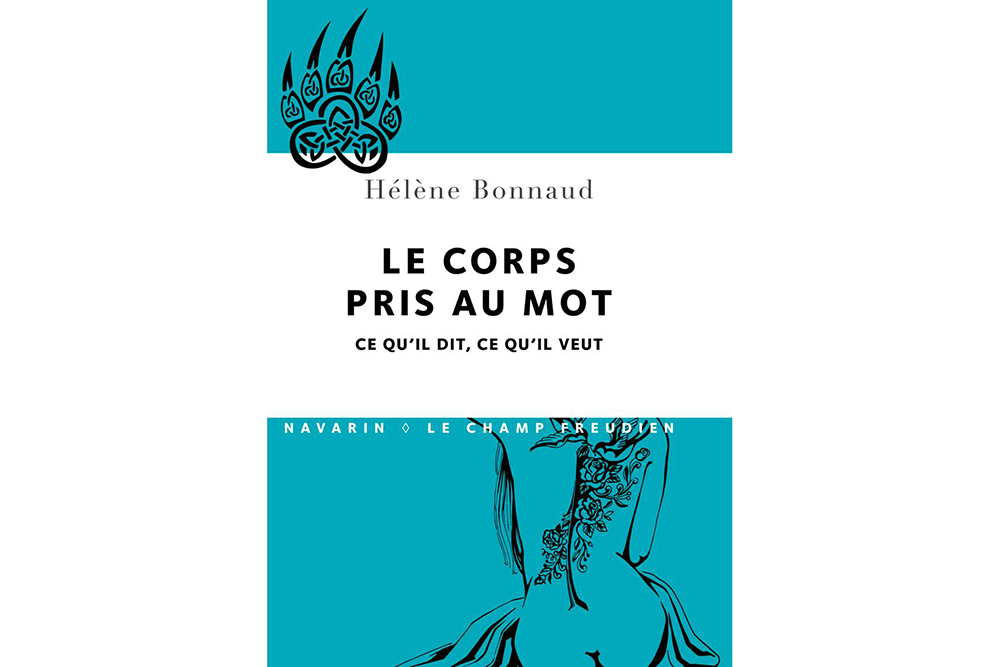
![Le corps pris au mot[1] Hélène Bonnaud répond aux questions de Marie-Christine Baillehache](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/09/BonnaudHD.jpg)
![Entretien avec François Ansermet à propos de son livre La fabrication des enfants, un vertige technologique[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/07/AnsermetHD.png)