Extensions du domaine de la guerre : sous ce titre s’est tenu, à la Comédie de Reims, un colloque résultant de la collaboration inédite entre trois institutions : l’ESAD, l’URCA et l’ACF-CAPA. L’affiche, réalisée pour le colloque par Kevin Zanin[1], est centrée sur un tube d’anthrax exhibé par Colin Powell, en 2002 à l’ONU, avec l’intention sursignifiée de maîtriser une épidémie mondiale et mortelle.
Épidémique la guerre l’est en effet, endémique même, car toujours déjà là, en germe, précédant tout discours, en tant que pour l’être humain parler veut dire consentir à une perte de jouissance qui se transforme à la première occasion en un ferment de ressentiment, d’envie, de haine, ferment de guerre donc.
Grande intensité tout au long de cette journée du 15 avril à la Comédie de Reims, pour décliner les extensions de la guerre dont l’absence de limites inquiète. Cette journée fut animée par le désir décidé de montrer, d’attraper, de dire le réel en jeu, plutôt que de se laisser captiver par lui.
Des moyens d’en découdre
L’actionnisme viennois est évoqué d’abord par Maud Benayoun[2]. Avec leurs actions tonitruantes, leurs happenings dans les années soixante, les actionnistes sont objets de scandales, de répression et d’exil. Pour Otto Mühl, il s’agit de sortir du bourbier. Ils sont galvanisés par la pensée de Wilhelm Reich et veulent donner à voir les racines pulsionnelles de la culture. Seule vaut l’abréaction qui est recherchée dans une surenchère de provocations.
Le photographe d’art Emeric Lhuisset[3] présente un travail d’une tout autre texture, à partir de la photographie comme preuve d’un réel en jeu dans les scènes sur lesquelles il intervient aux côtés des combattants, en Syrie et en Colombie notamment. Preuve d’un réel qui lui permet d’opérer une distinction entre exactitude et vérité de l’image. Il s’expose, se déplace, invente pour chaque nouvelle situation un dispositif singulier : une micro caméra fixée sur la poitrine du combattant, comme un œil supplémentaire, et en avant ! L’œil voit autre chose que le photographe et autre chose que le combattant. Avec ce subterfuge, il met en scène ce qui, sans son acte, se serait sans aucun doute joué autrement : « Mon appareil photo est une arme plus puissante que ta kalachnikoff ! »
Yves Depelsenaire[4] et l’Artilleur
« J’aime tellement les arts que je suis devenu artilleur. », dit Guillaume Apollinaire. C’est d’abord Guillaume et Lou, les éclats d’obus, et la troublante séduction de la guerre, son érotique, sa joie sauvage. Car « déplacer la guerre hors de l’humanité est une erreur. La jouissance de tuer et de se faire tuer est le fait du sujet humain, et fait déchanter. Aujourd’hui le déferlement d’images irréalise la guerre, et l’on peut se demander de quoi tout cela est le symptôme. Nous ne savons plus où est la jouissance dont nous orienter, dit Y. Depelsenaire.
« Nous n’avons plus à notre disposition que le rejet pulsionnel de la jouissance de l’autre, qui conduit logiquement à une volonté d’anéantissement de l’autre ». Sombre menace donc.
Genet
Avec Hervé Castanet[5], c’est la guerre de Jean Genet qui monte sur la scène. Un grand écrivain, animé par de grands engagements – Black Panthers, Fraction Armée Rouge, Palestiniens – qui le traversent et qu’il sert, en éternel vagabond comme il se dit lui-même, clochard supérieur. Corps vivant et parlant, mais d’abord corps jouissant. Qui ne méconnaît pas ce que Lacan désigne comme point de saloperie de tout un chacun, avec lequel il n’est jamais question de faire ami-ami. La thèse d’H. Castanet, forte, dépliée pour nous, est celle d’un nouage qui fait de Genet celui qui trahit la trahison même.
Vient ensuite Sylvie Blocher[6] qui présente, sur la scène de la Comédie de Reims, son extraordinaire lutte avec les corps réduits à l’esclavage, aux esclavages divers et infinis : au moyen de ses installations avec lesquelles elle met en scène des figurants, elle parvient, à leur grande surprise, à « faire tomber quelque chose des corps », selon son expression.
Le point d’orgue de la journée
Marie-Hélène Brousse[7] développe une question subsidiaire : « comment se dégager de cela ? », autour de deux axes, serrés dans l’ouvrage collectif La psychanalyse à l’épreuve de la guerre.
– Pas de guerre sans discours.
– La guerre est un mode de jouir humain, fondamental.
« Aujourd’hui la guerre est tout le temps et partout. Et force est de constater que quelque chose a changé du côté de ce qu’est un bord, une frontière ».
Quelque chose avec quoi il faut apprendre à faire, parce que nous n’avons pas le choix : faire avec ce nouveau symptôme de notre civilisation.
[1] Zanin K., Étudiant en design graphique à l’ESAD de Reims.
[2] Benayoun M., Directrice de la collection Voix, livres d’entretiens avec des artistes contemporains BOOKSTORMING, en cours : livre avec Sylvie Blocher.
[3] Lhuisset E., Photographe, dont on peut citer notamment : Photo-eye, Best Books 2014 : Markus Schaden, (web, 2014), nominated by Maison Européenne de la Photographie for Casa de Velasquez. Leica Oskar Barnack Award 2014 (nominated). Prix HSBC pour la photographie 2014 (nominated).
[4] Depelsenaire Y., L’Envers du décor, ou l’art de la guerre, toujours recommencée, Nantes, Éd. Cécile Defaut, 2013.
[5] Castanet H., Le savoir de l’artiste et la psychanalyse. Entre mot et image, (suite), Nantes, Éd. Cécile Defaut, 2009.
[6] Blocher S., artiste, site sylvieblocher.net, La décolonisation du moi, Les utopies de la modernité sont achevées, Une gymnastique de l’altérité, etc.
[7] Brousse M.-H., sous la direction de, ouvrage collectif, La psychanalyse à l’épreuve de la guerre, Éditions Berg International, 2015.






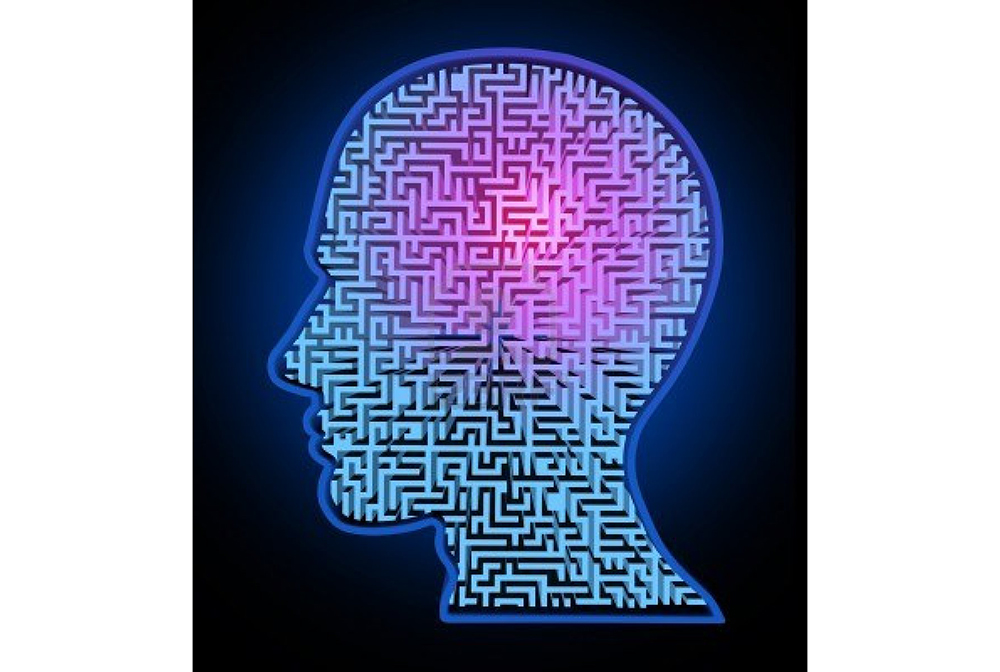
![Reality[1] ou une inquiétante étrangeté](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/05/PontecailleHD.jpg)
