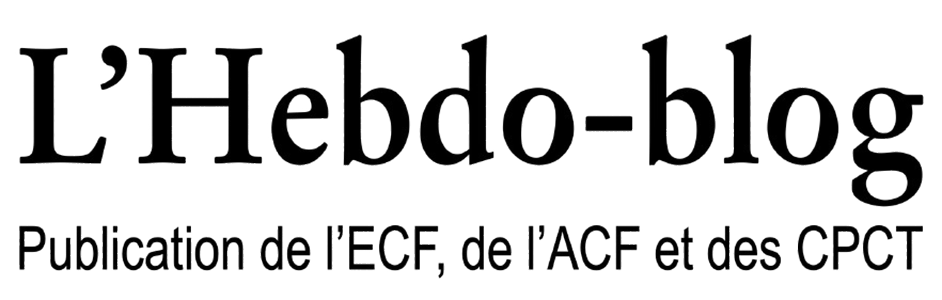Dans Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud fait de la sublimation l’un des destins de la pulsion. Il la distingue du symptôme, produit du refoulement. Deux voies semblent donc opposées. Cependant Lacan nuance cette coupure, notamment dans son Séminaire XXIII où il esquisse l’idée qu’un symptôme ramené au sinthome – façon singulière de traiter la jouissance – puisse relever d’une forme de sublimation.
Du message au nouage
Au fil de son enseignement, Lacan redéfinit le symptôme. De message au champ de l’Autre, il devient modalité du rapport au réel, lieu de nouage entre symbolique, réel et imaginaire. Il souligne la « fidélité à l’enveloppe formelle du symptôme, qui est la vraie trace clinique » du signifiant, et cette limite où il « se rebrousse en effets de création »1, passage du pathologique à l’invention. Mais en quoi l’invention en question relève-t-elle de la sublimation ?
Création versus fiction
Comme nous y invite Jacques-Alain Miller, distinguons fiction et création2. La première se déploie dans la chaîne signifiante ; elle donne forme au symptôme dans le champ de l’Autre. La création quant à elle produit de l’inédit hors de l’Autre et touche au réel du symptôme. Manier les signifiants, c’est déjà sublimer3, indique J.-A. Miller. Toutefois, cette sublimation renouvelle le sens dans l’Autre sans nécessairement créer du nouveau, c’est la/le joui-sens de la fiction. De même, le fantasme fondamental, réponse au désir opaque de l’Autre, relève de cette fiction et constitue pour chacun « sa sublimation personnelle4 ».
Deux régimes du sinthome
Arrimée au signifiant et au fantasme, la sublimation relève du semblant comme défense spéciale contre la jouissance. Elle peuple un vide en élevant un objet à la dignité de la Chose, sans rompre avec l’Autre, tandis que la création naît d’un affrontement au réel et d’une rupture avec l’Autre. Cette distinction rejoint celle établie par Lacan entre le sinthome madaquin, « élevé au semblant […], devenu mannequin et voilé par les sublimations » et le sinthome roule, « dénudé dans sa structure et dans son réel5 ». Le premier relève de la fiction, le second de la création. En fin d’analyse, la confrontation à l’inexistence de l’Autre rend possible un dénouement singulier : le sinthome madaquin se défait de ses enveloppes de fiction pour laisser apparaître le sinthome roule – soit la part irréductible du symptôme qui tient à l’événement de corps, à la marque d’une jouissance opaque produite par la frappe d’un signifiant tout seul sur le corps, pouvant désormais être assumée comme style singulier d’un corps parlant.
Anastasia Sotnikova Faraco
[1] Lacan J., « De nos antécédents », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 66.
[2] Miller J.-A., « Réflexions sur l’enveloppe formelle du symptôme », Actes de l’ECF, n°9, 1985, p. 41.
[3] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Pièces détachées », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 12 janvier 2005, inédit.
[4] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Du symptôme au fantasme, et retour », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 12 janvier, 1983, inédit.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 209.