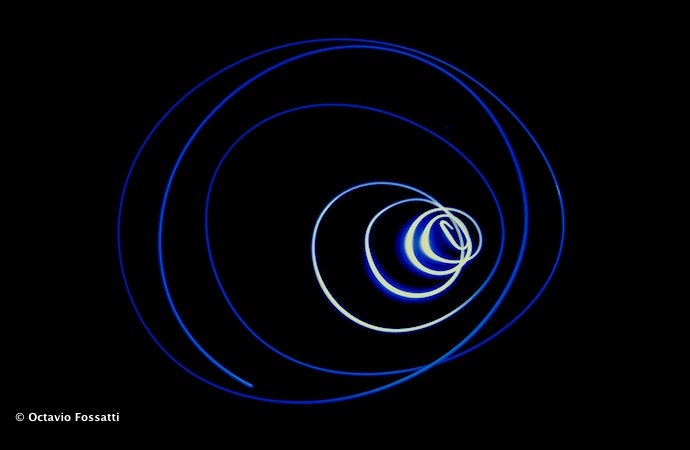Depuis la fin du travail au sein du dispositif de la passe, un reste symptomatique se manifestait à quelques rares occasions : un instant de doute, d’hésitation. Un instant où je m’arrête et je m’interroge… avant de faire quelque chose [*]. Je le lis comme un reste symptomatique sur lequel je prends appui afin de voir par où poursuivre. Désormais sans inhibition ni précipitation, mais décidée.
Lorsqu’on me proposa de témoigner en visioconférence, je dis, sans hésiter : « oui, ce sont les conditions que nous impose l’époque ». Soutenue par l’éthique de ne pas céder devant le désir de m’adresser à l’École, je fis le pari de trouver une manière de faire passer le vivant à travers Zoom.
Dans les jours qui précédèrent les J-50, au détour d’une conversation informelle, quelqu’un fit référence à la pudeur et à ce qu’il voyait comme une difficulté : parler à une audience en majorité anonyme et invisible. Je ne ressentais pas cette pudeur, vu les circonstances inédites de ce premier témoignage mon souci était plutôt que l’énonciation « passe ».
Ce commentaire me fit cependant penser à cette phrase de Lacan, « les non-dupes errent, c’est peut-être les non-pudes errent » [1]. La pudeur est présente dans l’écriture du témoignage ; il ne s’agit néanmoins pas de la pudeur liée à la honte, mais de la pudeur à laquelle Lacan se réfère dans le Séminaire XXI, une pudeur liée au « bien-dire » [2]. Il avance qu’elle est la seule vertu de la fin, une pudeur face au réel qui est en jeu dans la passe. À la différence de la sortie par le cynisme ou l’incroyance, il y a une croyance dans le sinthome et une confiance dans l’École à laquelle nous, AE, nous nous adressons en tant qu’« épars désassortis » [3].
Toutefois, ce reste symptomatique se manifesta la veille de la plénière. La situation était la suivante : j’avais des doutes quant à la prononciation et je voulais que mes enfants m’aident. Cela impliquait de lire devant eux le témoignage à voix haute. Dans mon texte, je parlais de mon désir, de comment il s’était modifié avec la maternité et de la façon dont il avait affecté le choix de leur éducation. Avant de leur demander quoi que ce soit, l’instant de la question surgit de façon inattendue, accompagné d’un sentiment de pudeur.
Pourquoi le reste symptomatique apparut-il à ce moment-là ?
Bien qu’à la maison mon idéalisation légendaire de la France est matière à nombre de plaisanteries, je pensais qu’il s’agissait cette fois-ci de mettre en mots et d’une certaine façon de dévoiler quelque chose du tissage de signifiants et jouissance qui est en jeu dans la transmission à un enfant. Ayant vécu la mort de mon père comme une coupure abrupte, le souci de transmission m’a toujours habité, même s’il s’est exprimé sous des formes symptomatiques différentes au cours de mon parcours analytique. Ce qui apparut, ce jour-là, ce fut la différence dans la transmission après la passe.
Plus orientée, après m’être « arrêtée pour penser », je trouvai la façon de le faire et il fut intéressant de voir comment mes enfants répondirent et m’accompagnèrent, chacun de façon singulière. Alors que j’écris cette contribution, je pense qu’à ce moment-là, c’est aussi ma propre division mère-femme qui s’est manifestée, ainsi que la dissociation entre le désir de l’analyste et le désir de la mère. Ce sera un thème de travail.
[*] Traduit de l’espagnol par Dominique Corpelet.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 12 mars 1974, inédit.
[2] Ibid.
[3] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 573.