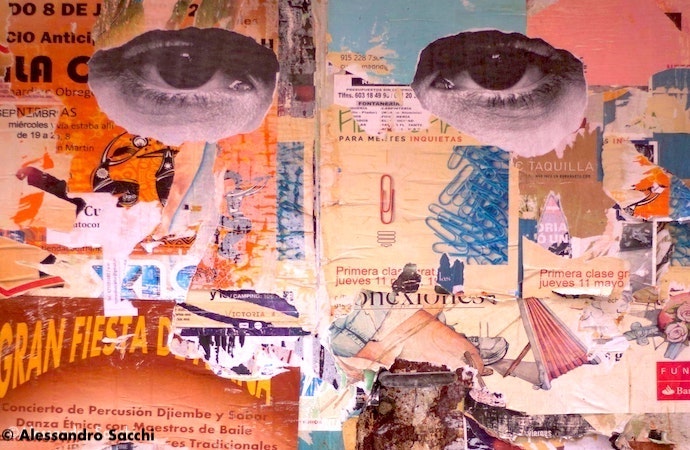I.
C’est celui qui rêve qui y est. Avec L’Interprétation des rêves parue en 1900, Freud marque une rupture avec la façon que nous avions de considérer les rêves. Freud donne au rêve un statut de production psychique qui a une signification de plein droit. Que les rêves aient un sens n’a rien de nouveau. C’est le lieu du sens qui, avec Freud, fait la différence. Avant lui, on cherchait le sens ailleurs que dans la vie du rêveur. Une clef des songes, fixe, constante, servait dans l’antiquité à décrypter ce que le rêve véhiculait comme message (oraculaire, prophétique, visionnaire). S’il y avait la reconnaissance d’un vouloir dire du rêve, le sens ultime se rattachait à quelque chose qui échappait au rêveur. Du côté du divin, du côté d’un symbolisme culturel (sept vaches maigres, sept vaches grasses [1]), le sens se trouvait en dehors du sujet lui-même.
C’est celui qui rêve qui y est, par ce pas freudien la clef de la production psychique – le rêve – est remise au sujet qui en fait le récit. Le rêve appartient à celui qui rêve. À cette conception du rêve correspond un usage, une pratique analytique : « la technique […] charge du travail d’interprétation le rêveur lui-même. Elle tient compte de ce que tel élément du rêve suggère non pas à l’interprète mais au rêveur »[2], « l’interprète d’un rêve ne devrait pas donner libre cours à sa propre spontanéité et négliger les associations que donne le rêveur »[3]. C’est par les associations libres du rêveur que l’on peut découvrir le sens qui s’y cache. Le sens circule dans les dires même du rêveur. Le rêve, dont le sens ultime est un sens sexuel inconscient, devient la voie royale d’accès à l’inconscient.
Inviter les analysants à associer à partir d’un mot, d’un détail, « morceau par morceau »[4] reste un usage toujours d’actualité.
Si avec Freud la clef n’est plus de songe, elle reste œdipienne – sceau qui distingue l’usage freudien des rêves.
II.
Avec son retour à Freud, Lacan remet la clef au signifiant. Héritier de la voie ouverte par Freud, il souligne la valeur de phrase du rêve et en distingue le fonctionnement signifiant. C’est L’Interprétation des rêves revisitée par la linguistique et le structuralisme. Un rêve est une production langagière, ça se lit, ça veut dire quelque chose pour celui qui rêve : « Qu’on reprenne donc l’œuvre de Freud à la Traumdeutung pour s’y rappeler que le rêve a la structure d’une phrase, ou plutôt, à nous en tenir à sa lettre, d’un rébus, c’est-à-dire d’une écriture »[5].
Si avec Freud l’analysant rêve et l’analyste interprète, après Lacan l’analysant rêve et son rêve l’interprète. C’est le rêve qui interprète le rêveur. Le rêve est son interprétation, il est toujours déjà une interprétation : « L’interprétation de l’analyste ne fait que recouvrir le fait que l’inconscient – s’il est ce que je dis, à savoir jeu du signifiant – a déjà dans ses formations – rêve, lapsus, mot d’esprit ou symptôme – procédé par interprétation »[6].
Borges figure cela ainsi : « Dans les rêves […] , les images représentent les impressions que nous imaginons qu’elles provoquent. Nous n’éprouvons pas d’horreur parce qu’un sphinx nous oppresse, mais nous voyons en rêve un sphinx pour expliquer l’horreur que nous éprouvons »[7]. Le rêve donne un sens, interprète.
C’est celui qui rêve qui y est, cela veut dire avec Lacan que ce n’est pas l’analyste qui sait à la place du sujet. S’il est supposé savoir le sens du rêve, au fond il sait qu’il ne sait pas.
L’analyste n’est pas là pour substituer au récit du rêveur, son récit à lui, depuis une position qui serait alors métalinguistique, méta-interprétative. Il n’y a pas d’Autre de l’Autre. Il s’agit plutôt de pointer l’interprétation déjà à l’œuvre dans le rêve lui-même.
Ce « celui qui rêve qui y est » va de pair avec « vous l’avez rêvé » ! Il s’agit moins d’inviter à associer que de citer, ponctuer – de se positionner de manière à ce que l’analysant reçoive du rêve « son propre message sous [sa] forme inversée »[8].
Au-delà de la clef œdipienne comme grille d’interprétation du rêve, la clef reste dans l’Autre du sens, du symbolique. La conception du rêve et de son usage s’inscrit dans une continuité dans le rapport à l’Autre. Dans ce registre, on a aussi l’objet que l’interprétation doit viser, « spécialement sous la guise du vide »[9].
III.
Ce que l’on fait lorsqu’on approche le rêve comme unité sémantique [10], diffère de ce que l’on fait lorsqu’on considère l’existence de ce qui, dans le rêve, échappe au sens.
Si en 1900 Freud signale l’ombilic du rêve, lieu où les représentations s’arrêtent, comme un obstacle dans sa voie royale d’accès à l’inconscient, Lacan en fera – notamment dans son Séminaire sur Joyce [11] – un fondement clair.
À la lumière de ce trou placé comme origine logique et structural, le sens du rêve devient hystoire à dormir debout, men-songe. Cette torsion opérée par Lacan, loin d’être une incitation à abandonner le champ du sens, de la vérité et de la parole, nous invite à y rester à condition de se tenir au plus près de la dimension matérielle du signifiant. Mettant « la vérité à sa place », sans l’ébranler [12], il s’agit de faire un usage du rêve en s’orientant du réel, seule manière de contrecarrer l’inconscient soporifique.
Il faut tout reprendre à partir de l’ombilic du rêve, suivant le mouvement que Lacan propose avec l’opacité sexuelle dans le Séminaire cité.
En mettant le trou ombilical non pas comme pierre-obstacle, mais comme pierre angulaire, de ce qui travaille dans le discours analytique, en situant l’inconscient comme réel, un usage du rêve se forge qui ne serait pas(-tout) aliéné au sens. C’est un choix, signale Lacan, que d’être dupe du réel, que d’avancer en ayant comme fondement qu’il n’y a pas de rapport sexuel.
Le solde de cet usage du rêve ne sera alors pas « savoir absolu »[13], traduction complète, mais plutôt « dépôt, […] sédiment qui se produit chez chacun quand il commence à aborder ce rapport sexuel »[14].
L’analyste doit ainsi veiller au maintien d’un certain état joycien du rêve. Ne pas alimenter le sens ouvre à la possibilité d’une lecture littérale de la dimension R.S.I. du rêve. Cela implique une position du sujet vis-à-vis de lalangue, à rebrousse-poil du sens, vers l’isolation des S1 qui font trace. On parie sur la possibilité d’une nouvelle lecture qui portera en elle le sceau de l’illisible.
Du coup il revient à l’analyste d’être gardien de l’ombilic. Tâche paradoxale : d’un côté, s’assurer que rien ne vienne suturer ce trou – tout peut y venir, mais rien ne doit y rester – ; d’un autre, lorsque quelque chose s’y loge, apprécier sa fonction dans l’existence du parlêtre. C’est de faire du trou la clef que la clinique lacanienne des rêves se distingue des autres, c’est son sceau.
[1] Freud S., L’Interprétation des rêves, Paris, PUF, 1987, p. 91.
[2] Ibid., p. 92.
[3] Ibid., p. 36.
[4] « une analyse “en détail” et non “en masse” » (Ibid., p. 97.)
[5] Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 267.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 118.
[7] Borges J. L., « Ragnarok », Œuvres Complètes, t. II, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1999, p. 25.
[8] Lacan J., « Le séminaire sur ‘‘La Lettre volée’’ », Écrits, op. cit., p. 41.
[9] Laurent É., « L’interprétation : de la vérité à l’événement », argument du congrès 2020 de la NLS, disponible sur le site de la NLS : www.nlscongress2019.com/accueil
[10] Cf. Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, n°32, février 1996, p. 9-13.
[11] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 98.
[13] « nous sommes à l’aise pour mettre en doute d’abord ceci, que le travail engendre à l’horizon un savoir absolu ». (Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 90.)
[14] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 12 février 1974, inédit.