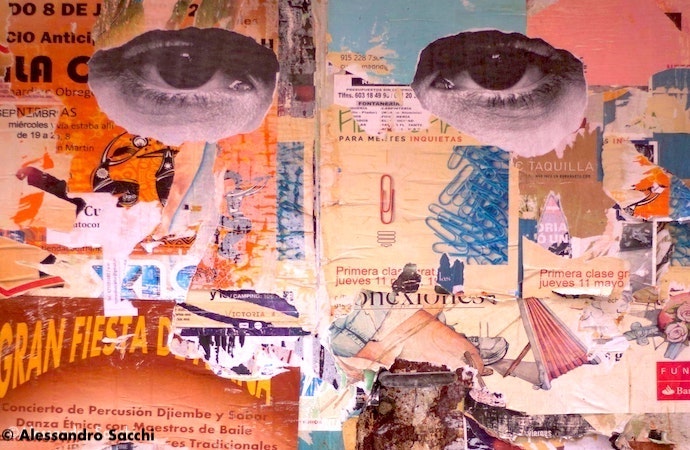Le titre sous lequel j’interviens, présente deux termes de registres fort différents. Le second, relève de la clinique : « seulement voilà : elle est d’avant le discours analytique » [1], affirme Lacan en 1973. « Le rêve » ici convoqué, c’est autre chose : il implique l’expérience d’une psychanalyse, celle qu’on décide d’entreprendre… ou qu’on n’entreprend pas. La perspective change. Il ne s’agit plus de privilégier le savoir-faire acquis auprès de patients psychotiques – ne pas interpréter les rêves, ne pas trop vouloir « réveiller » un patient psychotique, etc. – autant d’affirmations avancées au nom de la sagesse du clinicien averti. Mais que puis-je dire à partir du résultat, inouï, de ma propre expérience du rêve… en tant qu’analysant ?
Allons pas à pas. Celui qui interprète un rêve, ce n’est pas l’analyste, c’est l’analysant – l’analysant-interprétant. Son interprétation se modifie dans le cours de l’analyse. La modification concerne le point d’où la lecture du rêve est commise par l’analysant. Appliquer la règle fondamentale de l’association libre, c’est miser sur le déterminisme qu’implique la foi dans la structure de l’hypothèse de l’inconscient. S’isolent, ainsi, les signifiants-maîtres qui ont prévalu, tant dans leur versant-idéal, que dans les effets de joui-sens qu’ils produisent en contrebande, sous couvert de civilisation langagière. La règle fondamentale permet ainsi de passer d’un Autre à a [2]. Mais elle débouche sur un constat : quelque chose s’itère dans le symptôme, malgré l’interprétation la plus rigoureuse, commise à partir de l’objet pulsionnel. Le désir d’interprétation s’avère dès lors relever lui-même d’un « louche refus » concernant un réel, toujours déjà rencontré avec le corps. Comment poursuivre ? Comment vouloir lire un rêve… sans plus pouvoir l’interpréter ? Tel devient l’enjeu vers la fin de l’analyse.
Si le passage de A à a conserve une foi dans la structure ; foi qui s’origine d’un appui pris sur le « il y a » éprouvé, hors structure. La bascule, elle, est une affaire d’heur : pas de garantie, à l’entrée de l’expérience, que l’urgence soit satisfaite. Mais c’est aussi et avant tout une question de goût : combien de décennies – et quelle constance, éthique – a-t-il fallu à Lacan, à titre de psychanalysant, pour prendre le risque de décaler d’un cran, à la fin de son enseignement, ce que fut sa propre foi dans la structure ?
Amour et haine s’adressent à l’être, cette folie que nous tenons du langage [3] ; le goût dont il s’agit dés-espère la supposition d’être. Faisant vibrer l’existence d’un éprouvé hors détermination. Sans doute un tel goût s’éveille-t-il dans l’expérience de l’analyse. Il ne s’acquiert en aucun cas. De lui, dépend la nature du partenariat que cet analysant choisira (ou non) ensuite, auprès d’un sujet s’adressant à lui – le patient fût-il psychotique. Heur et goût échappent à tout cursus universitaire : ils sont deux exilés de la classe, si chère au clinicien.
Tentons de conclure. Il y a l’analysant-interprétant de tel rêve et non pas de tel autre, à tel moment de l’expérience et non pas à tel autre. Et il se peut qu’il y ait du partenaire analyste : lecteur « pas-interprétant ». Coupure, scansion, reprise « à la lettre » de tel dit de l’analysant (et non pas de tel autre dit), geste sans parole : autant de variations dés-interprétantes du rêve exposé, donnant chance à la trouvaille sinthomatique ; et donnant du souffle à l’existence ; tout au moins, ne l’asphyxiant pas. Elles impliquent, à chaque fois, le corps et l’acte de l’analyste. Elles convoquent le goût d’où l’on se risque – affamant le sens, pour ne pas diffamer la marque. La clinique, dès lors, il s’agit de ne pas s’en passer, à la condition de ne pas s’en servir.
[1] Lacan J., « Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Écrits », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 556.
[2] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006.
[3] Cf. Lacan J., « Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines. Columbia University. 1er décembre 1975 », Scilicet, n°6/7, 1976, p. 49.