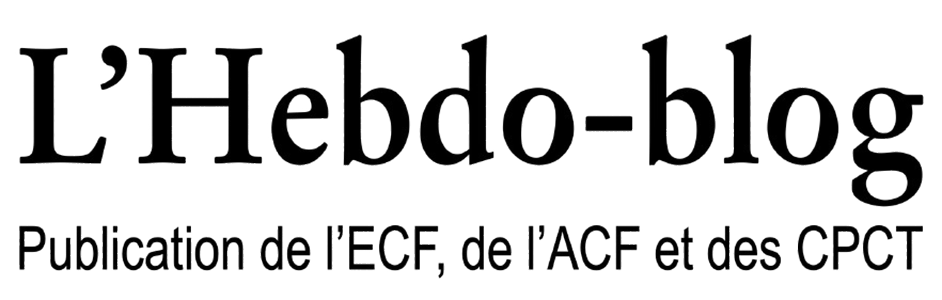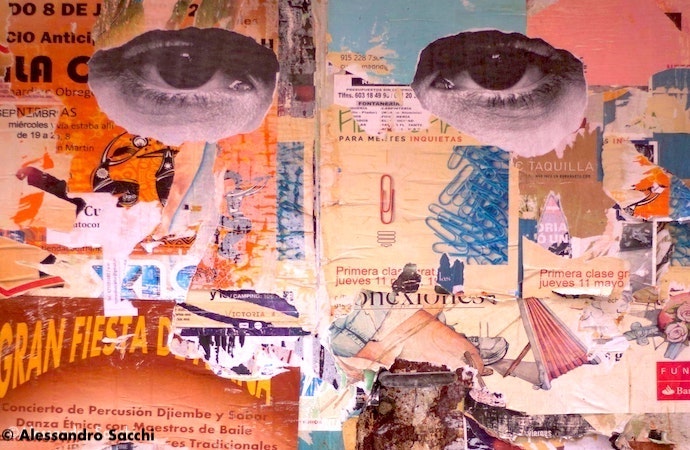Si le rêve, parmi toutes les formations de l’inconscient, occupe une place particulière pour la psychanalyse, ce n’est sans doute pas seulement parce que Freud en a fait la voie royale d’accès à l’inconscient. Pour l’analysant, il est aussi le lieu et l’occasion de plus d’un paradoxe.
Alors que L’Interprétation des rêves a permis de rompre avec toute idée de clé des songes, dans ma cure j’attendais souvent la survenue d’un rêve dans l’espoir qu’il soit en lui-même la clé qui me donnerait accès à un savoir nouveau. Le rêve revêtait donc une touche d’agalma d’être, lui, supposé savoir… quelque chose que, moi, j’ignorais. Pour que le rêve me parle, il fallait donc que je le parle à mon tour, le dise en séance, l’adresse à l’analyste. C’est en entrant ainsi dans le circuit de la parole par ces différents tours de dits que le message, m’en revenant de l’Autre, pourrait peut-être m’en devenir déchiffrable… Ma propre tension vers le sens, qui accordait au rêve un « vouloir dire », me faisait oublier qu’en tant que tel il ne sert à aucune communication [1]. Oubli nécessaire sans doute dans un premier temps, mais pas suffisant.
En poussant un peu les choses, la distinction freudienne du contenu manifeste et du contenu latent pourrait finalement s’étendre à toute parole analysante, faisant de l’ensemble de celle-ci le déroulé au fil de la cure du texte d’un très long rêve ! À cet égard, la fin de l’analyse ne pourrait-elle pas sonner aussi comme un moment de réveil ?
J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer un rêve, fait vers la fin de ma cure, même s’il n’en est pas le dernier. Comme Éric Laurent l’a fait remarquer lors de la journée « Question d’École » [2], ce rêve se présentait comme plutôt foisonnant d’éléments hétéroclites, s’approchant de la description d’Edward Glover d’un monde tenant « à la fois d’une boucherie, de toilettes publiques sous un bombardement et d’une morgue [3] » ! Cela contrastait avec ce que j’en avais finalement retenu, peu de choses en fin de compte, l’insistance d’un son et d’une lettre qui s’entendait dans certains des signifiants du rêve ou des associations qu’il avait produites. Même si ce rêve, comme tout texte, se prêtait aussi à l’interprétation signifiante pour son déchiffrage, je n’en fis pas cet usage pour la révélation d’une vérité inconsciente. Mais il me permit de saisir en revanche que le travail du rêve était fondamentalement chiffrage. Tout ce cortège, un peu baroque du texte du rêve, était l’habillage produit par le travail du rêve qui dans son fond poursuivait, comme toujours, le chiffrage de la jouissance hors sens qui en constituait l’ombilic. Jusqu’à cerner la lettre et le son qui y insistait, socle minimal encore dicible qui témoignait de cet effort. Alors, une fois isolé ce reste, sans espoir qu’il puisse jamais s’évanouir, la trouvaille d’un signifiant nouveau, « vivre », qui permettait à la fois de l’enserrer et d’en faire un nouvel usage, a été ma façon de me faire responsable du rêve. De même que l’engagement dans la passe peut être une façon de se faire responsable de son analyse.
[1] Cf. Freud S., « Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation des rêves », Résultats, idées, problèmes, t. II, Paris, PUF, 1985, p. 141.
[2] Cf. Laurent É., intervention lors de la journée « Question d’École » du 1er février 2020, inédit.
[3] Glover E., « La relation de la formation perverse au développement du sens de la réalité », Ornicar ?, n°43, hiver 1987-1988, p. 23.