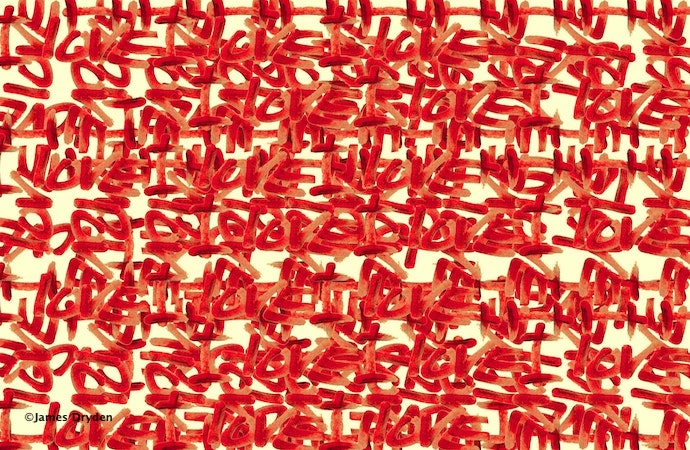Le thème de nos prochaines journées a été l’occasion de remettre à l’étude ce qui, dans le champ de la sexualité, relève d’un traumatisme, disons, structural. Ce sont alors les termes d’irruption, d’effraction, d’intrusion que nous évoquons, relativement à la dimension du corps et de la jouissance qui s’éprouve, et celui de trou, relativement au savoir qui manque concernant la chose sexuelle. À propos de ce dernier, nous nous appuyons sur cette référence précieuse de Lacan datée de 1974 où il avance que la « sexualité fa[it] trou dans le réel » [1]. Si nous posons qu’il y a du savoir dans le réel, nous nous empressons de préciser alors que la sexualité fait trou dans ce savoir [2]. Reste alors à inventer…
C’est déjà ce qu’annonçait l’axiome de Lacan proposé en 1969 : « il n’y a pas de rapport sexuel » [3]. Dans le réel il n’y a pas d’écriture, au sens mathématique du terme, de ce rapport ; autrement dit, « la réalité sexuelle est qu’il n’y a pas de rapport instinctuel entre l’homme et la femme » [4]. Une conception du réel s’en déduit, approchée ici sous l’angle de la sexualité. La question que je souhaiterais soulever alors est celle du lien à poser entre ce trauma sexuel et celui que nous situerons comme plus fondamental, résultant de la rencontre entre le signifiant et le corps, à savoir le trauma langagier.
Partage
Pour saisir la logique de celui-ci, nous nous référons par exemple à Joyce (Séminaire Le Sinthome) qui, n’étant pas suffisamment protégé par le Nom-du-Père des « échos menaçants du signifiant », des « échos infinis de la langue » [5], dénude et « nous montre de manière pure l’essence du trauma, qui est le trauma de la langue » [6]. Concernant le trauma sexuel, nous nous référons par exemple au petit Hans confronté à l’agitation de son fait-pipi – son « premier jouir » [7] –, tout en précisant bien que la jouissance en jeu – celle qu’il découvre sur son propre corps – n’est « pas autoérotique » [8].
Généralisation
Dans les deux cas il est question d’irruption et de trou, avec à chaque fois une approche spécifique du réel. Et, puisque la référence au sinthome est plus tardive dans l’enseignement de Lacan, nous pouvons avancer que l’approche du réel par la sexualité ne constitue finalement qu’une avant-dernière étape concernant la formalisation de ce registre si essentiel en psychanalyse. Ainsi, comme le relève J.-A. Miller, on peut considérer que le réel du nœud, le « réel borroméen, le réel extérieur au symbolique, est la généralisation de ce trou que Lacan a d’abord approché au niveau de la sexualité » [9].
Positivation
Continuité, donc, mais également nouveauté. Pour preuve le bémol posé par Lacan en 1976 concernant son énoncé « il n’y a pas de rapport sexuel », évoquant à son propos le terme de « broderie », « parce que ça participe du oui ou non » [10] ajoute-t-il, « c’est-à-dire cela participe de la relation, précise J.-A. Miller, c’est un énoncé qui reste pris dans la logique de la différence » [11]. Dès lors, la volonté de Lacan dans son Séminaire Le Sinthome est d’essayer de le « dire autrement, pour que ça fasse réel » [12]. Le dire autrement en présentant le réel comme bout (« un bout de réel ») et en avançant que « le stigmate du réel, c’est de se relier à rien » [13] (nous avons un pur non-rapport [14] !) Et, à le dire autrement à travers le concept de sinthome, à situer du côté de ce qu’il y a et de ce qui peut s’écrire – fait positif de ce qui était énoncé, de manière négative, à travers son axiome [15]. Proposons alors de distinguer ce qui fut une approche du réel à partir du symbolique, du savoir – fût-ce à partir de ce qui y fait trou comme impossible (impasse logique), d’une approche du réel comme hors symbolique et du côté de l’ex-sistence.
Nouage
Quel lien pouvons-nous allons établir entre ces deux approches du trauma ? Prenons appui sur deux références de Lacan pour introduire cette question.
La première est extraite de la « Conférence à Genève sur le symptôme », lorsqu’il évoque son concept de lalangue introduit dès le Séminaire Encore et approché ici à travers les termes de « détritus », de « débris » (ceux du langage, bien sûr) avec lesquels l’enfant « joue » et se « débrouille » [16], et auxquels s’ajouteront – précision importante – « sur le tard, parce qu’il est prématuré précise Lacan, les problèmes de ce qui va l’effrayer » [17]. Et de conclure ainsi : « Grâce à quoi il va faire la coalescence, pour ainsi dire, de cette réalité sexuelle et du langage. » [18] Retenons ce terme de « coalescence » [19] qui introduit l’idée d’un collapse entre deux dimensions, celles du signifiant et du sexuel.
Notre seconde référence est tirée de la fin du chapitre VII du Séminaire Le Sinthome [20] où Lacan interroge le registre sexuel (et plus précisément chez les femmes) à partir, là encore, de lalangue, là où le signifiant sert uniquement à jouir et là où se situent toutes les ambiguïtés et les équivoques (le principe de différence en est donc exclu). Dès lors le tableau de la sexuation du chapitre VII d’Encore [21], avec son binaire homme-femme, avec ses formules de logique mathématique qui emprisonnement la « jouissance dans la fonction phallique, dans un symbole » [22] donc, doit être relativisé. Depuis les avancées de Lacan dans son tout dernier enseignement, depuis son intérêt pour la jouissance opaque, réelle, ce tableau apparaît alors comme une « construction secondaire qui intervient après le choc initial du corps avec lalangue, qui constitue un réel sans loi, sans règle logique » [23]. Cette reconsidération de la sexuation à laquelle nous invite finalement Lacan – reconsidération à partir du trauma du langage – n’entre-t-elle pas dès lors en parfaite résonance avec notre époque ?
[1] Lacan J., « Préface à L’Éveil du printemps », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 562.
[2] Cf. Miller J.-A., « Une fantaisie », Mental, n°15, février 2005, p. 9-27, disponible sur internet.
[3] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 226.
[4] Sokolowsky L., « Commentaire de la ‘‘Conférence à Genève sur le symptôme’’ de Jacques Lacan », La Cause du désir, n°95, avril 2017, p. 23.
[5] Miller J.-A., « Lacan avec Joyce », La Cause freudienne, n°38, février 1998, version CD-ROM, Paris, EURL-Huysmans, 2007, p. 13.
[6] Ibid., p. 14-15.
[7] Lacan J. « Conférence à Genève sur le symptôme », La Cause du désir, n°95, op. cit., p. 13.
[8] Sokolowsky L., « Commentaire… », op. cit., p. 23. Concernant cette jouissance, Lacan utilise les termes d’« hetero » et d’« étrangère » (parfaite illustration alors de la dimension d’altérité que le sujet entretient avec son corps propre). Sur ce sujet, cf. Terrier A., « Attentat sexuel. Argument. Part. 3 », publication en ligne (www.attentatsexuel.com), et Damase H., « Derrière l’attentat du fait-pipi », Boussoles cliniques, 11 juillet 2020, publication en ligne (www.attentatsexuel.com).
[9] Miller J.-A., « Pièces détachées », La Cause freudienne, n°61, octobre 2005, p. 144.
[10] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 124.
[11] Miller J.-A., « Pièces détachées », La Cause freudienne, n°60, juin 2005, p. 171.
[12] Ibid.
[13] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit.
[14] Cf. le sixième paradigme de la jouissance proposé par J.-A. Miller (cf. Miller J.-A, « Les six paradigmes de la jouissance », La Cause freudienne, n°43, octobre 1999, p. 7-29).
[15] J.-A. Miller nous dit : « Ce qu’il s’agirait de cerner ici, c’est le bout de réel qu’on vise en disant ‘‘il n’y a pas de rapport sexuel’’, qui est la face négative du fait positif ‘‘il y a sinthome’’ » (Miller J.-A., « Pièces détachées », La Cause freudienne, n°60, op. cit., p. 163).
[16] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », op. cit., p. 14. Pour un commentaire de cette citation, cf. Libert G., « L’eau du langage », DESaCORPS, n°28, 16 octobre 2020, publication en ligne (www.attentatsexuel.com).
[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Ce même terme est utilisé par Lacan dans le Séminaire XX, Encore, à propos de l’objet a dans son lien à S(Ⱥ) – dont s’origine le principe de plaisir, l’analyse visant la scission de ces deux instances (cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 77-78).
[20] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit., p. 105-118.
[21] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 73-82.
[22] Miller J.-A., « Le réel au XXIe siècle. Présentation du thème du IXe congrès de l’AMP », La Cause du désir, n°82, octobre 2012, p. 94.
[23] Ibid.