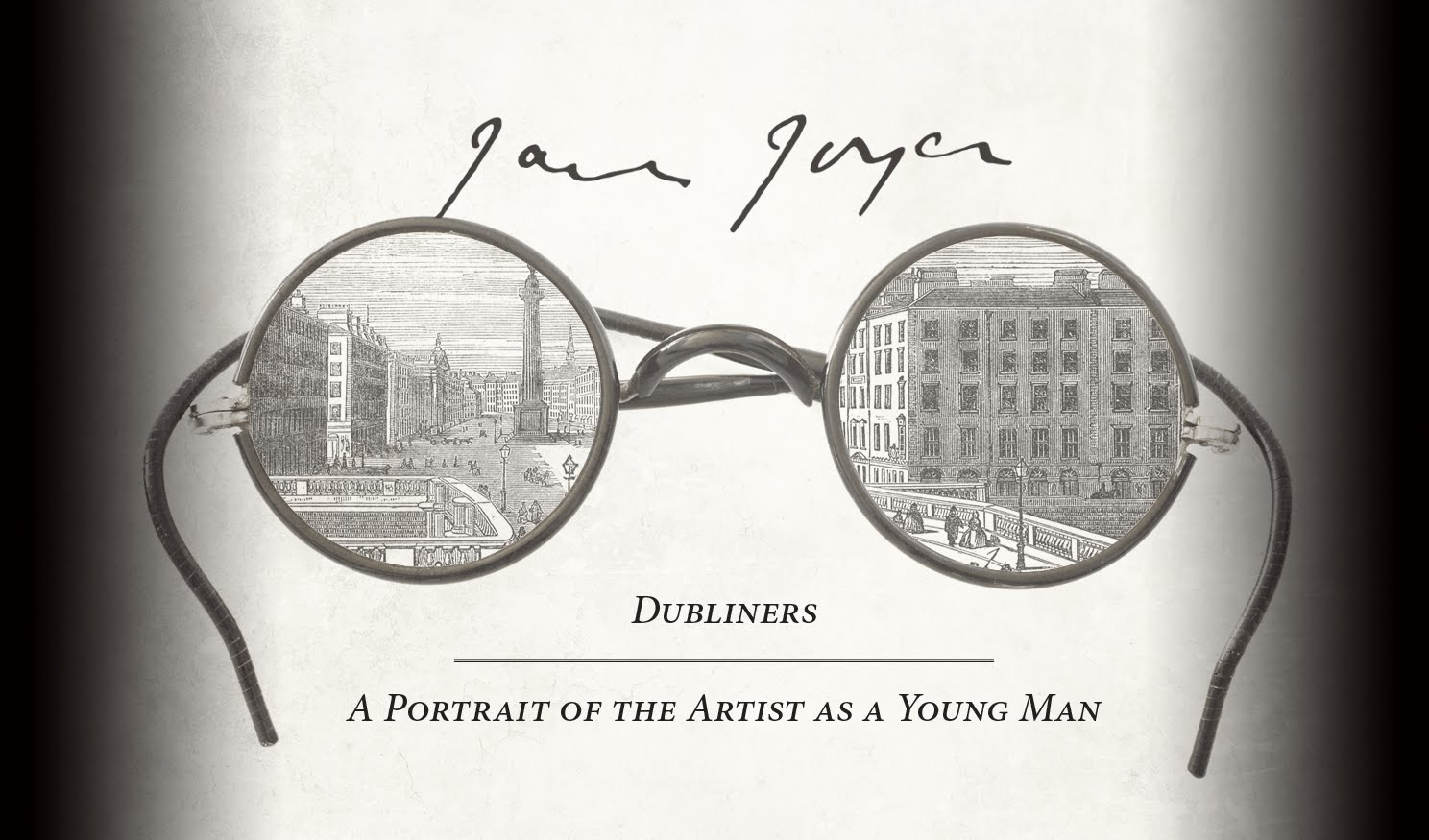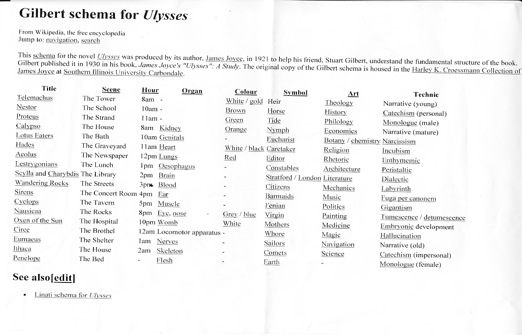Avec sa pièce « Le canard sauvage », écrite en 1884 durant son exil choisi à Rome et au moment où il a acquis sa notoriété de chef de file de l’avant-garde du théâtre européen, Ibsen déplie de façon radicale et inexorable la rencontre ratée entre le père et le fils. Ce ratage s’inaugure d’une « catastrophe », celle de « la ruine [du] père – la honte et le déshonneur »[1]. Ce père « brisé, définitivement perdu »[2], Ibsen le lie indissolublement à un autre père à la jouissance égoïste et cynique. Ces deux figures de pères sont les deux faces d’une même pièce : le père comme puissance destructrice.
Le vieil Ekdal est le père « pauvre naufragé »[3] qui se laisse couler au fond des eaux sans pouvoir remonter à la surface comme le fait le canard sauvage blessé par le chasseur. Le négociant Werle est le père tout occupé à sa jouissance maniant le mensonge et les non-dits, brisant les vies, leur infligeant la pauvreté et le déshonneur.
À ce père à double face, Ibsen donne pour partenaire un fils à double face.
Gregers, le fils de Werle, refuse l’« imposture »[4] paternelle fondée sur le mensonge. Porter le nom de son père est devenu « sa croix dans l’existence »[5], l'obligeant à rembourser toujours plus sa « dette envers l’Idéal »[6]. Dire la vérité, toute la vérité, ouvrir les yeux de tous sur les mensonges du père est la mission qu’il se donne sans jamais en démordre et qu’il exige de tous sans limite. Telle est sa fièvre de vérité.
Dans ce jeu de « colin-maillard »[7] entre mensonge et vérité, Hjalmar, le fils du vieil Ekdal, choisit, lui, de garder les yeux fermés. Se débarrasser de l’« épouvantable affaire de dette »[8], partir « loin de tout ça »[9] est ce qu’il veut coûte que coûte. « Ce qu’il y a de terrible, justement, c’est que je ne sais pas ce que je dois croire – que je ne le saurai jamais. »[10]
Dans ce combat entre le mensonge aveuglant du père et la vérité-toute impossible à supporter du fils, Ibsen introduit un espace de fiction et de temps arrêté, un lieu préservé où rêver est encore possible : dans un grenier vit le canard sauvage sauvé de sa noyade mortelle. En ce grenier et ce canard sauvage, Hedvig, l’enfant de Hjalmar, a reconnu ce mystère du « fond des mers »[11], cette chose étrange que personne ne connait ni ne sait d’où elle vient. Ce mystère que le regard de l’enfant fait exister est le monde de l’art, de la nature et des rêves inconscients où l’enfant est chez elle. Il est ce qu’Ibsen oppose à la vérité-toute et au père idéal qui ne sauvent pas de la douleur d’exister sans désir. Il est ce qui rend supportable l’héritage du père qui est le « poids de ses péchés »[12]. Avec un grenier, avec un canard sauvage blessé, avec un cœur d’enfant, Ibsen rend au mensonge du rêve et de l’art sa valeur de vérité.
Toute l’œuvre d’Ibsen témoigne qu’il a logé dans l’écriture des fictions théâtrales et dans le maniement de sa langue, de quoi assumer pour son propre compte son désir de vivre et de transmettre. Cet illustre homme de théâtre a su faire du mensonge sa vérité, anticipant ce que J. Lacan nous enseigne : « C’est d’abord comme s’instituant dans, et même par, un certain mensonge, que nous voyons s’instaurer la dimension de la vérité, en quoi elle n’est pas, à proprement parler, ébranlée, puisque le mensonge comme tel se pose lui-même dans cette dimension de la vérité. »[13] Sa pièce « Le canard sauvage » est la trace vraie d’une blessure toujours vive qui veut dire : « Ôtez le mensonge vital à un homme ordinaire, vous lui ôtez le bonheur du même coup. »[14]
[1] Ibsen, H., Le canard sauvage, 1884, Actes Sud, Arles, 2014, Acte I, p. 10.
[2] Ibid, Acte I, p. 19.
[3] Ibid, Acte III, p. 66.
[4] Ibid, Acte I, p. 25.
[5] Ibid, Acte II, p. 49.
[6] Ibid, Acte III, p. 71.
[7] Ibid, Acte I, p. 25.
[8] Ibid, Acte IV, P. 105.
[9] Ibid, Acte IV, P. 102.
[10] Ibid, Acte V, p. 123.
[11] Ibid, Acte III, p. 62.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse , Paris, Seuil, 1973, p. 35.
[13] Ibid, p. 127.
[14] Ibsen H., Le canard sauvage, op cit, Acte V, p. 112.
Lire la suite