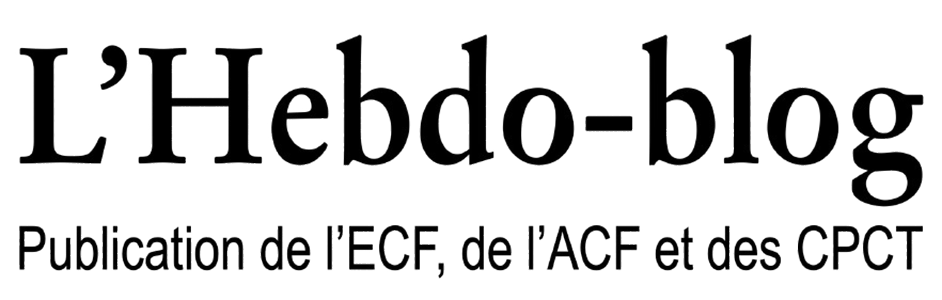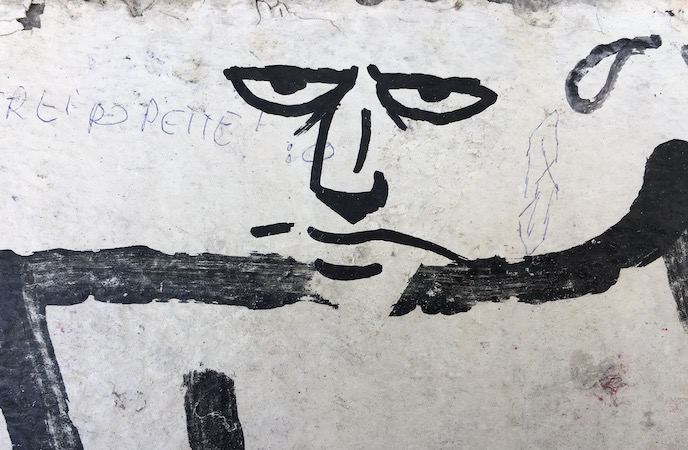En passant du roman à la « forme-série » [1], Margaret Atwood, romancière, poétesse et critique littéraire canadienne contemporaine, met en exergue des points restés inexplorés dans ses livres. M. Atwood a en effet participé à l’adaptation de deux de ses romans sous cette forme : Captive [2] et La Servante écarlate [3]. Sa démarche semble en effet répondre à l’hypothèse de Gérard Wajcman : la série constituerait une issue pour la littérature.
Le point de vue du spectateur se modifie alors. Dans la série Captive [4], l’une des protagonistes fragmente son récit en faisant des aveux qu’elle modifie sans cesse, générant par-là autant de scénarios qu’il y a de personnages dans l’histoire. La série bouscule ainsi les normes du regard. Ce faisant, elle provoque « l’inquiétant » [5].
Cette série, tout comme le roman, inspirée de l’histoire de Grace Marks, se déroule en 1843. Ce qui intéresse surtout M. Atwood dans cette histoire, c’est la mystérieuse affaire criminelle dans laquelle Grace, jeune servante plutôt docile et sans histoire, est impliquée : elle est accusée du meurtre de son maître et de sa gouvernante. Elle est alors condamnée à la pendaison.
Cette peine va toutefois être commuée en une peine à perpétuité, Grace semant le doute dans la tête des magistrats en donnant différentes versions des faits. Est-elle innocente, coupable, victime, folle ou amnésique ? Nous ne le saurons jamais.
Après quinze années de prison, elle peut être exemptée de sa peine à condition qu’un médecin rédige un rapport démontrant qu’elle n’a pas commis le double crime pour lequel elle est condamnée. Le jeune Dr Jordan est appelé à fournir ce rapport. Il se présente à elle comme un médecin différent des autres, précisant qu’il agit sur les maladies de l’esprit, du cerveau et des nerfs. Grace consentira à livrer quelques éléments à Jordan, tout en disant qu’en parlant elle a le sentiment d’être déchirée comme une pêche mûre qui se fend. Mais à l’intérieur de ce fruit, ajoutera-t-elle, il y a un noyau. Ce dernier mot semble figurer sa position : elle ne nous livrera pas la vérité. Sensible à l’écoute attentive de Jordan, elle continuera à lui fournir une multitude de pistes qui le perdront. Purgeant sa peine plusieurs années encore, elle sera graciée pour son attitude remarquable en prison et sera connue dans sa région en tant que meurtrière illustre. Grace dira à ce propos : « Parfois la nuit, je me le répète : “meurtrière !” Ça bruisse comme un jupon en taffetas sur le sol. Meurtrier est purement brutal. Comme un marteau ou un morceau de métal. Je préfère être une meurtrière qu’un meurtrier, si c’est mon seul choix » [6].
Ainsi pourrait se résumer cette histoire ; cette phrase condense en effet, à elle seule, la position singulière que l’auteure a façonnée pour son personnage à l’égard de la jouissance et du désir : choisir d’être a murderess, ces trois dernières lettres venant donner à ce mot une résonance autre.
En collaborant à l’écriture du scénario de cette série sur base d’un de ses romans, M. Atwood semble ouvrir à une autre lecture : « Le monde mis en lumière, éclairé par les séries. Il faut se pencher sur ce fait nouveau et intéressant : les appareils critiques ont manifestement changé de nature » [7]. Cette série donne en effet à penser au sujet du féminin dans le sens où « ce qui est très dangereux avec les femmes c’est que précisément, elles sont sans limite » [8]. Le roman adapté à la « forme-série » donne dès lors aussi à voir « ce qui devait rester un secret, dans l’ombre, et qui en est sorti » [9].
Cinzia D’angelis
________________________
[1] Wajcman G., Les séries, le monde, la crise, les femmes, Lagrasse, Verdier, 2018, p. 38.
[2] Atwood M., Captive, Paris, Robert Laffont, 1998.
[3] Atwood M., La servante écarlate, Paris, Robert Laffont, 2019.
[4] Captive (Alias Grace), mini-série canado-américaine créée par Mary Harron en 2017.
[5] Freud S. / Ferenczi S., Correspondance 1914-1919, tome II, Paris, Calmann-Lévy, 1996, p. 215-216, cité par M. Lusa, in « L’inquiétante étrangeté freudienne », La Cause du désir, n°102, juin 2019, p. 74.
[6] Captive (Alias Grace), op. cit.
[7] Wajcman G., Les séries, le monde, la crise, les femmes, op. cit., p. 25.
[8] Brousse M-H., Qu’est-ce qu’une femme ?, Conférence du Pont freudien, Montréal, 18 février 2000, consultable à http://pontfreudien.org/content/marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-brousse-quest-ce-quune-femme#:~:text=pas%20la%20question.-,%22Qu%27est%2Dce%20qu%27une%20Femme%3F%22,femme%20c%27est%20%C3%AAtre%20m%C3%A8re
[9] Freud S. / Ferenczi S., Correspondance 1914-1919, op. cit., p. 222.