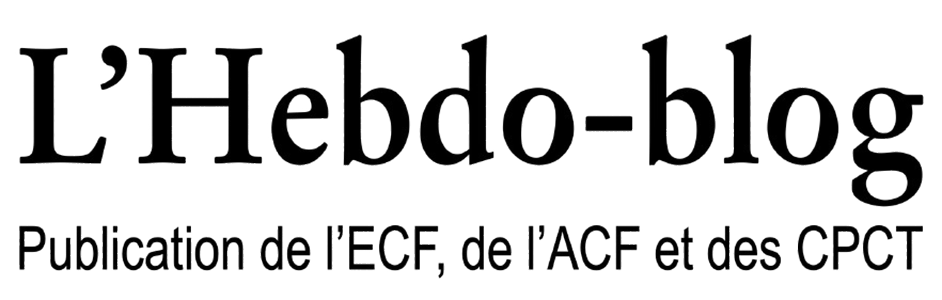La mode est l’un des terrains privilégiés pour interroger les fantasmes contemporains du corps1. Son intérêt est triple : elle traite d’abord le corps comme image qu’on habille, prise dans le registre du miroir et de la relation au semblable ; elle traite aussi le corps fantasmé, toujours déjà habillé par les signifiants pris dans leur réseau et dans le discours courant, vecteur de la consommation ; enfin, elle traite le corps comme ce qui est « sous l’habit2 », objet petit a, soit la part de la jouissance qui échappe à tout habillage, enveloppant le vide.
Le créateur de haute couture Julien Fournié situe d’emblée sa démarche artistique dans une proposition qui va à l’encontre de l’Autre : « Je hais la mode », affirme-t-il, soulignant ainsi la standardisation du prêt-à-porter, d’un côté, et l’élitisme de la haute couture, de l’autre. Son dernier défilé, présenté en janvier 2025 au théâtre Mogador et intitulé First Circus, se présente comme un rêve qui rend hommage à ses personnages fictifs, seul refuge d’un enfant retiré du monde.
On y voit défiler les personnages burlesques, le public étant partie prenante du show, chacun recevant un nez du clown. Ce parti pris dans la dérision de l’Autre sous sa forme festive et boulimique, détachée des contraintes des habits standardisés et codifiés, renvoie les corps aux rêveries et identifications animalesques, effaçant les limites imposées par le signifiant. Cela produit une création dite « libre » qui saisit le spectateur dans le mouvement d’une danse presque chaotique des figures fantastiques. Ce retour à l’enfance se présente comme le début d’un curriculum vitae, occasion pour le créateur de tisser le fil de ses prochains défilés.
Dans son Séminaire, Lacan évoque la pratique du tissage au moins à deux reprises. D’abord dans L’Éthique de la psychanalyse où il s’intéresse au manteau de saint Martin, coupé en deux pour revêtir l’autre corps. Suivant le fil du signifiant, il dira que « le textile est d’abord un texte3 », pour préciser que le tressage n’est pas fait pour envelopper un corps qui lui préexisterait mais constitue un tissu symbolique, une dynamique du lien social où circulent les étoffes. Puis, dans Encore, l’accent est mis sur le corps et sa façon de se tisser, à travers une image qui vient de la nature : « ce travail de texte qui sort du ventre de l’araignée, sa toile4 ». Le corps est ici réduit non pas à la projection d’une surface mais « aux dimensions de la surface qu’exige l’écrit5 ». Le textile, le texte, glisse dans l’écriture : « Fonction vraiment miraculeuse, à voir, de la surface même surgissant d’un point opaque de cet étrange être, se dessiner la trace de ces écrits, où saisir les limites, les points d’impasse, de sans-issue, qui montrent le réel accédant au symbolique.6 » Ici, le corps et la toile sont saisis sur la surface de l’écriture qui matérialise le surgissement de la substance jouissante.
Ainsi, le dé-filé First Circus de Julien Fournié, pris à la lettre d’un fil qui se dé-file à rebours du spectacle, donne à voir le tissage même de sa création et interroge : dans quelle mesure le corps peut-il se décoller du fantasme et des contraintes du marché pour que l’acte créatif puisse enfin s’envoler vers le ciel ? Dès lors, sa proposition Je hais la mode, à l’origine de sa suture, ne pourrait-elle pas se lire dans la modalité de l’être du sujet : « je est la mode », qui arrime la création à la pulsion vivifiante d’un corps en devenir7 ?
Ana Dussert
[1] Le texte s’inspire des échanges avec Julien Fournié dans le cadre du vecteur « Le corps, pas sans la psychanalyse » (L’Envers de Paris).
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 12.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 268.
[4] Lacan J., Encore, op. cit., p. 86.
[5] Ibid.
[6] Ibid.