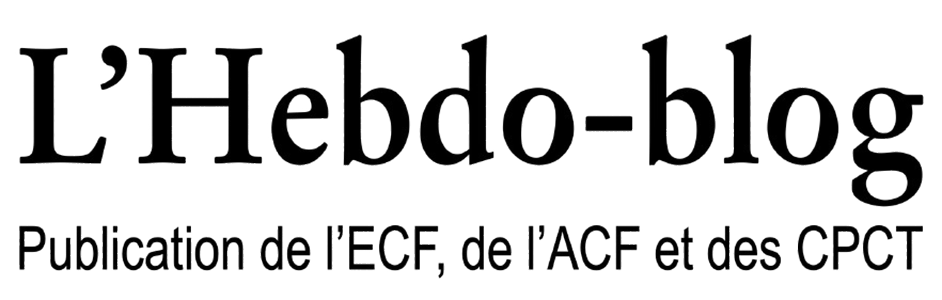Le signifiant crise fait aujourd’hui partie de la langue commune. Au sens psychanalytique, une crise s’articule autour de la dimension de l’urgence subjective où l’angoisse est au premier plan, et au concept d’acte. L’acting out est une monstration adressée à l’Autre d’une jouissance ignorée du sujet lui-même. Le passage à l’acte est rejet de l’inconscient ; c’est « un Non ! proféré à l’adresse de l’Autre1 » ; ainsi en est-il du passage à l’acte suicidaire, avec le risque de perdre la vie. L’acte fait effraction, fait perdre tous les repères, sidère le sujet et son entourage. C’est le moment où le discours, les mots, les rites, la routine, tout l’appareil symbolique s’avèrent soudain impuissants à tempérer un réel qui n’en fait qu’à sa tête, qui se déchaîne et est impossible à maîtriser. L’acte fait donc coupure : ce qui était n’est plus, et ce qui sera n’est pas encore.
Ainsi la crise associe dans l’urgence l’idée de danger et d’opportunité, celle d’ouvrir vers du nouveau ; c’est son paradoxe. C’est donc un moment auquel, du point de vue de la psychanalyse, il faut donner toute sa valeur. Sur les plans clinique, éthique et politique.
L’expérience analytique enseigne en effet aux analystes eux-mêmes et aux analysants, qu’avant le début de l’analyse, la fonction psychanalytique a rapport avec l’urgence subjective. Celle-ci est la modulation temporelle qui répond à l’advenue ou l’insertion d’un traumatisme, c’est l’émergence de ce qui fait trou dans la représentation, expérience énigmatique de jouissance. Ou bien elle presse le sujet angoissé vers un dépassement par la parole ; ou bien elle le précipite dans l’acte comme appel à l’Autre, ou encore dans le passage à l’acte, comme séparation de l’Autre.
L’urgence subjective rappelle que l’inconscient est d’abord réel2, effet hors sens de la percussion de la matière langagière sur le corps, avant l’émergence du sujet de la parole. Il fait trou. Le troumatisme3 est donc de structure chez le parlêtre. Pour tout sujet, en effet, le corps vivant, c’est le corps affecté de jouissance4. L’appareillage par le système langagier est la défense qui lui sert à serrer, à border quelque chose de ce trauma inaccessible. Cette défense est dérangée quand un évènement contingent résonne au plus extime de lui-même, et rend insupportable sa douleur d’exister.
C’est le cas du sujet névrosé quand, perdant brutalement l’assurance qu’il tient de son fantasme inconscient, il se retrouve angoissé. C’est le cas, lorsque l’appareillage symbolique précaire d’un sujet menace de s’effondrer. Jusqu’au cas du sujet sans défense, quand dans la psychose « l’extériorité du signifiant et de la jouissance y est poussée jusqu’à sa dernière conséquence. La jouissance y est laissée à elle-même, rejetée du langage et, forclose du symbolique, elle fait retour dans le réel5 ».
Devant ce moment subjectif, faut-il qu’il y ait des psychanalystes présents en acte dans le tissu social ! et du6 psychanalyste pour en répondre ! Différemment et toujours singulièrement selon la forme avec laquelle la crise se présente. Du psychanalyste que son désir en acte rend disponible pour en saisir l’urgence : « Quand pouvez-vous venir ? Venez ! » ; ou bien : « J’y vais ! ». Parions que l’enseignement de Lacan et sa pratique ont laissé une trace durable7, et que l’orientation de la psychanalyse vers le réel s’emploie à la maintenir vivante.
Bernard Porcheret
[1] Miller J.-A., « Sur le concept lacanien du passage à l’acte », La Cause du désir, n°116, avril 2024, p. 16 : « Au cœur de tout acte, il y a un Non ! proféré à l’adresse de l’Autre ».
[2] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne, Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 15 novembre 2006, inédit : « Voilà ce qui aimante Lacan à la fin de son Séminaire, c’est un autre mode, une autre perspective sur l’inconscient qui fait de l’inconscient du réel. C’est en quelque sorte l’inconscient en tant qu’extérieur au sujet supposé savoir, extérieur à la machine signifiante qui produit du sens en veux-tu en voilà pour peu qu’on la laisse tourner selon ce qu’on se croit obligé de faire. Cet inconscient comme réel, on peut dire qu’il a ou qu’il est analogue, homologue, à ce que nous évoquions d’abord du traumatisme ».
[3] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes-errent », leçon du 19 février 1974, inédit.
[4] Cf. Miller J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause freudienne, n°44, février 2000, p. 17 : « Lorsque nous disons “le corps vivant”, nous écartons ce corps symbolisé comme aussi bien le corps image. Ni imaginaire, ni symbolique, mais vivant, voilà le corps qui est affecté de la jouissance. Rien ne fait obstacle à ce que l’on situe la jouissance comme un affect du corps ».
[5] Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience analytique », La Cause du désir, n°93, septembre 2016, p. 110.
[6] Lacan J., « Du sujet enfin en question », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 236 : « Au moins maintenant pouvons-nous nous contenter de ce que tant qu’une trace durera de ce que nous avons instauré, il y aura du psychanalyste à répondre à certaines urgences subjectives ».
[7] Cf. ibid. et Lacan J., « L’acte psychanalytique », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 378 et 379.