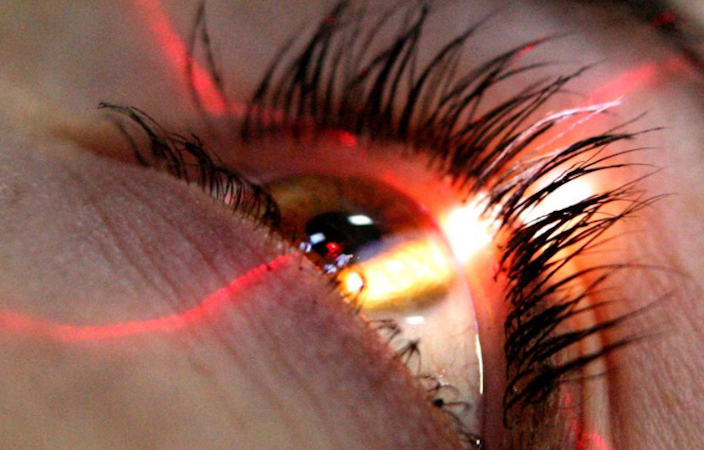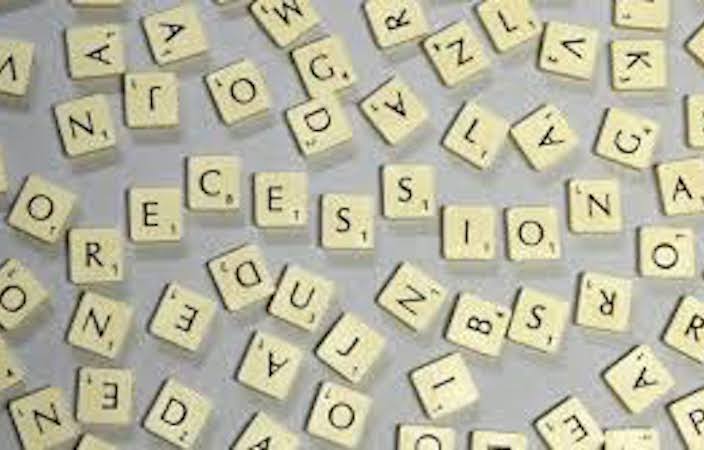Si aujourd’hui on a remplacé la toxicomanie par l’addiction c’est que l’on veut faire d’une tendance du corps et de l’être une affection du cerveau.[1] Nous ne sommes pas tous égaux dans l’addiction au niveau du corps. C’est une inégalité réelle, mais aussi une singularité, sexuelle, un mode de jouir particulier et là vient aussi l’incidence de la culture, de l’histoire de chacun, ce que Lacan appelait le symbolique. Ce qui compte aussi c’est la prise du plaisir et de la jouissance dans le langage, dans l’effet des paroles décisives. Évidemment à ce niveau l’alcool ne parle pas. Mais le vin est lui un produit bavard, intarissable. En cela ce n’est pas « un alcool comme les autres ». Les anciens grecs ajoutaient de l’eau ou du vin dans le cratère pour réguler la conversation.
Au fond il semble que l’on aime aujourd’hui les amoureux du vin plutôt que les buveurs. Les amoureux sont ceux qui en parlent plus qu’ils n’en consomment. Cela peut aboutir à un discours amoureux du vin, souvent savant, qui parfois nous ennuie. On y énumère les défauts du vin, on cherche à impressionner le touriste ou la voisine, avec un vocabulaire obtus.
La modération passe elle dans le volume du verre, devenu aussi minuscule en quantité que le bavardage est plus volumineux. Certains regrettent que l’on ne boive plus mais qu’on déguste. On recrache aussi, l’estomac ne compte plus mais le foie, lui, est sauf ! Et même l’on risque de fabriquer des vins dont on parle plutôt que des vins que l’on puisse boire, voire des vins fabriqués à partir des images cérébrales, des neurowines. On s’adresse plus au cerveau et moins au corps. Le sang n’est plus du raisiné, la vigne se détache de ses mystères pour être mise à nue par des experts qui disent le vrai sur le vin et font fuir la déesse éméchée !
Freud dans la Psychologie de la vie amoureuse remarque que l’homme est fidèle à son toxique, à son vin, par exemple. Cette fixité de l’objet dans l’addiction et dans l’amour contraste avec la mobilité de l’objet du désir, en particulier chez l’homme. L’amour passion va de pair lui aussi avec une fixité de l’objet que n’ont jamais pu approcher les théories comportementalistes ou à base de neurophysiologie qui sont très à la mode aujourd’hui.
La modération passerait-elle donc par le passage au symbolique de l’oralité première, sauvage et cannibale, amoureuse, parfois un peu « sale » aussi ? On regrette la passion des vrais amoureux qui vont eux jusqu’au corps à corps, parfois sans un mot. On est loin aussi de L’Assommoir, du remède à la douleur d’exister, douleur qui n’est pas égale pour chacun. Avant c’était celle des corps brisés par la mine et par la chaine ou la machine. Aujourd’hui l’alcool, plus que le vin, est le remède au burn-out, au chômage, et au divorce. Remède au souci, mais surtout à l’ennui, principale raison avancée aujourd’hui chez les sujets qui se trouvent dans l’excès de boisson.
Freud remarque aussi très vite que l’alcool a un trait particulier, c’est qu’il permet de se rendre indépendant du monde extérieur, en particulier du lien social. Il réunit les sujets parfois mais il sépare souvent, comme toute addiction ! L’ère de l’individu c’est aussi l’ère de la solitude et donc des addictions.
Pour conclure j’emprunterais à l’évêque de Saint Claude dans le Jura, bénissant le vin jaune en 2017, le fait que le réel c’est ce qui cloche, il citait Lacan ! Ce brave homme pensait lui que le Christ pourrait arranger ça ! Évitons nous pourtant de vivre dans un monde qui voudrait faire disparaître ce qui cloche avec tous les abus !
[1] Intervention à la Cité du Vin (bordeaux), 10 mars 2018, journée organisée par l’ACF-Aquitania.