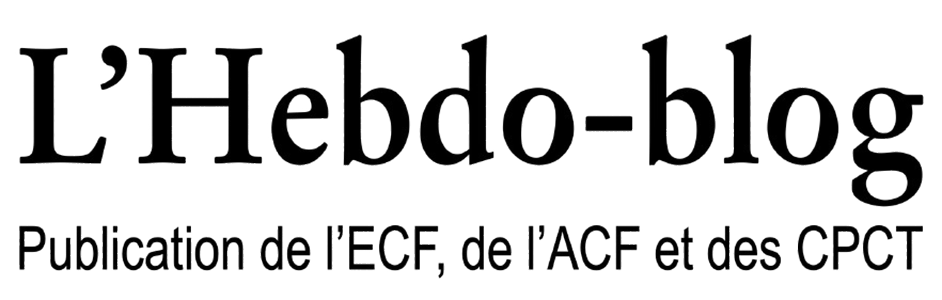Le déclin du symbolique entraîne avec lui la déflation de la parole et le discrédit de la psychanalyse. Pour sortir du signifiant qui relèverait d’un système de croyance obsolète, la science s’avance comme une approche plus fiable et objective. Pourtant, n’est pas athée qui veut.
Les forces symboliques
Dans leur ouvrage Pulsion, Frédéric Lordon et Sandra Lucbert accusent la psychanalyse d’être « passée […] du côté des forces de l’ordre symbolique1 », soit de se faire garante de l’ordre dont le Père est le pivot. Mais leur ambition de l’en sortir ne les rend pas pour autant athées. Ils démantèlent les apports freudiens et lacaniens au profit d’une « Force animatrice générale » ; leur psychanalyse « géométrique et matérialiste » est une tentative, avec Spinoza, de mathématiser autant que possible la pulsion – espérant ainsi sortir le monde de son malaise contemporain : « capitalisme forcené », « retour du fascisme ». Alors que leur travail semblait avoir le mérite de réintroduire « la pulsion […] absentée du discours », ils n’échappent pas à une croyance en un savoir qui fonctionne sans sujet et sans le réel du corps. Sur ce point, l’apport de Lacan est tout à fait renversant.
Le Dieu des philosophes
La célèbre expérience pavlovienne, où le chien finit par saliver au seul bruit de la cloche, serait la démonstration scientifique par excellence d’une causalité neuronale. Lacan en fait une lecture tout autre, non pour viser « une critique absolue » mais « pour ce qu’elle nous apporte de suggestion quant à ce qui est de la position analytique »2. Ce que méconnait Pavlov, c’est qu’il est lui-même inclus dans son expérience ; il est le sujet de la science, représenté par le bruit de la cloche. L’organisme du chien se trouve ainsi trompé par la prise d’« un effet de signifiant, sur un champ qui est le champ du vivant ». Il n’y a donc, « là où est le langage, […] aucun besoin de chercher une référence dans une entité spirituelle »3. Car croire que c’est dans le cerveau suppose que le savoir soit déjà-là, préexistant, et qu’il n’y aurait plus qu’à le trouver ! Ce n’est rien d’autre qu’une croyance, héritière du Dieu des philosophes : le monde de la science moderne est ainsi mathématisable, ordonné par des lois, tels que l’étaient les cieux de l’Antiquité. C’est pourquoi Lacan dit que la science est « fermement théiste 4 », comme le restent F. Lordon et S. Lucbert.
Au-delà du Père
Lacan fait effectivement équivaloir le sujet supposé savoir à « Dieu lui-même », au « Dieu des philosophes »5, mais si l’analyste le met en fonction, il ne lui est pas demandé d’y croire. Il connaît de sa propre expérience son destin de déchet. L’analyse produit l’inconscient en tant que savoir nouveau, et non déjà-là, mais c’est un savoir troué : aucun signifiant ne peut dire la jouissance.
Dès lors, la voie toute signifiante est autant une impasse que celle de la science dont le savoir « fonctionne à côté du réel6 ». L’une comme l’autre ratent à cerner l’incommensurable qui cause la division du sujet. Alors, de la science, Lacan extrait la logique ; il « manie cette algèbre, […] le $, le a, voire le A et l’i(a)7 », pour réinventer la pratique psychanalytique au-delà de l’ordre symbolique, du père et de l’Œdipe. L’acte analytique « tient d’une seule main » le fil du sujet supposé savoir et celui de l’objet, permettant à un sujet de se perdre pour s’y retrouver jusqu’à serrer le réel de sa jouissance – soit la seule façon d’être réellement athée, de sortir des mirages du tout calcul aussi bien que du tout symbolique.
Sarah Camous-Marquis
[1] Lordon F. & Lucbert S., Pulsion, Paris, La Découverte, 2025, p. 11.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’Acte psychanalytique, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil & Le Champ freudien, 2024, p. 21.
[3] Ibid., p. 23.
[4] Ibid., p. 164.
[5] Lacan J., « La méprise du sujet supposé savoir », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 337.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’Acte psychanalytique, op. cit., p. 297.
[7] Ibid., p. 153.