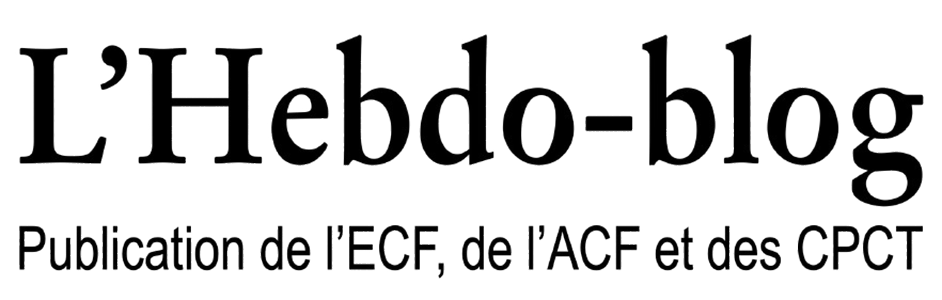« L’expérience nous suggère de chercher le sens de toute identité, au cœur de
ce qui se désigne par une sorte de redoublement de “moi-même”. »
Jacques LACAN, Le Séminaire, livre IX, « L’identification »
Le mirage contemporain de l’identité et de l’individu auto-nome, transparent à lui-même et pouvant dire tout de son être sans division, n’est pas sans conséquences sur les subjectivités et le lien social : replis identitaires et communautaires, montée des totalitarismes…
L’œuvre de Philip Roth, écrivain américain incontournable de la littérature contemporaine, est un antidote puissant aux revendications identitaires et à l’idéal de transparence à soi-même qui marquent notre époque. Sa façon de traiter la question de l’identité en fait surgir l’opacité irréductible. Il plonge le lecteur dans un jeu savant de doubles, une mise en abîme vertigineuse qui met en lumière le caractère mouvant et multiple des identifications, l’impossibilité de les résorber dans une unité, et la difficulté pour chacun de savoir qui il est. Sur fond de contradictions et ratages, ses personnages rencontrent à un moment une énigme quant à ce qu’ils croyaient savoir d’eux. Dans leur quête, ils découvrent la part de ce qui leur vient de l’Autre, des désirs et discours qui les ont précédés, mais aussi la part irrationnelle, étrangère qui les habite et oriente leurs choix à leur insu. Paradoxes, complexité et vulnérabilité des existences humaines sont mis en scène de façon éclatante.
Dans La contrevie [1], chef-d’œuvre où P. Roth aborde le rapport à la judéité, les récits se succèdent dans la discontinuité, renversant radicalement les versions précédentes sans les annuler. Il met en scène de multiples façons d’être juif selon les lieux et discours dans lesquels les personnages sont pris, dans une polyphonie où toutes les voix se font entendre.
Nathan Zucherman, personnage écrivain récurrent, dénonce le leurre de l’identité de soi à soi : « Être Zuckerman est un long numéro continu, tout le contraire de ce qu’on appelle être soi-même. De fait, ceux qui paraissent le plus eux-mêmes me font l’effet d’imiter ce qu’ils croient vouloir être, devoir être, ou passer pour être aux yeux de ceux qui fixent les critères. Ils sont tellement sincères qu’ils ne s’aperçoivent pas que leur sincérité fait partie du jeu. » [2]
À travers l’exemple de la circoncision, il récuse « le rêve d’une vie matricielle dans un superbe état d’innocence préhistorique, l’idylle séduisante de la vie “naturelle”, libérée de tout rituel fabriqué par l’homme. Naître c’est perdre tout ça. » [3]
La déconstruction qu’il opère va jusqu’au suspens du sens, faisant résonner l’abîme entre signifiant et signifié : « “Bon Dieu, mais en quoi ça consiste, être juif ?” Pour y répondre, il y en a qui perdent leurs fils, d’autres un bras ou une jambe, on perd ceci, on perd cela. “Qu’est-ce que c’est qu’un Juif au départ ?” Question qui n’est pas d’hier : le son “juif” n’est pas tombé du ciel comme une pierre. Il a bien fallu qu’une voix humaine articule “ju-if”, en montrant quelqu’un du doigt. C’est ainsi qu’a commencé ce qui n’a pas cessé depuis. » [4]
Faisant chuter l’illusion d’une identité univoque et idéale, P. Roth en dénonce de façon percutante les dangers, avec le retour du réel de la haine et de l’antisémitisme à la fin du livre. Il démasque, sous les idéaux et revendications identitaires, une jouissance obscure agissant à l’insu des sujets.
Lire son œuvre produit un effet de réveil précieux !
Florence Smaniotto-Giusto
______________________
[1] Roth P., La Contrevie, Paris, Gallimard, 2004.
[2] Ibid., p. 445.
[3] Ibid., p. 450-451.
[4] Ibid., p. 205.