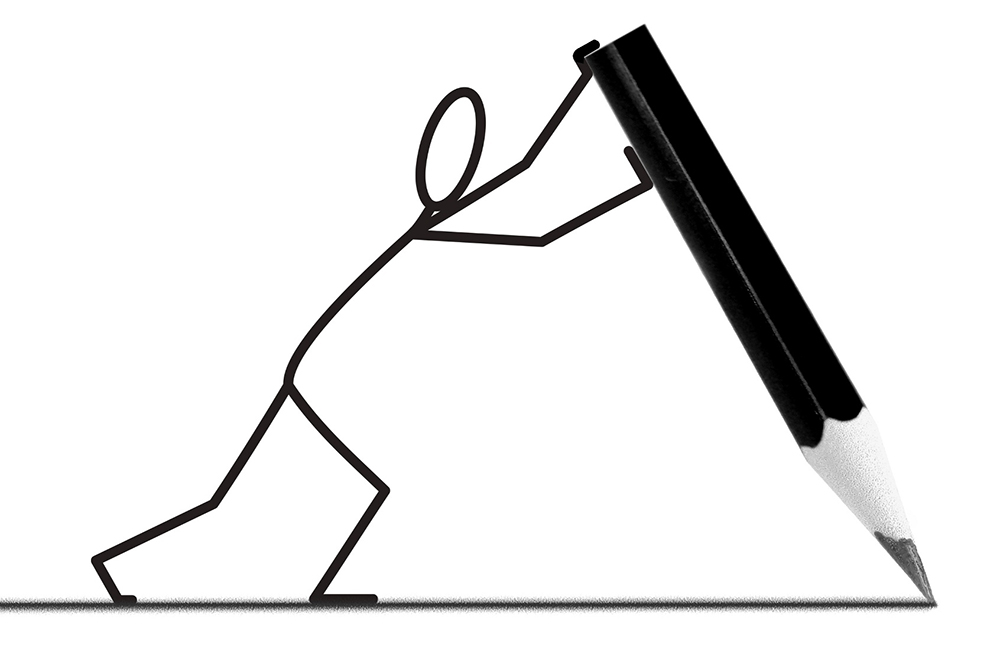L’intimité que l’homme habite était sacrée. Elle est devenue profane. C’est qu’entretemps, depuis le « Temple de l’esprit » augustinien jusqu’aux « Temples inhabités » de la subjectivité moderne, le monde s’est désenchanté. Où le sujet habite-t-il alors ? Quand Lacan met l’accent sur sa vacuité, il convoque les dimensions du discours comme « maisons du dit ».
Le parlêtre habite le langage mais, demande Lacan dans « L’étourdit »[1], concernant les hommes et les femmes et l’absence de rapport sexuel entre eux, est-ce l’absence de rapport sexuel qui les « exile en stabitat » du langage ? Ou est-ce d’habiter le langage (« labiter ») qui rend le rapport sexuel interdit ? « Labiter » du langage est le fait du discours qui convoque un sujet que l’on dirait « labile » mais le « stabitat » du langage n’est-ce pas l’objet a ? À l’horizon déshabité de l’être, le véritable secret, l’intérior intimo meo d’Augustin, c’est cette Autre scène où l’inconscient cache autant qu’il révèle ma jouissance la plus indivise. Cette place n’est « place de Plus-Personne »[2].
Rose-Paule Vinciguerra
[1] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 455.
[2] Lacan J., « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache : “Psychanalyse et structure de la personnalité”, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 667.
À propos du livre de Jean-Louis Chrétien : L’espace intérieur[1]
« Intérior intimo meo » : Dieu plus intime que mon intime. Ainsi Lacan, citant Saint Augustin, forge-t-il le terme d’extimité : c’est bien de cela qu’il s’agit dans cet ouvrage dont l’auteur dessine, à travers les figures les plus éminentes de la Théologie, la Philosophie et la Littérature (d’Augustin à Freud), une généalogie du sujet occidental centrée sur la notion paradoxale d’espace. Bien au-delà de la représentation métaphorique de l’âme par les emblèmes du corps, (cœur dans la doxa traditionnelle ou cerveau dans notre culture scientifique), il s’agit ici d’une véritable topique de l’intériorité dont la puissance descriptive et la dynamique constituent, selon l’auteur, un véritable paradigme de l’identité humaine, trouvant dans la notion moderne, et combien problématique, du « moi » » son dernier avatar.
De la Chambre du cœur d’Origène, aux Châteaux de Thérèse d’Avila, en passant par le Temple de l’esprit d’Augustin, il s’agit toujours de maisons, de demeures, de figures de « l’habiter. Car habiter est une dimension constitutive de l’existence »[2]. Ce sont des lieux d’accueil, d’attente, de l’hôte divin : mais tandis que la Chambre du cœur, terme d’origine évangélique, est avant tout un lieu de prière et d’exposition nue à Dieu, le Temple de l’esprit où figure un « autel intérieur », désigne avec force le déplacement vers l’intime, propre au message biblique, des rituels du sacrifice. « Là où il faut sacrifier, c’est là aussi qu’il faut prier. » La primauté du sacrifice sur la prière, instaurée par Augustin[3], ouvre l’intériorité de façon inouïe : l’intimité comme « abîme », selon le mot d’Augustin « bée de toutes parts ».
Le basculement vers le profane: le temple inhabité
Cet espace intérieur, une fois ouvert et articulé, ne peut se refermer mais il se prête à des renouvellements et des recompositions. L’auteur parcourt la culture occidentale à partir de ces points de « basculement » où la Chambre du cœur devient un lieu profane, du « cabinet » ou « arrière-boutique » de Montaigne, jusqu’à « l’appartement » de Freud, lieu privé par excellence. Avec Montaigne, mais aussi Pascal, à qui l’on doit « l’invention du moi », relayés ensuite par Rousseau et Kant, la vie intérieure bascule : la « boutique est le lieu où l’homme est seul avec lui-même », sa quête n’est plus de vérité mais de sincérité. L’édification du temple devient mon œuvre propre. La topique théologique devient topique psychologique où le moi, réduit à la « maison psychique », s’entretient incessamment avec lui-même.
Ainsi sommes-nous conviés à visiter ces « temples inhabités » où le moi est plus ou moins confiné dans les profondeurs souterraines: sous-sols de Dostoïevski, galeries abandonnées chez Baudelaire, ou caveaux souterrains d’Edgar Poe : « Sinistre métamorphose de la Chambre du cœur », que Kafka résume à sa façon : « Tout homme porte une chambre en lui… Quand un homme marche vite et que l’on écoute attentivement, la nuit peut-être, tout étant silencieux alentour, on entend par exemple le brimbalement d’une glace qui n’est pas bien fixée au mur »[4]. Le meuble dominant de ce temple de l’esprit, devenu chambre à coucher, n’est plus l’autel, mais le miroir.
À l’encontre de la thèse de Max Weber, pour qui le retrait de Dieu et la crise de la foi chrétienne résultent de la naissance et du développement de la physique mathématique, Jean-Louis Chrétien y voit une conséquence, bien antérieure, du schisme luthérien et des guerres de religion. Le « moment Montaigne » est, à cet égard, décisif. Le facteur essentiel n’est pas la désacralisation scientifique de la nature, mais l’organisation de l’espace intérieur, point critique où se joue le statut de l’identité humaine. Une question, que l’auteur laisse sans réponse, donne la mesure de ce moment de bascule : « Que se passe-t-il lorsque la foi devient croyance? »[5] À ce glissement, ce déplacement de sens dans le rapport au Savoir et à l’Autre, Freud et Lacan, surtout, apportent un éclairage qui permet de dépasser le dilemme où semble nous enfermer la thèse de l’auteur : ou bien « la chambre du cœur » ouverte à la présence de l’hôte divin, ou le temple désaffecté de la subjectivité moderne.
Ces deux postures ont, en effet, un point commun: la référence à un « espace », modalité propre au psychisme, comme en témoignent les topiques freudiennes et la topologie lacanienne. À la différence de la conscience de soi, punctiforme mais fugitive, le psychisme s’inscrit dans un espace qui, seul, permet de faire sa place au vide, à l’écart, l’intervalle, le suspens. Ainsi, l’après-coup qui structure la mémoire inconsciente, est une catégorie spatiale, où, comme le dit bien la formule : quelque chose peut « avoir lieu », c’est-à-dire s’inscrire, demeurer et insister alors que, dans le temps, tout s’efface et s’abolit.
Lacan met l’accent sur cette vacuité essentielle à l’émergence du sujet, à cet espace intérieur qu’il traduit à sa façon: les dimensions du discours sont les « maisons du dit », ses dit-mensions, articulées par le déploiement de la chaîne signifiante, dont les hiatus, coupures, accrocs et trébuchements désignent, en creux, le sujet, comme question, perplexité, désarroi.
L’Autre, ses masques et ses avatars
Ce sujet n’est donc pas solitaire, et il faut réfuter la vision réductrice que l’auteur nous propose de la topique freudienne, lorsqu’il dénonce « le caractère solitaire de cet appartement psychique, réduit à deux pièces »[6]. L’Autre est là, au cœur extime de l’être, mais, à la différence du visiteur divin, pourvoyeur de Grâce et de lumière, il impose au sujet le tourment de son désir énigmatique. On peut donc tirer profit de la psychanalyse et de l’enseignement de J. Lacan et récuser l’idée « qu’un paradigme s’est éclipsé de la conscience commune »[7].
De même, à la question du passage de la foi à la croyance, on peut répondre, en termes lacaniens, que la foi s’adresse à un Dieu largement inscrit dans des coordonnées symboliques, c’est-à-dire un discours, un récit, un événement, alors que la croyance, livrée aux aléas de la conscience individuelle (voir le schisme luthérien) ne trouve son ressort que dans le lien affectif, et angoissé, à un Dieu imaginaire, celui de Kierkegaard et son cortège de « Crainte et de Tremblement ».
Lacan ne nous dit-il pas, là-dessus, le dernier mot?
« Ceci nous permet d’arriver à une formule condensée […] Le désir du névrosé, dirai-je, est ce qui naît quand il n’y a pas de Dieu […] Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, à savoir que la situation est plus simple quand il y en a un. Je dis que cette suspension du Garant suprême est ce que cache en lui le névrosé, et que c’est à ce niveau que se situe, s’arrête et se suspend le désir du névrosé »[8].
[1] Chrétien J.-L., L’espace intérieur, Paris, Les Éditions de Minuit, 2014.
[2] Cité par J.-L. Chrétien, op.cit., p. 257.
[3] Saint Augustin, Le maître (De Magistro), chap. 1, § 2, Paris, Klincksieck, coll. Philosophie de l’éducation, 2002. Cité par J.-L. Chrétien, ibid., p. 73.
[4] Kafka F., Œuvres complètes, t. II, éd. David, Paris, 1980, p. 457. Cité par J.-L. Chrétien.
[5] Chrétien J.-L., op. cit., p. 239 et 243.
[6] Chrétien J.-L., op.cit., p. 244.
[7] Ibid., p.245.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, La Martinière & Le Champ freudien, coll. Champ Freudien, juin 2013, p. 541.