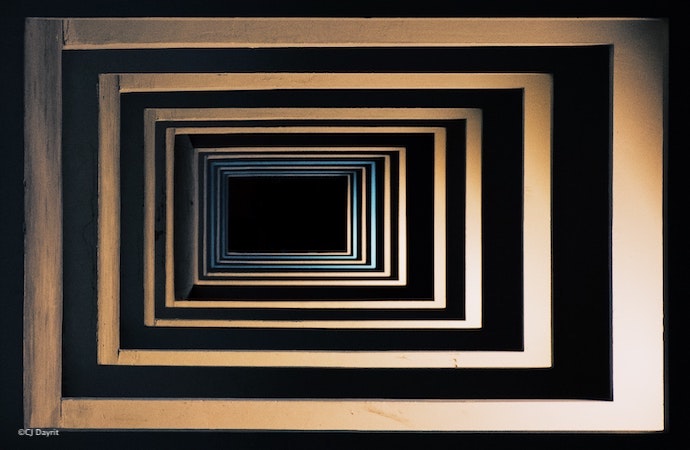Lire « Télévision » c’est tomber sur des formules inédites à chaque page, des formules chocs, parlantes et énigmatiques à la fois, parfois déjà lues, sans forcément savoir qu’elles prennent leurs origines dans cette communication de 1974. L’entrée est double pour accéder à « Télévision », soit par l’émission filmée intitulée Psychanalyse [1], réalisée par Benoît Jacquot, soit par le texte publié [2] et annoté en marges par Jacques-Alain Miller, offrant ainsi un fil d’Ariane pour la lecture.
Lire Lacan, c’est toujours un engagement, ça passe par le corps souvent, au sens où ça résonne sans qu’on puisse toujours l’expliquer. Cependant, on ne recule pas à s’y mettre, car, comme le dit Lacan, et « le discours analytique […] fait promesse : d’introduire du nouveau » [3], notamment en livrant des clés conceptuelles pour lire le malaise dans la civilisation.
Dans le chapitre V de « Télévision », intitulé « L’égarement de notre jouissance », Lacan prophétise la montée du racisme. Il ne se contente pas de le dénoncer, il en indique la racine avec ce terme peu commun d’égarement. Ainsi, la montée du racisme et de la ségrégation sont-ils les conséquences de « l’égarement de notre jouissance » [4]. Comment le saisir ? Partons d’un constat : à l’ère de l’Autre qui n’existe pas, les jouissances ne s’ordonnent plus de la même façon. À défaut de se localiser dans un Autre, on observe une adhésion à des communautés de jouissance, chacune fondée sur un mode de jouir particulier. Le sujet esseulé, voire déboussolé, y trouve à l’occasion une identité.
La clinique avec les adolescents et adolescentes nous l’enseigne. L’une d’elles m’explique qu’elle se sent mieux depuis qu’elle se définit comme « polyamoureuse », elle aime l’idée du sans limite, de la grande liberté que cette orientation offre. Une autre évoque son malaise quand elle est subitement attirée par une autre fille. Et de dire son soulagement quand elle a enfin compris qu’elle était « pansexuelle », ce qu’elle définit comme le fait d’être attiré par une personne, sans que n’entre en considération son sexe et son genre. Donc, autant de communautés que de modes jouir.
On repère cependant que la multiplication des communautés fragmente le lien social, en même temps qu’elle signe un changement de paradigme, « ce n’est [plus] le choc des civilisations, mais le choc des jouissances » [5], écrit Éric Laurent. On comprend alors que sans balise symbolique, c’est l’égarement. Lacan l’a saisi en 1973 lorsqu’il dit que « Dans l’égarement de notre jouissance, il n’y a que l’Autre qui la situe, mais c’est en tant que nous en sommes séparés. D’où des fantasmes inédits quand on ne se mêlait pas »[6]. É. Laurent précise : « Nous ne savons pas ce qu’est la jouissance dont nous pourrions nous orienter. Nous ne savons que rejeter la jouissance de l’autre » [7]. Lacan, puis J.-A. Miller, définissent le racisme contemporain, comme « la haine de la façon particulière dont l’Autre jouit » [8]. On saisit alors que l’intolérance est toujours celle de la jouissance de l’autre, qui peut aller jusqu’à la ségrégation. Car c’est bien le refus de la différence, de la singularité, de la séparation qui est au fondement du racisme. Face à l’autre qui jouit différemment, Lacan nous avertit que la tentation est grande de vouloir unifier, uniformiser ce qui échappe, et que « [l]aisser cet Autre à son mode de jouissance, c’est ce qui ne se pourrait qu’à ne pas lui imposer le nôtre, à ne pas le tenir pour un sous-développé » [9]. Les deux jeunes filles, dont j’ai évoqué la position face à l’amour, le font raisonner quand elles témoignent de leur incompréhension, voire de la querelle qui les opposent à leurs mères. Elles ont en commun d’avoir des mères féministes, qui ont toujours défendu le droit des femmes. Malgré cela, chacune de ces mères, à sa façon, refuse de soutenir le choix de sa fille, interprété comme une incapacité à s’engager pour l’une et comme un effet de mode et d’influence pour l’autre. Il ne s’agit pour nous ni d’adhérer au propos ni de s’y opposer, mais d’en faire usage pour soutenir une réponse au cas par cas, à partir du rapport que chacune entretient à sa jouissance. Grâce à Lacan « on peut déchiffrer notre présent dans sa grammaire et entrevoir la grimace de l’avenir qui nous attend » [10], cette lecture renouvelée du monde qui réveille.
[1] Jacquot B., Jacques Lacan : psychanalyse, parties I & II, film, France, 1974, disponible sur le site de l’INA.
[2] Lacan J. « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 509-545.
[3] Ibid., p. 530.
[4] Ibid., p. 534.
[5] Laurent É., « Le racisme 2.0 », Lacan Quotidien, n°371, 26 janvier 2014, publication en ligne.
[6] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 534.
[7] Laurent É., « Le racisme 2.0 », op. cit.
[8] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Extimité », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 27 novembre 1985, inédit.
[9] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 534.
[10] Miller J.-A., « Les prophéties de Lacan », entretien, Le Point, 18 août 2011, disponible sur internet.