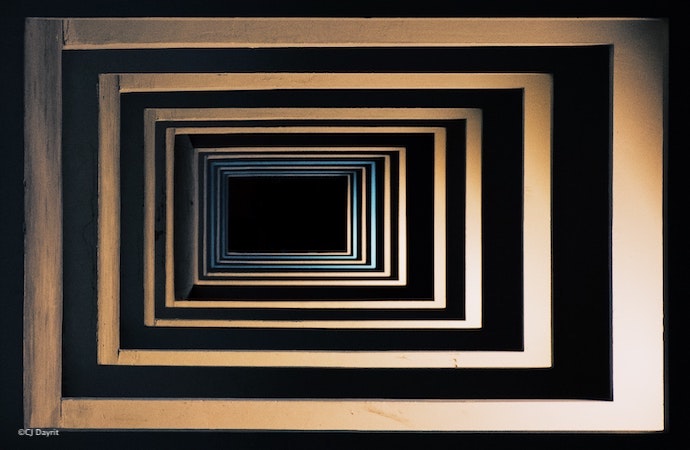Au chapitre IV de « Télévision », Jacques-Alain Miller reprend la critique adressée à Lacan par ses détracteurs : « vous avez avancé votre formule, que l’inconscient est structuré comme un langage [: “]Et de ce qui ne s’embarrasse pas de mots, qu’en faites-vous ? Quid de l’énergie psychique, ou de l’affect, ou de la pulsion ?” » [1]
Ce qui ne s’embarrasse pas de mots est supposé avoir un accès direct, non médié par le langage, à la vérité. L’affect serait ici en bonne place si l’on en croit la médecine contemporaine pour laquelle il est en adéquation avec la chose, adaequatio rei affectus, comme dans le cas de la dépression dite réactionnelle. La psychologie, avec le coaching bien-être, n’est pas en reste quand elle prétend maîtriser les émotions, situant l’affect en termes d’énergie en plus ou en moins. Au contraire, pour Freud, la domination du principe de plaisir dans la vie psychique « repose sur l’hypothèse selon laquelle l’appareil psychique a une tendance à maintenir aussi bas que possible la quantité d’excitation présente en lui ou du moins à la maintenir constante » [2]. Cette tendance à la constance, qui domine la vie psychique, le conduit à l’élaboration du concept de pulsion de mort. Suivant les pas de Freud, Lacan lit l’énergie psychique comme « chiffre d’une constance »[3], elle implique la pulsion de mort, loin des formules énergisantes des théories du bien-être.
Lacan ne remet pas en cause le fait que les affects s’expriment à travers le corps, mais il relève que c’est « de la pensée que ça décharge » [4]. Se tournant vers Saint Thomas d’Aquin, Platon, Dante, il inscrit les affects dans le champ des passions. À partir de là, il peut répondre à la question « un affect, ça regarde-t-il le corps ? » [5] Il existe une anatomie des passions qui découpe le corps, elle rend compte du fait que le corps est affecté par la structure, en tant que le signifiant le découpe, le dévitalise, le vide de la jouissance, comme le note J.-A. Miller [6].
Traiter de passion plutôt que d’émotion permet aussi de « vérifier plus sérieusement » [7] en quoi l’affect a à voir avec l’inconscient structuré comme un langage. En 1986, reprenant pas à pas cette question, J.-A. Miller indique que « dans la psychanalyse, l’affect n’est pas vrai d’emblée, il s’agit de le faire vrai » [8]. L’affect est ressenti, mais la représentation, qui lui était initialement liée, est refoulée : « nous appelons “inconsciente” la motion d’affect originaire, bien que son affect n’ait jamais été inconscient et que seule sa représentation ait succombé au refoulement » [9], note Freud. Parler d’affect inconscient est donc un raccourci de langage. L’affect n’est pas refoulé, il est déplacé ; il est désarrimé du signifiant initial auquel il était rattaché. En cela, l’affect est trompeur. Seul l’angoisse, dont la véritable substance est « le hors de doute », « ne trompe pas » [10].
Lacan prend l’exemple de la tristesse pour « établir, comme le dit J.-A. Miller, en quoi l’affect est effet de vérité » [11]. La tristesse, lue comme dépression, trouve sa cause dans l’âme chez les philosophes, dans la tension psychologique chez Pierre Janet, dans les neurotransmetteurs chez nos modernes psychiatres. Mais dans le registre des passions, elle tient du péché, voire de la lâcheté morale ; la faute ici relève d’un renoncement au bien-dire, ou à « s’y retrouver dans l’inconscient » [12]. Il ne s’agit pas pour l’analyste d’accabler celui qui s’adresse à lui dans sa tristesse, souligne J.-A. Miller. Mais parler de morale ouvre la voie du côté de l’éthique et « concerne le rapport à la jouissance » [13]. Jouissance sans limite dans la manie, où la coupure radicale entre la chaîne signifiante et l’objet a laisse le corps en proie à la métonymie sans fin de chaînes signifiantes n’obéissant plus à aucune structure, jusqu’à l’épuisement mortel.
L’éthique du bien-dire vise à « raser d’aussi près qu’il se peut » [14] l’articulation entre la jouissance et le signifiant. Elle « consiste à cerner, à serrer, dans le savoir, ce qui ne peut se dire » [15] jusqu’à ce point limite où le sujet consent à ce qu’il y ait un reste, un impossible à dire. De cet impossible, l’analyste fait levier pour poursuivre le « gay sçavoir » [16] du déchiffrage dans sa pratique.
* Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 521-528.
[1] Miller J.-A., in Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 521.
[2] Freud S., « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1984, p. 45.
[3] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 522.
[4] Ibid., p. 524.
[5] Ibid.
[6] Cf. Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience psychanalytique », La Cause du désir, n°93, septembre 2016, p. 109, disponible sur Cairn.
[7] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 524.
[8] Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience psychanalytique », op. cit., p. 102.
[9] Freud S., « L’inconscient », Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968, p. 83.
[10] Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 92.
[11] Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience psychanalytique », op. cit., p. 103.
[12] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 526.
[13] Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience psychanalytique », op. cit., p. 110.
[14] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 526.
[15] Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience psychanalytique », op. cit., p. 110.
[16] Lacan J., « Télévision », op. cit., p. 526.