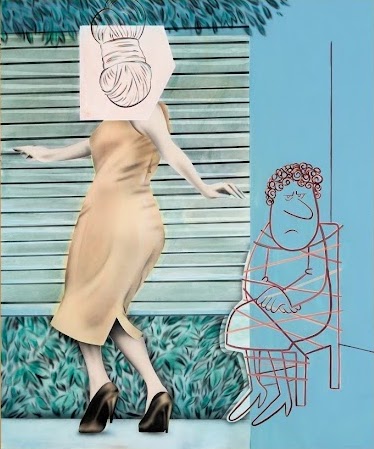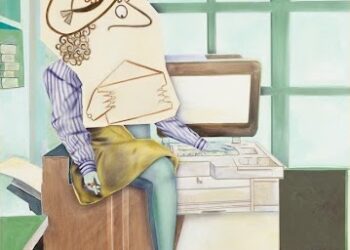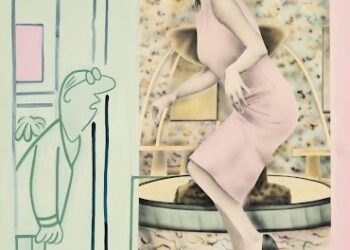Bénéficier d’un « sentiment général d’agrément, d’épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et/ou de l’esprit1 », définition du bien-être, est-ce ce à quoi chacun pourrait légitimement prétendre ? Resterait à savoir comment obtenir cette pleine satisfaction ? La question n’est pas nouvelle, mais telle qu’elle se diffuse dans les discours actuels, portés par le courant de la psychologie positive, elle prend la coloration d’un Encore un effort si vous voulez être heureux ! Cet effort ne sert-il pas de carburant à un surmoi gourmand, masquant la pulsion de mort à l’œuvre ?
Évacuer la pulsion de mort
Martin Seligman2, l’un des pères de la psychologie positive, confie avoir lu Freud avec intérêt mais déplore y avoir rencontré « l’hypothèse qu’il y ait toujours chez l’être humain “ une motivation négative dissimulée ”3 ». Il confirme ainsi l’intuition de Freud que la notion de pulsion de mort « soit […] ressentie […] comme une innovation et une nouveauté très peu souhaitable, qui devrait être éliminée le plus vite possible4 ». N’en parlons pas, elle n’existera pas. Il lui préfère la promotion du bonheur comme un bien de consommation, quantifiable, qu’il s’agit de faire fructifier.
La loi de la mesure
Pourtant, la pulsion de mort se loge au cœur même de l’auto-évaluation nécessaire à cette notion de bonheur. Le chiffre, parce qu’il est moins sujet à l’équivoque que le signifiant, est le meilleur véhicule qui soit pour tenter de chasser du symbolique toute trace du réel, visant à produire un être entièrement transparent à lui-même, mesurable et quantifiable. Or, « renoncer à la jouissance, c’est rendre le surmoi toujours plus exigent5 », nous indique Jacques‑Alain Miller. Le signifiant, par son travail de nomination et de chiffrage, poursuit cette tentative de renoncer à la jouissance, pourtant un bout échappe toujours. Le signifiant, au service du surmoi, est insatiable de ce reste qu’il faut encore et toujours domestiquer. La quête du bonheur en est un exemple notable, c’est une promesse qui ne se réalise qu’à condition d’optimiser sans cesse « au niveau supérieur [sa] marge de bonheur6 » par de nouvelles auto-évaluations, c’est un travail de Sisyphe toujours à recommencer.
Le bonheur « un facteur de la politique7 »
La psychologie positive se trouve ainsi au service du discours du maître qui veut que soit garantie une harmonie entre les hommes, souscrivant à l’idée qu’« il ne saurait y avoir de satisfaction d’aucun sans la satisfaction de tous8 ». À l’universaliser ainsi, le bonheur se réduit à une norme, toujours arbitraire et à une moralisation de la « jouissance qu’il ne faudrait pas9 ». L’analyse invite plutôt à ne pas détourner le regard de cette jouissance amorale. Elle propose plutôt à celui qui s’y aventure, d’en savoir plus sur la façon dont cette jouissance l’habite. C’est là qu’elle situe l’effort à soutenir.
Élise Rocheteau
[1] Entrée « Bien-être », CNRTL, disponible en ligne.
[2] Martin Seligman est un chercheur en psychologie et professeur à l’Université de Pennsylvanie. Il se fait connaître par ses études sur « l’impuissance apprise ». Il fonde comme discipline la psychologie positive en 1998 alors qu’il est président de l’American Psychological Association. Le bonheur fait l’objet chez lui de plusieurs publications.
[3] Freud S., cité par M. E. P. Seligman, in La fabrique du bonheur, Paris, J’ai Lu, 2023, p. 17.
[4] Freud S., « Angoisse et vie pulsionnelle », XXXIIe conférence, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Galimard, 1989, p. 139.
[5] Miller J.-A., « Les conférences de Grenade : Une éthique sans surmoi », 24 novembre 1989, disponible sur Lacan Web TV.
[6] Seligman M. E. P., La fabrique du bonheur, op. cit., p. 17.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 338.
[8] Ibid.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 55.