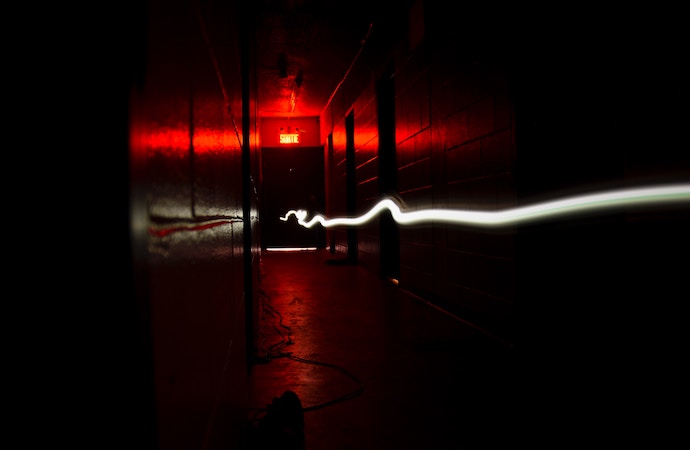Il existe au moins deux lieux où nous pouvons exposer notre pratique comme analyste : le contrôle et la présentation de cas [1].
Présentation
Lors du contrôle, le cas évoqué est choisi, auprès d’un contrôleur analyste qui est choisi également. Au-delà des différents types de contrôle que nous pouvons repérer, les uns plus axés sur la clinique, les autres sur un questionnement concernant notre position dans le transfert, je dégagerai une sorte de constante, à savoir le pari que quelque chose de nouveau va surgir. Nous arrivons en contrôle avec beaucoup d’éléments, quelques hypothèses, une question, et nous repartons la plupart du temps avec une donnée nouvelle qui éclaire l’orientation à tenir concernant la direction de la cure.
Lors d’une présentation de cas, une cure est évoquée auprès d’un public au sein duquel se trouvent des membres de notre communauté. Il s’agit alors d’un travail d’élaboration, de construction et de logicisation de l’expérience, avec une certaine mise en tension entre théorie et clinique. Et si enseignement il y a, c’est plutôt sous le mode de la transmission, puisque nous essayons de faire « passer » quelque chose.
Points de recoupement
Qu’est-ce qui peut relier ces deux modes d’exposition ?
Dans les deux cas, cela a lieu en dehors du cabinet. Il s’agit alors de nous confronter, à travers une prise de parole, à une certaine forme d’intranquillité. La dimension du sujet supposé savoir est présente également pour les deux, qu’elle soit incarnée par l’analyste contrôleur ou par le public lui-même. Et le savoir en jeu est exposé, plutôt que supposé, comme c’est le cas dans le cadre de la pratique-même. Autre point de recoupement, le désir, car ni le contrôle, ni la présentation de cas ne sont obligatoires. Le contrôle est « désiré », pour reprendre un terme de Jacques-Alain Miller [2]. Il s’impose, comme dit Lacan [3], mais il n’est pas imposé, tout est dans ce décalage qui introduit la dimension de l’autorisation et de la responsabilité du praticien. De même l’exposition de cas part d’une simple proposition de la part de ce dernier, et il est tout à fait légitime de considérer cet exercice comme relevant également d’un contrôle. Exposer un cas dans le cadre de notre École, en présence de ses membres, constitue un certain « faire ses preuves », « rendre des comptes », mais sans attendre le moindre jugement de la part de l’Autre. Il est plutôt question ici de « co-responsabilité », comme a pu le souligner J.-A Miller [4], qui se répartit donc entre le praticien et les membres de l’École.
Quel discours ?
Afin d’approcher au plus près la logique de cette double exposition de sa pratique, en privé et en public, et afin de mieux dégager sa nécessité, demandons-nous si un recours aux discours de Lacan pourrait nous être utile.
Commençons par le contrôle, dont la pratique est « mal logée », comme le relevait J.-A. Miller [5]. Être en contrôle, ce n’est pas être sous contrôle, aussi le discours du maître ne doit pas s’y inviter. Et puisqu’il ne s’agit pas non plus d’évaluer notre savoir ou notre capacité, nous excluons la référence au discours universitaire.
Le discours hystérique, avec un sujet barré aux commandes, n’est-il pas à même, par contre, de rendre compte d’une certaine expérience du contrôlant, qui, comme sujet divisé [6], se questionne, interroge sa pratique, sa position, suspend son savoir déjà là pour chercher à en produire un nouveau, et, à l’occasion, peut évoquer les résonances entre sa pratique et son analyse. Et du reste il est arrivé à J.-A. Miller de soutenir qu’une certaine dimension de l’association libre était à l’œuvre au cours du contrôle, association contrainte, bien sûr, puisqu’il est question d’un patient [7]. Dès lors le discours analytique, celui qui formalise l’expérience de l’analyse, s’y invite bien évidemment, la frontière entre l’analyse et le contrôle étant ténue, comme nous le verrons un peu plus loin.
Lors de l’exposition de cas, n’avons-nous pas là encore, en place d’agent, entendons ici celui qui présente un cas, une version du sujet barré, ce qui exclut le fait de mettre S2 aux commandes, auquel cas nous basculerions dans le discours universitaire ? Nous avons donc un sujet-analyste, un analyste-sujet qui met au travail les S1, comme autant de fils qu’il tire et développe au sein de sa construction, véritables points de capiton qui permettent de lire et d’entendre le cas, avec un certain savoir qui se dépose. Et là encore, le discours analytique, dans son acception la plus large, est bien évidemment convoqué, au moment même où l’analyste aborde la logique d’une cure.
S’exposer
À travers cette référence à cette dimension « sujet », on comprend mieux pourquoi exposer, c’est finalement s’exposer, à travers sa parole. C’est le cas dans le contrôle, mais aussi lorsqu’on expose sa pratique en public. Lors des 30e journées de l’ECF [8], l’école avait d’ailleurs convié le praticien à « élaborer comment il analyse, à faire contrôler son acte en s’exposant » [9]. En effet, J.-A Miller avait dressé le constat que jusqu’alors, je le cite, « l’exposé du cas voilait le “s’exposer” du praticien, le laissait implicite » [10].
Cela veut dire tout d’abord qu’il ne doit pas oublier qu’il fait partie de la construction du cas qu’il présente. Mais plus fondamentalement, la question que pose ces deux dispositifs d’exposition de sa pratique que sont le contrôle classique et disons-le maintenant, le contrôle élargi, est celle de savoir si le praticien est bien orienté par le discours analytique, envers du discours du maître, qui constitue aussi le discours de l’inconscient, ce qui est bien fait pour nous maintenir en alerte. Pour l’énoncer plus simplement, la question serait celle de savoir, comme l’a relevé Gil Caroz dans son introduction [11], s’il y a de l’analyste. Voilà ce que met à l’épreuve et vérifie tout contrôle classique, à partir de l’acte même de l’analyste praticien, comme l’a suggéré Lacan [12] ; et voilà ce que doit vérifier également le contrôle élargi, avec comme Autre en présence l’École, via ses membres. Et voilà enfin ce que chaque analyste praticien doit prendre à sa charge, averti du fait que l’être de l’analyste n’existe pas, et qu’en conséquence, il n’aura de cesse de devoir démontrer qu’il y a bien de l’analyste, ce qui le renvoie à sa propre analyse [13].
L’analyse
Du reste, s’il y a bien un dispositif où l’analyste s’expose, c’est bien dans le cadre de sa propre analyse qui s’invite, quoi qu’il en soit, lors de l’exposition de sa pratique. Ainsi J.-A Miller a pu soutenir par exemple que « dans l’appareil du contrôle le sujet vient en tant que praticien », pour vérifier « qu’il est analysé » [14]. Et ainsi il pouvait soutenir que : « Le contrôle ne vaut rien s’il ne vise pas au-delà, s’il ne vise pas les relations de l’analyste avec la psychanalyse. » Et c’est ce que l’exposition de cas mesure également : les relations de l’analyste avec la psychanalyse, avec la cause analytique rajouterions-nous.
Cette cause ici introduite est à interroger suivant deux aspects. Il y a la cause que nous opposons à l’idéal et qui renvoie au singulier, à la différence absolue, que vise toujours une analyse. Garder cette « orientation vers le réel », c’est se maintenir dans le discours analytique, toujours susceptible d’être contaminé par le discours du maître. La tentation est toujours grande de vouloir le bien de l’autre, ou tout simplement de vouloir contrôler l’expérience. Ne rien boucher, disait J.-A. Miller, c’est « laissez être celui qui se confie à vous », concluant ainsi : « laissez-le être dans sa singularité. » [15] Voilà donc ce que doivent vérifier nos deux versions du contrôle.
Deuxième aspect relatif à la cause, celui qui renvoie au désir, et précisément à la dimension du désir de l’analyste, telle qu’elle se mesure à travers la position que l’analyste peut tenir dans les cures qu’il mène, et plus concrètement à travers les actes qu’il pose, ces derniers visant justement ce que « chacun a de singulier, d’incomparable » [16].
Pour conclure
Concluons. Lors de son intervention présentant les 30e journées, que nous avons déjà évoquée, J.-A. Miller disait souhaiter que ces nouvelles journées fassent rupture concernant l’exposition de cas, avec des analystes qui s’exposent, donc, constatant alors qu’il « restera à élaborer comment aborder de la bonne manière « la confession des analystes », concluant par ce constat, je le cite : « leur passe toujours recommencée » [17].
La « confessions des analystes » reste donc toujours, sinon à penser, du moins à s’effectuer, dans le cadre d’une formation continue, et suivant de multiples facettes (et nous n’avons pas évoqué aujourd’hui l’enseignement). C’est à cette condition que le désir de l’analyste peut rester vivace et opératoire. Enfin, si nous pouvons constater que sur certains points, la passe et le contrôle se rejoignent [18], il nous faut aussi admettre, à suivre J.-A. Miller, qu’un lien logique existe également entre « passe » – ici au sens de phénomène, de moment – et « exposition de cas » , dans la mesure où prévaut le « s’exposer » ! Bref, il se démontre ici encore que la passe, cette fois-ci comme procédure, demeure l’expérience, le dispositif central de notre École.
[1] Texte issu de la journée « Question d’École : Permanence de la formation », organisée à Paris par l’ECF le 02 Février 2019.
[2] Miller J.-A., « Trois points sur le contrôle », Hebdo-Blog, n°159, 23 janvier 2019, publication en ligne de l’ECF, https://www.hebdo-blog.fr/trois-points-controle/ .
[3] Lacan J., « Acte de fondation », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 235.
[4] Miller J.-A., « Présentation en l’an 2000 du thème des Journées de l’École de la Cause freudienne qui se tiendront en 2001 » [le 22 octobre 2000], Liminaire des XXXèmes Journées de l’ECF, Collection Rue Huysmans, 2001. (repris dans La lettre mensuelle, n°193).
[5]Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris viii, cours du 12 novembre 2008, inédit.
Il précisait à cette occasion : « Et j’aimerais qu’on puisse dire sur le contrôle – mot dont on fait parfois un usage abusif –, j’aimerais qu’on puisse dire sur le contrôle des choses mieux structurées si je puis dire. »
[6] Contrôlant, qui, dans le cadre de sa pratique d’analyste, se prête plutôt à incarner l’objet a, « la cause du désir de l’analysant ».
Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 41.
[7] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse », op. cit., cours du 26 novembre 2008.
[8] Elles avaient pour titre : « Tu peux savoir comment on analyse à l’École de la Cause freudienne ».
[9] Miller J.-A., « Présentation des 30èmes Journées de l’ECF », op. cit.
[10] Ibid.
[11] Caroz, G., « Permanence de la formation, de la nécessité du contrôle, finitude et infinitude de l’analyse », Hebdo-Blog, n°159, 23 janvier 2019, publication en ligne de l’ECF.
[12] Lacan J., « discours à l’efp », Autres écrits, op.cit., p. 266 & p. 270.
[13] Etant entendu bien sûr que l’objectif de la psychanalyse pure est de produire un analyste.
[14] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le banquet des analystes », enseignement prononcé dans le cadre du
département de psychanalyse de l’université Paris viii, cours du 23 mai 1990, inédit.
[15] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse », op. cit., cours du 17 décembre 2018.
[16] Ibid.
[17] Miller J.-A., « Présentation en l’an 2000 du thème des Journées de l’École de la Cause freudienne qui se tiendront en 2001 », op.,cit.
[18] Jacques-Alain Miller nous dit : « Or, c’est un fait que l’appareil de la passe, de façon similaire et congruente au contrôle, comporte une interposition, et qu’il y a donc là, dans ce schématisme de la passe, la volonté de rendre très présente cette dimension d’indirect, et par là-même de matérialiser la transmission. On la matérialise en incarnant le messager, le médium. De la même façon que le psychanalyste contrôleur ne voit pas le patient, le jury de la passe ne voit pas le candidat. On pourrait voir ici la passe comme modelée sur la pratique du contrôle. » Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le banquet des analystes », op. cit.