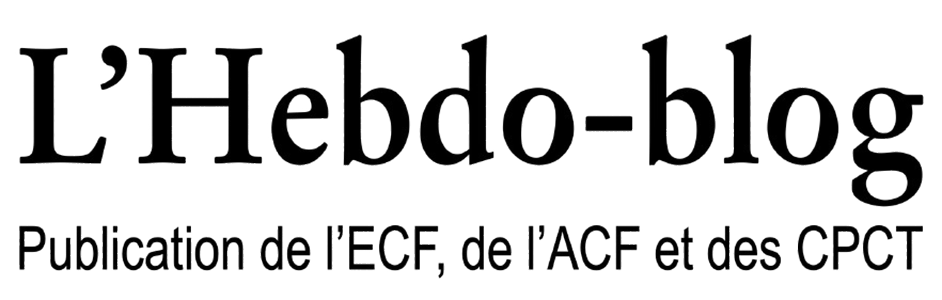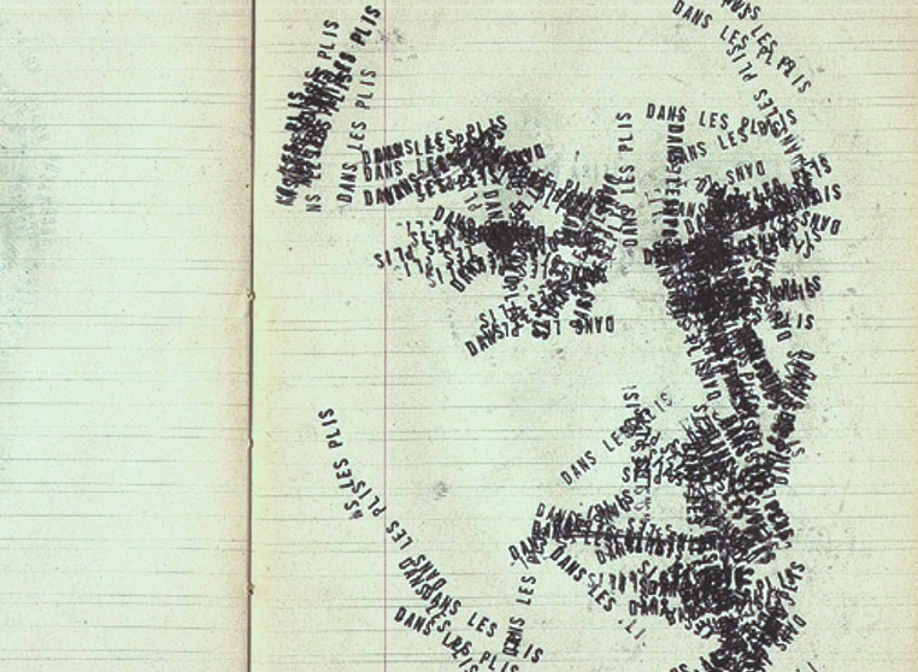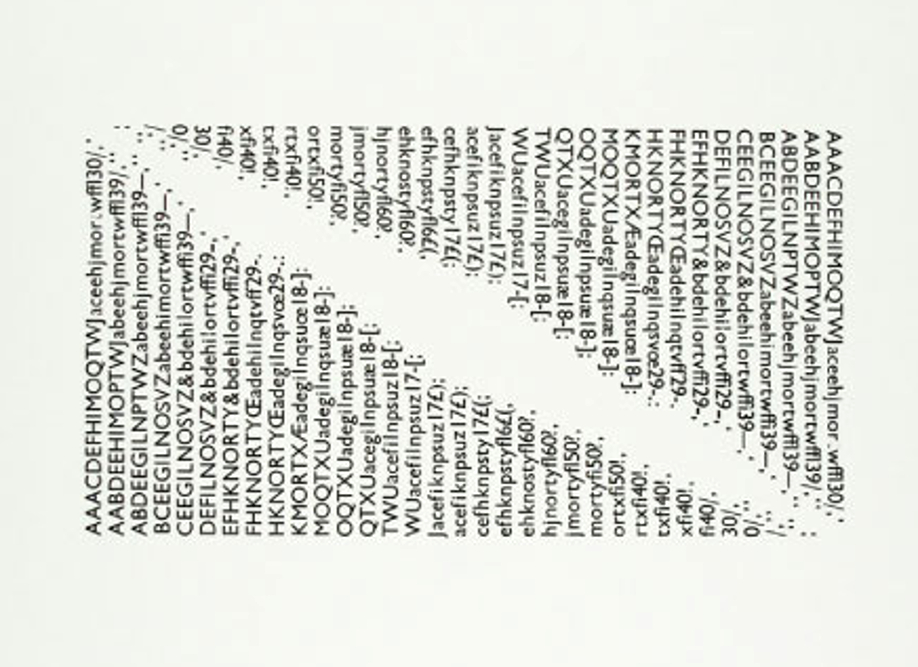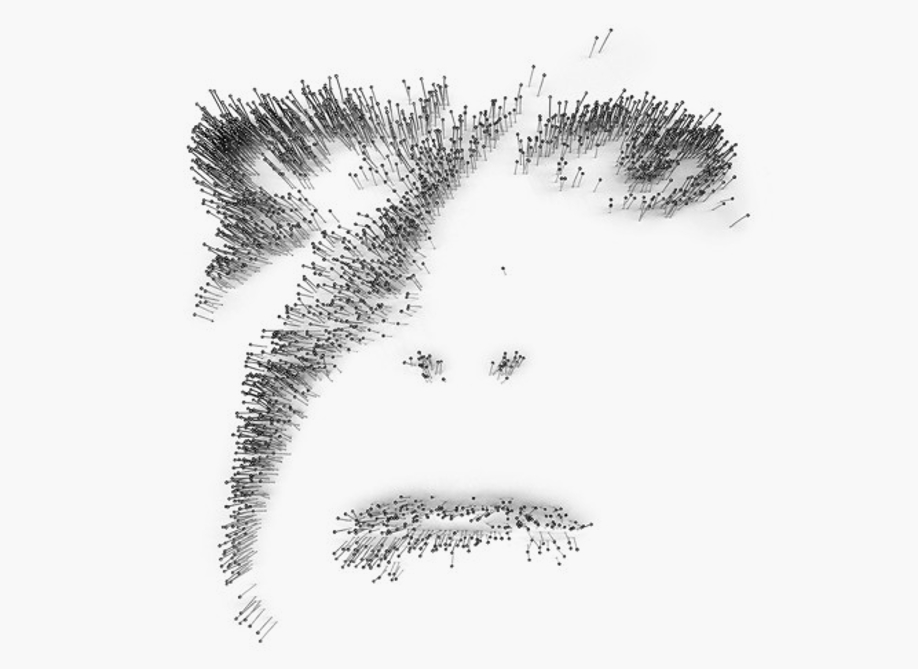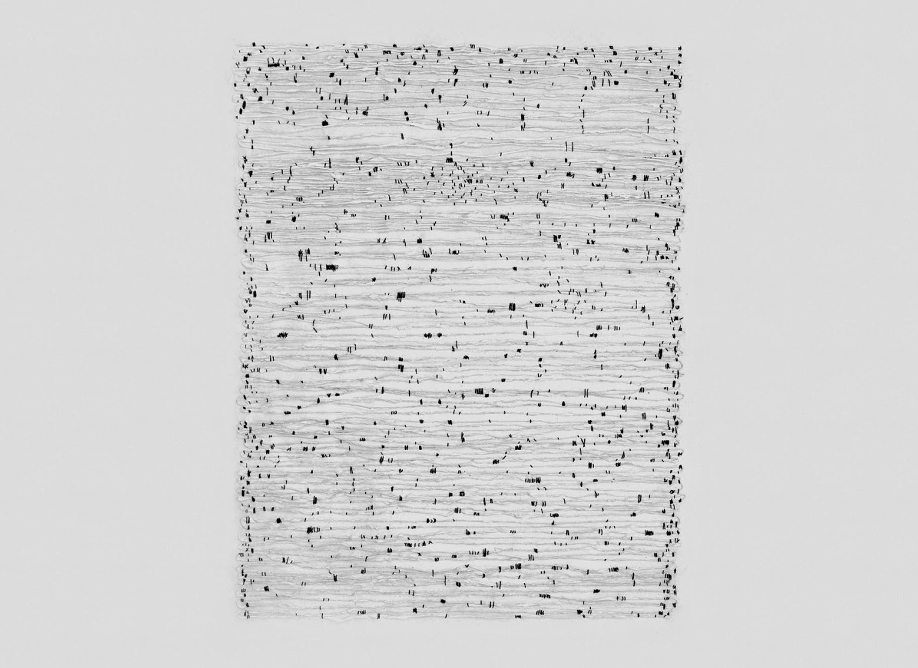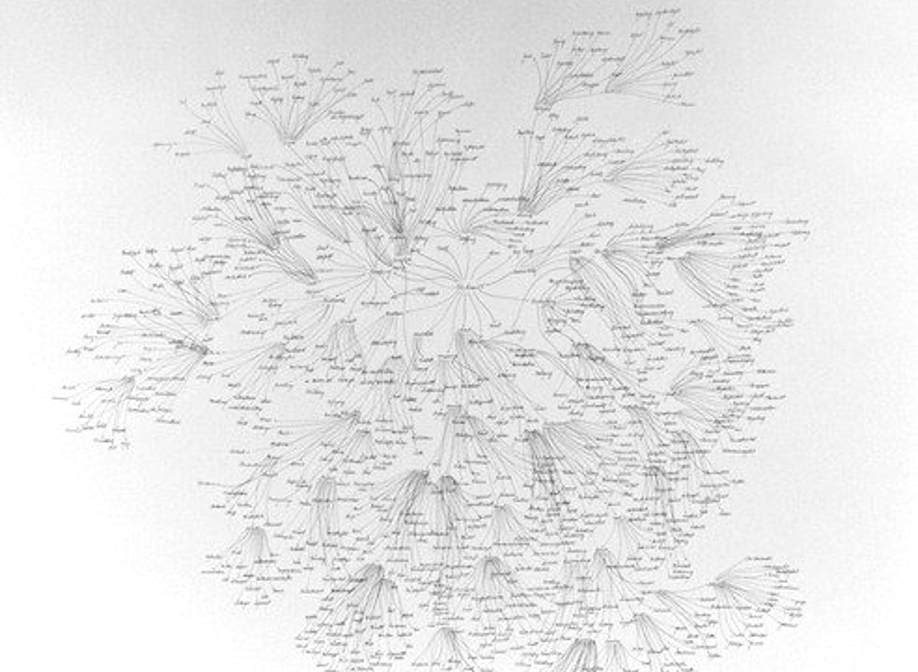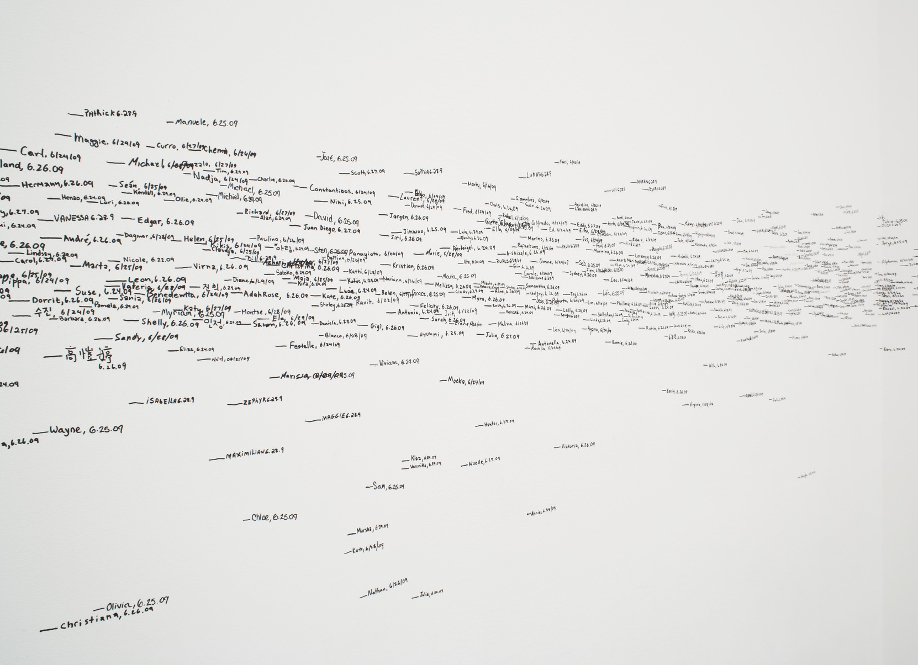« Lituraterre » signe le démariage de Lacan avec la conception communément admise de l’écriture comme dépôt de petites lettres sur une page. Il y proclame que l’écriture se loge au cœur même de la parole. Dans le même temps que l’on parle, se mobilise l’instance de la lettre, l’effet de l’écrit. Quelque chose s’écrit dans la parole, se précipite, se jouit.
C’est ce lien entre jouissance et écriture qu’Éric Laurent, invité à Bruxelles le 15 octobre dernier par l’ACF-Belgique à répondre à huit questions [1] autour de son livre incontournable, L’envers de la biopolitique, est venu tisser de manière magistrale.
Pas un mot en effet que quelqu’un emploie qui ne soit gauchi par le fait qu’il le prononce[2]. Le sens tourne autour d’une rupture, d’une brisure fondamentale, ça s’y sense.
Ce sens s’ancre en un point dans une logique temporelle. Cela s’éprouve tout spécialement dans la séance analytique où se croisent présent, passé et futur, noués par un point de capiton. De cette actualisation surgit une illusion particulière, celle d’un c’était écrit. Le sujet croit rattraper, réécrire les chapitres perdus de son histoire. Mais Lacan fera valoir que livre du sujet n’est pas déjà là, qu’il s’écrit au moment même où il parle, comme dans le rêve.
Subvertissant le mode freudien du dépôt des traces dans l’inconscient mémoire, il s’avancera résolument vers un inconscient qui n’est plus constitué que de trous serrés par des nœuds, substituant à l’illusion du c’était écrit, une nouvelle écriture qui prend appui sur cette structure de réversion temporelle.
Du fait que l’on ignore ce qui est écrit, que l’on s’avance sans la garantie du système de traces, ne subsistent que les équivoques dans la langue, nécessitant toujours une nouvelle lecture. L’écriture devient l’opération même qui permet de traverser le sens et de faire qu’après n’est plus comme avant.
De ce mouvement, l’interprétation ne sort à coup sûr pas indemne.
Que l’analyste fasse reson dans le corps suppose un usage de la résonance qui va au-delà de celui de « Fonction et champ de la parole et du langage ». Ce n’est plus un S2 équivoque qui permet de lire le S1 à nouveaux frais, mais plutôt la mise au jour d’une passion du parlêtre, soit S barré complété de l’objet petit a, sur le mode de l’équivoque. Il s’agit de surjouer, de remettre une couche sur le souvenir pour faire mouche à partir de l’objet petit a comme surprise, et manier ainsi une écriture qui est « désimpression », une écriture qui fait surgir la rupture toujours possible.
L’analyste n’a pas à faire de son corps n’importe quoi, il doit « pouvoir incarner à un moment donné, un effet de présence de l’Autre du langage qui ne soit pas convenu, qui ne soit pas réductible à ce qui est attendu ».
Pour arriver à faire des choses « qui ne se font pas » et qui néanmoins opèrent « dans une lueur étrange », l’analyste, objet petit a, a à sacrifier beaucoup.
[1] Huit questions très argumentées étaient posées par Guy Poblome, Katty Langelez, Monique Kusnierek, Anne Lysy, Bernard Seynhaeve, Dominique Holvoet et Yves Vanderveken.
[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne – Choses de finesse, en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII, leçon du 26 novembre 2008, inédit, disponible sur le site de l’Ecole de la Cause freudienne : www.causefreudienne.net.