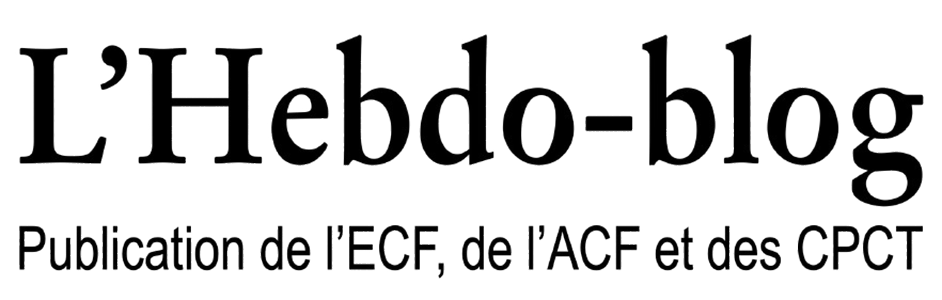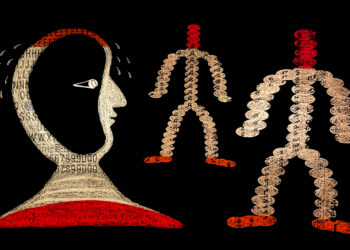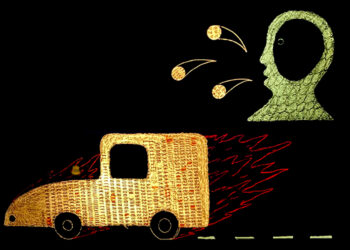Comment la clinique et ses surprises peuvent-elles orienter les praticiens sur les déplacements opérants pour un sujet ?
Jouissance informe
Lorsqu’il vient consulter, Mathis est déjà nommé par l’Autre : son hyperactivité met à mal sa scolarité et ses parents sont à bout. Dès la première séance, il parle de « peurs terrifiantes ». Les manœuvres cliniques ont peu d’effets : l’enfant n’arrive pas à s’inscrire dans les séances pour traiter ce dont il est le jouet. L’escalade de ses symptômes conduit la praticienne à se rendre à une réunion à l’école, alors même que le sujet n’aime pas que l’on parle de lui. Contre toute attente, un apaisement se produit à la suite. Mathis éclaire cette soudaine amélioration de sa position : « Je t’ai vue ! » Il a vu sa psychologue traverser la cour de son école, mais cette dernière ne l’a pas vu. En faisant tache dans le tableau habituel, la présence de la praticienne incarne et localise le regard. Un déplacement s’opère.
Tableau lacanien
« Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas !1 » Cette phrase adressée ironiquement au jeune Lacan, embarqué dans la coquille de noix d’un pêcheur qui lui montre une boîte de sardines flotter dans le soleil, il ne la trouve pas drôle. « C’est fort instructif […] si ça a un sens que Petit-Jean me dise que la boîte ne me voit pas, c’est parce que, en un certain sens, tout de même, elle me regarde2 ». À travers cet épisode, Lacan fait sentir que « nous sommes des êtres regardés, dans le spectacle du monde3 ».
L’espace d’un operçoit4
Revenons à l’opération contingente de Mathis. Ici, pas de malaise, comme dans l’apologue lacanien, car le corps de la praticienne vient faire écran entre le sujet et le regard. C’est finalement l’envers de l’expérience où la boîte de sardines présentifie pour Lacan l’objet regard. En étant « vue », la psychologue, se faisant focale du regard, permet au sujet un détour, le délestant d’en être l’objet. L’objet se déplace, certes, mais de manière fugitive, loin de la réversibilité propre au fantasme. Plutôt s’agit-il d’une inclusion fugace de l’objet regard dans un tableau, objet logé, donc séparé, l’espace d’un instant.
Ce déplacement est instructif à deux titres : il est une voie d’invention pour le sujet qui a à construire une enforme pour capturer sa jouissance ; et c’est un temps d’interprétation du transfert pour la clinicienne. En effet, la tâche qu’il lui revient de produire est celle d’ouvrir un lieu propice à l’énonciation du sujet : il se crée quelquefois par accident et se lit dans un après-coup. Ainsi, un praticien peut indexer une phrase banale à un moment où s’aperçoit la jouissance en jeu et où s’opère un déplacement de la position du sujet.
Dès lors, pouvons-nous lire le déplacement de libido comme une opération qui consiste pour un sujet à construire un lieu où celle-ci puisse se loger et ainsi introduire une distance minimale avec l’objet ?
Noëmie Jan
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 89.
[2] Ibid.
[3] Ibid., p. 71.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 187.