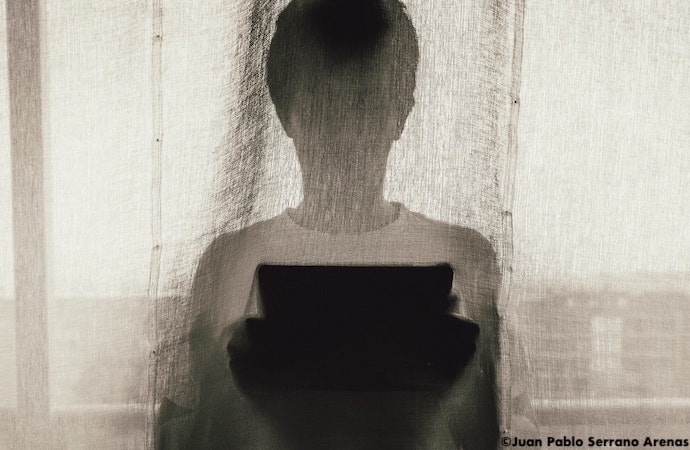Un homme en invective d’autres pour les sommer de boire du vinaigre. Un autre constate qu’à la façon de ramer d’un homme, on repère ses envies meurtrières. Un homme marche pour se rendre à l’infirmerie et, à mesure qu’il avance, oublie la raison pour laquelle il est sorti de chez lui…
Dans l’univers du poète russe Daniil Harms, il y a des hommes roux, sans yeux ni oreilles, sans jambes, ni nez ni même cheveux « car c’est par convention qu’on le disait roux » [1], il y a de l’alcool qui coule à flots, un homme qui s’époumone contre une chose qui ne le laisse pas en paix, et qui « est la gloire de Jean-Jacques Rousseau » [2], des hommes qui en frappent d’autres sans raison, des hommes et des femmes emmenés à l’asile, parce que leurs rêves semblent des folies, deux hommes qui bégaient et dialoguent ensemble : l’un achoppant sur les voyelles, l’autre sur les consonnes, il y a aussi un croyant qui se réveille athée et déduisant, parce qu’il se pèse chaque soir et chaque matin, que sa foi volatilisée pesait huit livres [3].
D. Harms, né en 1905, mort en 1942, poète de l’absurde, jongla entre différentes formes littéraires : pièces de théâtre, nouvelles, lettres, récits… Ses écrits, constitués pour une grande part de fragments, recèlent des histoires qui n’en sont pas, sans début ni fin. Les personnages sortent du chapeau du texte, et disparaissent sans que l’on en sache la raison. On songe à Alice au pays des merveilles [4], mais une Alice diffractée en dizaines de personnages, tous à l’ombre des purges staliniennes, avec un peu plus de vodka et beaucoup plus de violence.
D. Harms voulait-il dire toute la vérité ? Voulait-il dénoncer le régime stalinien, lui qui fut accusé d’être un fervent opposant du Parti, lui qui fut emprisonné jusqu’à sa mort ? « La dire toute, c’est impossible matériellement : les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel » [5].
Les fantaisies qui se succèdent dans ces fragments, ne rendent-elles pas plus éclatant un réel, celui de l’indicible d’une époque et d’une politique ?
Si l’on rêve à ce qui faisait écrire D. Harms, que dirait-on ? Il se contrefichait de la vérité, il s’en contrefichait tellement que ses textes, écrits et poèmes, désassortis, bigarrés, passaient d’une forme à l’autre, d’un genre littéraire à l’autre, qu’un rêve était raconté, et qu’un poème venait le clore. Ou alors…Dirait-on l’inverse ? D. Harms éprouvait en quoi la vérité touchait au réel, il avait l’idée que quelque chose du réel ne pouvait passer qu’entre les mailles d’une écriture à surprises, et c’est pour cela qu’il a usé de ce que l’on nommerait, nous, le hors-sens. D. Harms ne dénonçait pas, tout du moins pas directement. Il n’y avait pas de démonstration, ni de déclaration de dénonciation. Il faisait exploser les discours, s’immisçant dans les formes littéraires, les rendant caduques, elles, tout autant que le message qu’elles étaient censées délivrer.
Puisque la vérité est un puits sans fond, alors autant ne pas trop s’y pencher. Écrire en faisant croire à l’air de rien : les miliciens qui sortent du placard n’en sont que plus nimbés d’étrangeté.
[1] Harms D., Écrits, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, p. 111.
[2] Ibid., p. 298.
[3] Ibid., p. 326.
[4] Carroll L., Alice au pays des merveilles, 1869, disponible sur internet.
[5] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 509.