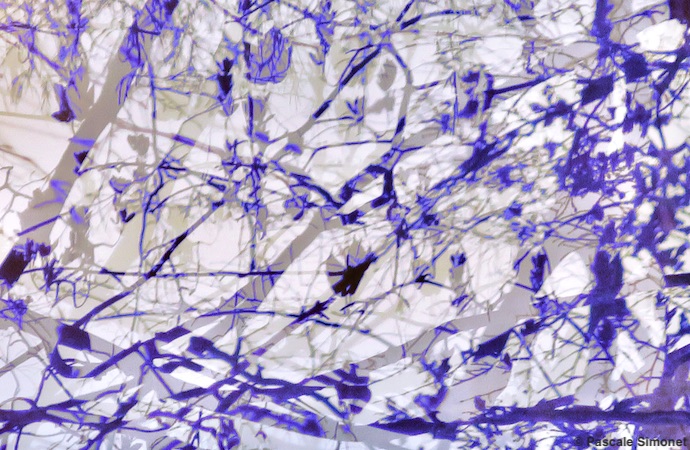Alors qu’il s’apprête à achever la dernière leçon du Séminaire, livre XIV, La Logique du fantasme, on peut lire, dans l’édition parue cette année grâce au texte établi par Jacques-Alain Miller, comment Jacques Lacan construit un apologue de son cru, « l’art du vendeur » [1], pour introduire et marquer la place du désir dans son rapport à l’Autre. Il s’agit pour J. Lacan de situer le concept de désir afin de cerner comment créer de la demande et causer le désir dans et pour la cure, car c’est un enjeu éthique : celui de l’acte analytique, abordé l’année suivante.
Non sans ironie, J. Lacan décrit la condition du vendeur ainsi : « Il faut faire désirer à quelqu’un un objet dont il n’a aucun besoin, pour le pousser à le demander. » [2] Il repositionne donc le désir, le besoin et la demande, mais d’une façon inversée à celle commune de la cure, car il ne s’agit pas d’un sujet qui demande. En effet, dans cette situation, le sujet est conduit, « poussé à demander ». Pour cela, le vendeur, imaginé par Lacan, va user de la ruse. Il va mettre le sujet en confrontation à son semblable. Si l’autre possède ce que le sujet n’a pas, il en ressentira plus ou moins crûment le manque, et de plus, dit-il dans les termes de son usage psychanalytique, il « aura barre sur lui » [3]. Il fait donc vibrer la privation imaginaire propre à la mise en concurrence de la petite différence de celui qui a, face à celui qui, alors, manque de quelque chose. Enfin, une deuxième ruse de bon vendeur, consiste, poursuit J. Lacan à titiller le narcissisme de l’acheteur potentiel en lui faisant miroiter « le signe extérieur » à donner à sa vie. Complément de l’image de soi, le décor ou décorum de vie s’enrichit d’objets à acquérir, parce que manquant au tableau. La simple présentation, évocation de l’objet décomplète l’image qui devient marquée d’un manque. C’est par cette voie que le désir de l’Autre s’incarne, via l’objet présenté, ici par la représentation même du bon vendeur et de son offre. C’est le circuit du commerce et de l’achat.
J. Lacan va alors faire entendre un witz aussi subtil qu’exquis, par la grâce de l’équivoque de l’acheter. En le faisant résonner trois fois, détachant ainsi l’écriture de l’acheter et de lâcheté, il fait entendre l’accointance de l’achat de consommation et de la lâcheté. Toute satisfaction du désir sur le versant de l’objet du besoin, de l’objet dit de consommation, des lathouses, écrira -t-il plus tardivement, à savoir ces objets issus de la science et du capitalisme, conduit à faire du sujet un consommateur qui se consume et s’efface dans l’achat. Ces acquis sont autant de renonciations à la confrontation avec son désir, et autant de tromperie, de « malversations », dit J. Lacan.
Ainsi, ce tour de passe-passe avec l’objet qu’offre la consommation à tout crin ne fait que ramener le sujet à sa culpabilité, sa lâcheté, celle d’avoir cédé sur son désir. J. Lacan l’indique dans une phrase qu’il met à la deuxième personne du singulier, interpelant, apostrophant même directement l’auditeur/lecteur. Je le cite à propos de cette malversation qui « aura pour résultat principal, tu le sais très bien, de te pousser toujours plus dans le sens de te racheter – de te racheter de ta lâcheté » [4].
J. Lacan une nouvelle fois, lie renoncement au désir et culpabilité. Il ne s’agit donc pas de céder au désir du vendeur qui offre toujours plus de gadgets et d’objets qui virent aux déchets, mais pas davantage de céder sur son désir qui tient à un autre objet cause de désir. L’apologue du vendeur met en évidence que quelque chose du désir de l’Autre, sous la figure du vendeur, y est attaché. En tient preuve cette « incidence du désir de l’Autre » [5] qui pousse le sujet à se conformer à l’offre.
Pour autant, le sujet de l’inconscient s’y perd, d’y perdre un désir singulier. La culpabilité, le sentiment de lâcheté témoignent de cet égarement. Faire comme les autres ou comme l’image pour l’autre, fait obstacle à son désir, soit à ce qu’il a été comme objet a dans le désir de l’Autre. L’analyste ne s’adresse pas au consommateur, mais au sujet de l’inconscient, via l’offre du dispositif analytique, l’analyste crée la demande. Dans ce dispositif, il occupe la place de semblant de l’objet a, cause de désir pour l’analysant. C’est en quoi l’on peut dire que l’analyste crée de l’objet a avec de l’objet a. Mais il serait faux de réduire l’analyse à une solution par l’objet, car le discours analytique met en évidence qu’il y a un non-rapport entre le sens et le réel qu’aucun objet ne comblera.
Catherine Lacaze-Paule
_______________________________
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La Logique du fantasme, Paris, Seuil, 2023, p. 416.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid., p. 417.