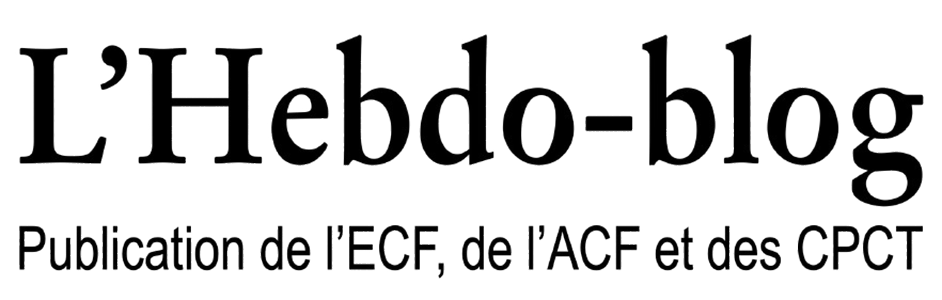Nous sommes à l’heure où la neuro-imagerie vient à la rescousse d’une psychiatrie en perdition. Un récent reportage sur France Culture [1] décrit ses dernières avancées dans le domaine du diagnostic différentiel des phénomènes hallucinatoires, tout comme dans celui du soulagement des patients réfractaires aux traitements psychiatriques conventionnels. Selon ce reportage, l’imagerie cérébrale permet d’objectiver une pathologie qu’on croyait jusque-là totalement irrationnelle et lutterait ainsi contre la stigmatisation du patient. Cette nouvelle sémiologie permettrait au patient de comprendre autre chose de sa maladie en visualisant la zone qui déclenche l’hallucination. Elle deviendrait moins effrayante pour lui et son entourage avec cet effet d’apaisement que procurerait ce diagnostic neuro. C’est la réponse contemporaine au malaise des sujets dont on ne parvient plus à accueillir l’angoisse lorsqu’il n’y a pas le voile des signifiants qui donne forme unitaire au corps. Ces patients sont désormais imagés comme de réelles pièces détachées et de fait – visiblement – ils sont détachés de leurs positions subjectives.
L’imagerie cérébrale propose des formes nouvelles de la réalité du corps. Placez alors la personne dans la machine IRM à résonance magnétique avec un miroir au-dessus des yeux ; elle pourra alors voir en direct différé de quelques secondes ce qui se passe dans son cerveau. Selon les termes de cette ingénierie, ce montage visuel donne la possibilité au patient d’apprendre à mieux regarder ses hallucinations et donc à mieux les gérer, voire à réduire les hallucinations auditives à des chuchotements, notent ces spécialistes. Or, Lacan nous indique précisément « le peu d’accès qu’a le sujet à la réalité de ce corps » [2]. En effet, dans « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », Lacan fait valoir tout autre chose de la réalité du corps que l’on pense avoir, aussi bien dans sa bonne forme spéculaire, que lorsque le corps ne tient pas. Il ajoute dans ce texte que, bien qu’on puisse en rêver, ce ne sont pas les « techniques du corps » [3] – ajoutons aujourd’hui ni celles de la neuro-imagerie – qui offriront une quelconque clarté à la « configuration de cette obscure intimité » [4] qu’est le corps.
L’angoisse a-t-elle alors encore droit de cité pour aborder ce qui affecte le parlêtre pour lequel « rien ne subsiste […] qui n’ait son coefficient de jouissance » [5] ?
Comme le montre l’actualité avec ces neuro-technologies, on a bien l’idée que le corps porte les traces de quelque chose. Cependant, ces traces ne sont plus guère qualifiées d’angoisse, à savoir celles « de nous réduire à notre corps » [6], comme le délivre Lacan en 1974 dans La Troisième. Le discours commun verse au contraire du côté de la stigmatisation, signal non pas d’angoisse, d’une singularité, mais signe d’un Autre qui exclut. Cette élection du cerveau comme matière première du corps laisse cependant entrevoir ce qu’elle emporte du malaise actuel de la civilisation en renouvelant, à nouveaux frais, la quête d’une élucidation du mystère du corps parlant. En effet, avec la neuro-imagerie, il ne s’agit pas, comme nous l’entendons dans la clinique orientée par la psychanalyse, du corps qui « paye son tribut d’angoisse » [7] pour reprendre cette expression de Daniel Roy dans l’introduction du prochain congrès de la NLS.
Ce congrès intitulé Malaise et angoisse dans la clinique et la civilisation, qui se tiendra à Paris les 21 et 22 mai prochains, sera l’occasion de mettre au travail la complexité de ce sujet.
Martine Versel
________________________
[1] Les Matins de France Culture du 19 avril 2023. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/au-chu-de-lille-l-imagerie-cerebrale-au-service-des-maladies-psychiatriques-2171090
[2] Lacan J., « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 676.
[3] Ibid., p. 676.
[4] Ibid., p. 676.
[5] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 3 juin 2009, inédit.
[6] Lacan J., « La Troisième » in Lacan J., La Troisième & Miller J.-A., Théorie de lalangue, Paris, Navarin éditeur, 2021, p. 40.
[7] Roy D., « Malaise et angoisse dans la clinique et dans la civilisation ». Une introduction au congrès NLS 2023. Disponible sur internet : https://www.amp-nls.org/fr/nls-messager/congres-nls-2023-malaise-et-angoisse-dans-la-clinique-et-dans-le-civilisation/