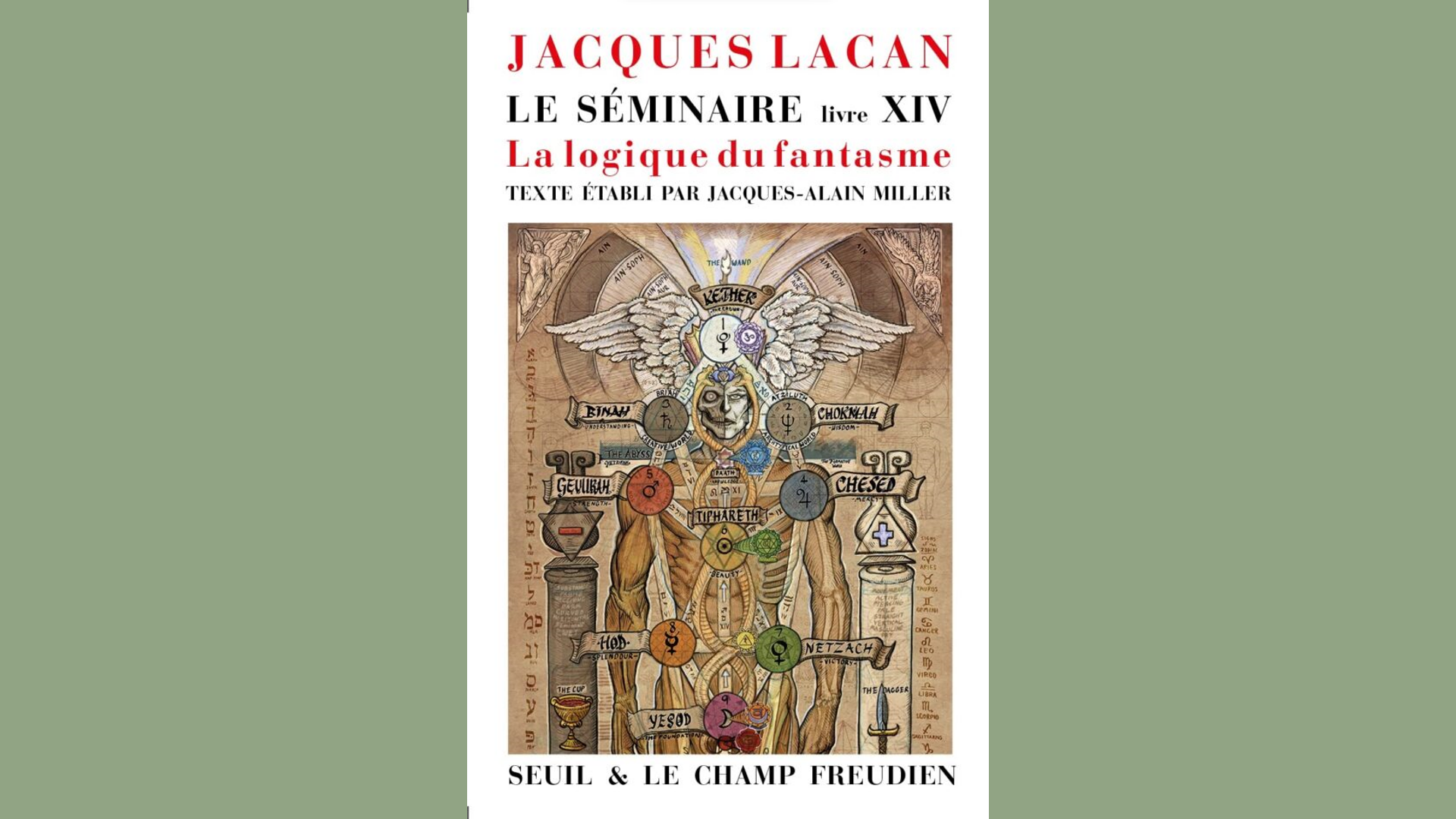La publication du Séminaire, livre XIV arrive à point nommé dans ce moment où notre École remet en fonction le dispositif de la passe après un temps nécessaire de pause et de réflexion : l’invention de la passe n’est-elle pas une conséquence de La Logique du fantasme ? [1] Conséquence du sillon que Lacan a tracé au cours de ce quatorzième séminaire et, aussi bien, conséquence de la logique même du fantasme. Notons que ce terme de « logique », cher à Lacan, prendra, dans la suite de son enseignement, une place prépondérante.
Nous avons la chance de pouvoir lire Lacan avec Lacan et, par-là, de mesurer comment son enseignement avance par circonvolutions successives. Nous le voyons revenir sur des notions forgées précédemment pour les transformer et nous surprendre en ouvrant de nouvelles perspectives avec le souci constant d’en démontrer la logique. Lacan déduit, chamboule, n’hésite pas à opérer les renversements logiques qui s’imposent à lui. Ce mouvement, nous pouvons le suivre ici et repérer les arêtes qui aboutiront à la « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École » [2] comme au séminaire qu’il va consacrer à l’acte analytique. « L’acte analytique » c’est une formulation issue de la logique du fantasme. Il n’y a pas d’acte sexuel, glisse-t-il – prémisse à « Il n’y a pas de rapport sexuel » de son dernier enseignement − mais il y a l’acte analytique ; l’acte analytique qui amène Lacan à interroger ce qu’il en est de l’acte, à savoir un franchissement dont le sujet sort changé.
En définissant bientôt l’acte analytique comme l’expérience analytique lorsqu’elle parvient à sa conclusion, Lacan accomplira lui-même un franchissement : « L’acte psychanalytique, ni vu ni connu hors de nous, c’est-à-dire jamais repéré, mis en question bien moins encore, voilà que nous le supposons du moment électif où le psychanalysant passe au psychanalyste » [3] écrira-t-il dans son compte-rendu du Séminaire, livre XV. Un pas de plus pour celui qui n’aura cessé d’être préoccupé par la fin de l’analyse et le passage du psychanalysant au psychanalyste.
Au bout de l’expérience, l’analysant sait ce qu’il est advenu de l’analyste désormais destitué. Dès lors « Le psychanalyste se fait de l’objet a. Se fait, à entendre : se fait produire ; de l’objet a : avec de l’objet a. » [4]
C’est bien le statut de cet objet a qui est traqué dans ce Séminaire XIV, et spécialement dans son rapport logique avec le sujet divisé par le signifiant comme l’indique la formule du fantasme $◊a. L’objet a, invention de Lacan qui n’a cessé d’évoluer au fil de son enseignement, résulte d’une opération de structure logique comme il l’annonce dès le début de ce séminaire. La fameuse phrase « Un enfant est battu », commentée par Freud et reprise ici maintes fois, permet à Lacan d’en faire valoir la structure logique, c’est-à-dire grammaticale et relevant de la fonction du signifiant.
À la lecture de La Logique du fantasme nous pouvons ainsi suivre les traces de ce qui cheminera jusqu’à l’invention de la passe dont Lacan espère qu’elle éclairera l’x du désir de l’analyste.
Une multitude d’autres éléments seront bien sûr à cueillir au cours de notre lecture pour continuer à interroger notre position d’analyste mais aussi d’analysant. « L’inconscient c’est la politique » découvrirons-nous certainement au décours d’une page… Parions que notre lecture sera facilitée par celle que Jacques-Alain Miller a faite avant nous et qui a permis à cet ouvrage d’advenir.
Sonia Chiriaco
________________________________
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La Logique du fantasme, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien, 2023.
[2] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 243-259.
[3] Lacan J., « L’acte psychanalytique », Autres écrits, op. cit., p. 375.
[4] Ibid., p. 379.