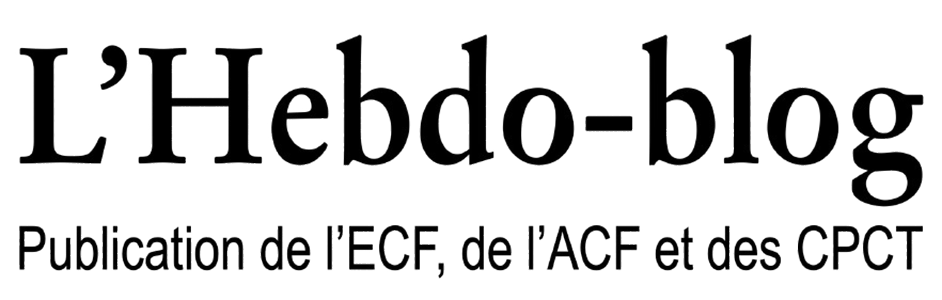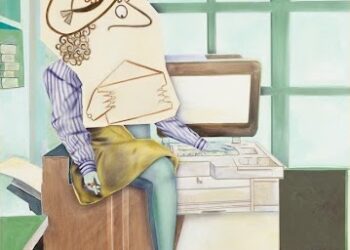Qu’est-ce qui pousse à étudier, à enseigner à partir d’Einfalle, à partir de son inconscient ? Pas un désir de savoir puisque Lacan affirme dans Encore qu’il n’y en a pas1. Se pourrait-il que le surmoi ait à jouer sa partie dans cette affaire ? La déconcertante assertion de Lacan en 1975, à la suite de l’exposé d’André Albert2 sur la règle fondamentale, faisant du surmoi un allié de l’analyste nous invite à envisager cette piste.
L’effort de l’association libre
Dans l’application de la règle freudienne, le sujet s’astreint à dire tout ce qui lui vient à l’esprit. Il se soumet à dire, quitte à rompre le charme de l’entendement et à formuler des choses déplaisantes. « Dites ! » Tel est l’effort demandé au sujet. Dans son intervention à la suite d’A. Albert, Lacan enfonce le clou, en soulignant particulièrement cet effort. L’analysant va devoir en « baver un minimum », « en suer » nous dit-il. Dans cette dimension de forçage A. Albert discerne un trait surmoïque qu’il dit être contingent3. Lacan indique que : « C’est très difficile de ne pas s’apercevoir que […] l’analyste trouve un allié dans le surmoi4 ».
Jouir de dire
L’association libre trouve comme allié le surmoi. Ne faut-il pas considérer que le surmoi commande bien toujours et encore « Jouis! », mais alors là, d’une jouissance qui en passe par la parole ? Avec cette dimension d’effort qui est « ce qui déplaît » à tout le monde rappelle Lacan, il se produit une fracture du principe du plaisir. Lequel consiste à « ne rien foutre5 », « Moins on jouit, mieux ça vaut6 ». S’efforcer à associer librement dérange l’homéostase du principe du plaisir commandée par le fantasme. C’est donc un surmoi, subverti quant à la jouissance qu’il commande, qui sert l’analyse.
Rabattre la passion de l’ignorance
Ce surmoi subverti pousse à dire et à jouir de la parole sur un certain mode. Grâce à l’interprétation qui s’y mêle, le produit de cet effort est bel et bien le sujet de l’inconscient. « C’est avec ces bêtises que nous allons faire l’analyse, et que nous entrons dans le nouveau sujet qui est celui de l’inconscient.7 » Le sujet de l’inconscient est irréductible, il est toujours à produire. L’analyse, via l’association libre y œuvre en rabattant cette tenace passion de l’ignorance. Aussi se tenir au plus près de son inconscient consiste à ne jamais céder sur cet effort de bien dire qui permet de travailler avec, de le déchiffrer et le révéler. Cela relève d’une ascèse, car ce qui est premier c’est ce je-n’en-veux-rien-savoir du sujet.
Katell Le Scouarnec
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.‑A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 96.
[2] Albert A., « Le plaisir et la règle fondamentale », Lettres de l’École freudienne, no 24, juillet 1978, p. 14.
[3] Ibid.
[4] Lacan J., « Intervention à la suite de l’exposé d’André Albert », Lettres de l’École freudienne, no 24, op. cit., p. 22‑23.
[5] Ibid., p. 22.
[6] Lacan J., « Journées d’étude des cartels de l’École freudienne. Séance de clôture », Lettres de l’École freudienne, avril 1975, no 18, p. 269.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 25.