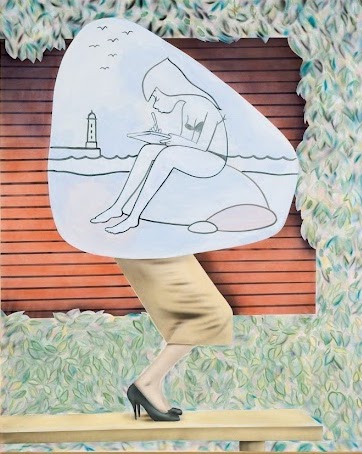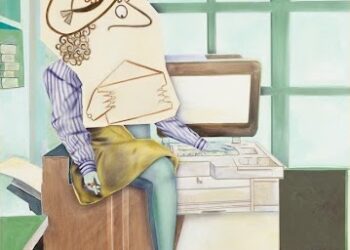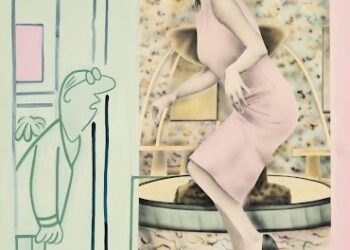Les lois, régies par l’instance du surmoi, se retrouvent dans l’enseignement de Lacan soumises au joug de l’impératif de la jouissance. « Jouis !1 », c’est ce que dit le surmoi, nous explique-t-il, dans son Séminaire Encore. Thérèse Martin, sainte carmélite, née à Alençon, en 1873, est la dernière fille d’un couple exalté dans sa piété. Le carmel sera le destin de tous les enfants de la famille, mais la sainteté sera réservée aux parents et à Thérèse. Sa vie, décrite dans son autobiographie Histoire d’une âme, est marquée par le commandement de l’amour : absolu, divin, total.
Un destin
Désignée très tôt comme une « prédestinée », Thérèse prend la loi à la lettre. « Dès l’âge de trois ans, j’ai commencé à ne rien refuser de ce que le Bon Dieu me demandait2 », écrit-elle. L’idéal de sainteté, présent dans sa famille dès avant sa naissance, s’impose comme un destin et elle s’y jette à corps perdu. La fonction « nommer à », dont Lacan nous explique que « la mère suffit […] à en désigner le projet, à en faire la trace, à en indiquer le chemin3 » est ici illustrée par le signifiant « sainte ». Enfant pieuse, Thérèse ira jusqu’à souhaiter la mort de sa mère pour que celle-ci « aille au ciel », auprès de Dieu. À six ans, elle a une vision de son père, lui révélant un message dont le sens est à venir. Au départ de sa sœur au carmel, Thérèse vit un effondrement corporel, suivi d’un épisode où une statue de la Vierge lui sourit et la guérit 4.
L’amour divin
L’entrée au carmel à quinze ans ordonne Thérèse et favorise une forme de lien social, là où l’école l’avait conduite vers l’isolement. Mais cette inscription, appuyée sur le vœu d’obéissance, l’amène à se faire pure fonction. « Lorsque je suis charitable, c’est Jésus seul qui agit en moi5 », écrit-elle. L’amour exige, commande et Thérèse le prendra à la lettre, jusqu’à faire de sa vie une « Offrande [d’elle]-même comme victime d’holocauste à l’Amour miséricordieux du Bon Dieu6 », laissant saisir le rapport de l’amour avec l’Un7.
Sa « certitude qu’après la mort, on peut encore travailler sur la terre au salut des âmes8 » témoigne de ce que Lacan pointe comme étant le propre des mystiques : « ils éprouvent l’idée qu’il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà9 ».
Le surmoi lacanien est une instance qui radicalise la loi. Or, face « au caractère infini de l’amour divin, l’amour humain ne peut répondre puisqu’il est forcément limité10 ». Thérèse semble s’arrimer à un surmoi réel, implacable. Jeûnes, autoflagellations, extases, graphomanie visent à fixer un corps qui peine à tenir. La loi insensée du surmoi11 se présente à Thérèse pleine d’un sens réel. Sauver les âmes au nom de Dieu est le nom de la contrainte indiquée par la voix divine, qui semble lui fournir une certaine consistance, via sa certitude de l’existence éternelle.
Isadora Escossia
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 10.
[2] De Lisieux T., citée par J. Chalon, in Thérèse de Lisieux. Une vie d’amour, Paris, Flammarion, 1997, p. 35.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les Non-dupes errent », leçon du 19 mars 1974, inédit.
[4] Cf. De Lisieux T., « Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face », Histoire d’une âme. Manuscrits autobiographiques, Paris, Éditions du Cerf, 2012, p. 70-71.
[5] Ibid., p. 219.
[6] De Lisieux T., « Offrande de moi-même comme victime d’holocauste à l’Amour miséricordieux du Bon Dieu », Œuvres complètes, Paris, Éditions du Cerf, 1992, p. 276-278.
[7] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 46.
[8] De Lisieux T., cité par J. Chalon, in Thérèse de Lisieux. Une vie d’amour, op. cit., p. 250.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 70.
[10] Campos A., Ce que commande le surmoi : impératifs et sacrifices au XXIe siècle, Rennes, PUR, 2022, p. 241.
[11] Cf. Miller J.-A., « Clinique du surmoi », Mental, n°50, p. 20.