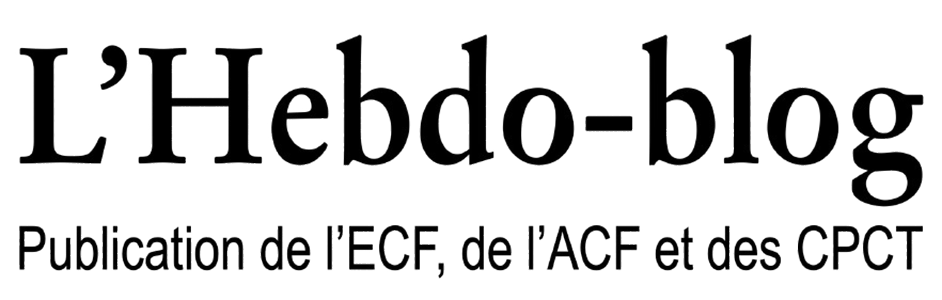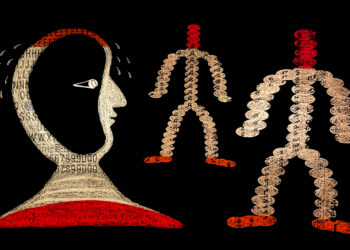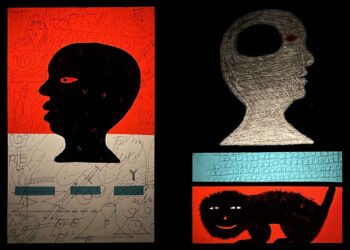Pourriez-vous expliciter ce choix de réactualiser le concept freudien de libido à partir de la pratique des institutions de la FIPA ? Et pourquoi avoir mis l’accent sur cette notion de déplacements, au pluriel ?
En effet, il pourrait sembler étonnant qu’une journée consacrée à la psychanalyse appliquée à des institutions, en prise sur la cité, gratuits – soit une formule tout à fait contemporaine d’application de la psychanalyse –, inscrive en son cœur ce concept qui fait le fondement de la théorie freudienne. D’autant que, pour Freud, la libido n’est pas signifiante mais énergétique. Ses mouvements de circulation, de flux, à la croisée entre le biologique et le psychique, dessinent « la représentation d’un quantum de libido » marquée par « la production, l’augmentation ou la diminution, la distribution et le déplacement »1.
Et c’est précisément à partir de cette circulation que peut se saisir qu’il n’y a pas un déplacement de la libido, mais qu’il s’agit de penser le terme pris dans une série d’arrêts, de fixations, d’investissements d’objets, puis de désinvestissements, et retour – le premier de ces mouvements donnant d’ailleurs lieu à la naissance du symptôme, lequel tente de se satisfaire malgré une interdiction, et « fait régresser la libido en deux temps, d’abord au fantasme, et, encore au-delà, à la fixation libidinale2 », comme le précise Jacques-Alain Miller.
Une telle invariabilité constitue le caractère extrêmement porteur pour notre pratique de cette notion de libido, à travers cette « force constante3 », ce quantum, quantité déterminée qui ne variera pas, et qui pourtant se condense, au fur et à mesure du traitement, se « densifie4 ». C’est cette fixité, au-delà de la mortification signifiante, qui poussa Lacan à élaborer le terme de jouissance, et son itération.
Sera-t-il question de l’actualité des symptômes lors de la Journée de la FIPA ?
Les sujets qui s’adressent à nous aujourd’hui sont pris dans des pratiques de fixation et d’envahissement d’une jouissance qui les épuise, les isole, en tête-à-tête avec les lathouses censées les complémenter, véritables prothèses qui fixent la libido. Pensons à la façon dont celles et ceux qui viennent consulter tentent de nommer de tels arrêts, qui vont parfois jusqu’à l’hémorragie libidinale, avec les étiquettes prêtes à porter de l’époque : « burn out » au travail, « phobie scolaire », « harcèlement » ou encore « hypersensibilité » pour les plus jeunes… La journée du 13 septembre donnera donc à entendre le plus contemporain de notre époque et de son impératif de jouissance, ainsi que la façon dont la rencontre avec un partenaire qui réponde offre la possibilité d’un nouveau mouvement et d’une autre façon de faire avec l’objet plus-de-jouir.
Sera-t-il aussi question de ce qui fait la spécificité de l’acte au sein des institutions de la FIPA ?
Les douze praticiens qui se risqueront à exposer et discuter de leur pratique savent à quel point l’acte analytique ne peut être qu’un acte sous transfert, et que le maniement de celui-ci, lorsque le temps est limité, ne va pas sans un certain maniement de la hâte, avec des effets de précipitation, de resserrage autour de nouvelles modalités de dire. Comment soustraire la jouissance d’une logorrhée, décompacter la force de frappe d’un signifiant injurieux, lorsque praticiens et patients savent qu’ils n’ont à leur disposition qu’une dizaine de séances et que le sujet ne les paie pas ? Comment s’immiscer entre l’enfant et l’objet auquel il est rivé, les rituels qui le ravagent ? Par quelle manœuvre faire revenir ce collégien qui ne voulait plus sortir de sa chambre sans que ce soient ses parents qui le conduisent ?
À Lille, nous entendrons comment travaillent au quotidien les praticiens engagés dans les institutions de la FIPA, la délicatesse avec laquelle ils ouvrent des espaces entre les signifiants, s’appuient sur la coupure ou encore le jeu avec la comptabilité du nombre de séances : autant de moyens d’amener le sujet à y mettre sa mise, avec les effets d’allégement et de relance libidinaux, nouvel « accord du signifiant et de la jouissance5 », qui se donnent à voir rapidement.
Quiconque s’intéresse à la façon dont on peut « défaire par la parole ce qui s’est fait par la parole6 », sous transfert, et pas seulement en institution, sera donc le bienvenu à la 6e Journée de la FIPA !
Virginie Leblanc-Roïc
[1] Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1987, p. 158.
[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 8 janvier 1997, inédit.
[3] Freud S., « Pulsion et destin des pulsions », Métapsychologie, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1968, p. 14.
[4] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Cause et consentement », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 24 février 1988, inédit.
[5] Miller J.-A., « Les affects dans l’expérience analytique », La Cause du désir, n°93, 2016, p. 110.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XXV, « Le moment de conclure », leçon du 15 novembre 1977, inédit.