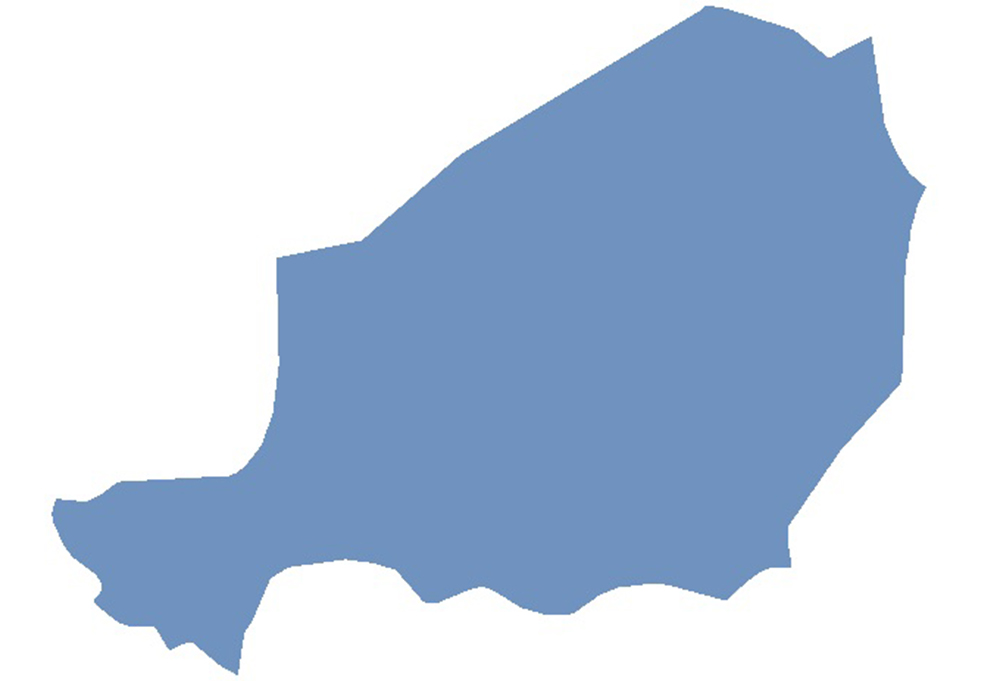Dans ce texte, Virginie Leblanc, membre du comité de pilotage des 45es Journées de L’École de la Cause freudienne passe au rayon laser l’une des plus célèbres scènes de rencontre amoureuse de la littérature française. La description de la cristallisation amoureuse y est renversante… mais rencontre-t-on vraiment le partenaire quand on est passionnément amoureux de l’amour ?
C’est un voyage somme toute assez banal qu’entreprend Frédéric ce jour de septembre pour rejoindre en bateau à vapeur sa demeure de Nogent-sur-Seine. Le jeune homme, tout juste bachelier, s’en retourne chez sa mère, avant d’entreprendre les études de droit qui doivent le lancer, selon les espérances maternelles, dans une grande et belle carrière parisienne, tandis que lui-même médite surtout au « plan d’un drame, à des sujets de tableaux, à des passions futures »[1]. À 18 ans à peine, lorsqu’on est un jeune homme sensible, et marqué par le romantisme de l’époque, un départ en bateau n’est-il pas en effet une occasion propice pour rêver, et se projeter mélancoliquement en soi-même ? « Il trouvait que le bonheur mérité par l’excellence de son âme tardait à venir. »[2]
Alors est-ce l’un des « rejetons » de la rêverie, ou une présence réelle, cette femme qui se tient là, devant lui, et qui surgit dans son champ de vision, au moment où il part en quête d’une place ?
« Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. […] Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent, derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu. […] Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu’elle avait portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas de limites. »[3] Éblouissement. Enlèvement. Ravissement. Extase. C’est bien une femme, un être de chair et d’os à la beauté enchanteresse que rencontre ce jour-là Frédéric. Mais c’est bien plus que cela encore : l’instant de la rencontre est un réveil, une ouverture à un au-delà, marqué par le sans-limites. Tous les éléments de la sacralisation sont en effet réunis dans cette description, et c’est comme si la pureté de l’air n’était qu’un écrin à la présence rayonnante, surnaturelle, et mystique, de celle qui ne peut se nommer que… Marie.
Si cette scène d’ouverture de L’éducation sentimentale publiée en 1869 par Gustave Flaubert est devenue un classique du genre, ou encore un topos du coup de foudre amoureux sur laquelle des générations de lycéens s’arrachèrent les cheveux, c’est sans doute que l’auteur parvient à y dessiner l’ineffable moment, à enserrer dans ce tableau de quelques lignes l’indescriptible de ces quelques secondes après lesquelles on n’est plus jamais le même, à l’image du destin de Frédéric, entièrement bouleversé par celle qui deviendra le grand amour de sa vie, Marie Arnoux, qu’il n’aura alors de cesse, une fois les quelques secondes abolies, que de rechercher. Son voyage en bateau est donc métamorphosé par les mots du romancier en une véritable initiation, traversée d’une rive à l’autre, de la forme inachevée du jeune homme au sortir de l’adolescence à l’entrevue d’un savoir supérieur, par le biais de cette femme comme de l’énigme qu’elle incarne.
Toutefois, si ces quelques pages ont traversé les siècles, c’est que l’instant de vérité qu’elles dévoilent révèle une profondeur inégalée. Car Flaubert, en dépeignant toute la scène à travers les yeux ébahis – et naïfs, d’un jeune homme si prompt aux grands sentiments, ne nous donne-t-il pas à voir aussi si justement la part d’idéalisation, et d’illusion, que contient la naissance du sentiment amoureux, avec une acuité aussi féroce que réjouissante ? Ce moment où sur la femme aimée, l’amoureux projette ses rêves de grandeur tout autant que de puissance (ou encore, son Idéal du moi, comme l’a montré Freud), Stendhal le nomma, et, partant, lui donna une postérité : il s’agit de la cristallisation, terme qui aura sa fortune littéraire au XIXe siècle, et qui naît d’une analogie avec un phénomène chimique, comme pour mieux évoquer le corps de l’amoureux transi. « Au moment où vous commencez à vous occuper d’une femme, vous ne la voyez plus telle qu’elle est réellement, mais telle qu’il vous convient qu’elle soit. Vous comparez les illusions favorables que produit ce commencement d’intérêt à ces jolis diamants qui cachent la branche de charmille effeuillée par l’hiver, et qui ne sont aperçus, remarquez-le bien, que par l’œil de ce jeune homme qui commence à aimer. »[4] Comment exprimer mieux la fonction de voile que l’amour naissant peut revêtir tout autant que la composante narcissique inhérente au sentiment qui éclot dans l’instant de la rencontre ? Cette « branche de charmille effeuillée par l’hiver », n’est-ce pas l’objet dénudé dans sa crudité et rendu agalmatique par le regard de l’aimant, pareil à ces « jolis diamants » ?
Mais là où les héros stendhaliens partaient à la conquête de cet objet aimé, se jetant à corps perdu dans la bataille en risquant d’écorner la beauté de l’être désiré, le monde de Flaubert est celui où la charmille est dévoilée, au même titre que tous les semblants, lien amical, engagement politique, carrière, qui font une vie humaine. Ainsi, la force ultime de ce passage qui décrit la rencontre entre Frédéric et Madame Arnoux, c’est qu’il contient en germe le roman tout entier, l’impossibilité du jeune homme, qui préfère ses rêves à la vie, à s’engager véritablement dans un lien, son inhibition face à toute entreprise tout autant que son refus de désacraliser la femme aimée. Il errera ainsi toute sa vie entre une échevelée avide d’argent et la Sainte Madame Arnoux, sans jamais parvenir à se trouver véritablement auprès d’aucune.
Lorsque le roman parut, en 1869, il connut un échec retentissant dont Flaubert peinera à se remettre, d’autant qu’il remaniait également, à travers ce portrait d’une génération qui arrive après les derniers feux du romantisme, sa rencontre véritable avec son grand amour platonique, Élisa Schlésinger, alors qu’il n’avait que 16 ans. Il est pourtant parvenu à donner corps, vie et profondeur, à ce qu’il en est de la naissance du désir comme de sa mortification, ouvrant la voie aux délices de l’interprétation.
[1] Flaubert G., L’éducation sentimentale, Gallimard, coll. Folio, 1972, p. 20.
[2] Ibid.
[3] Ibid., p. 22.
[4] Stendhal, De l’amour, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1980, p. 359.




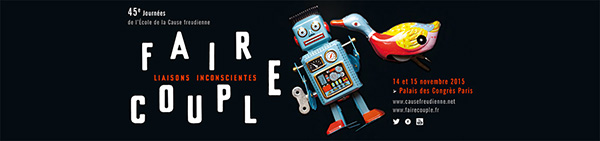

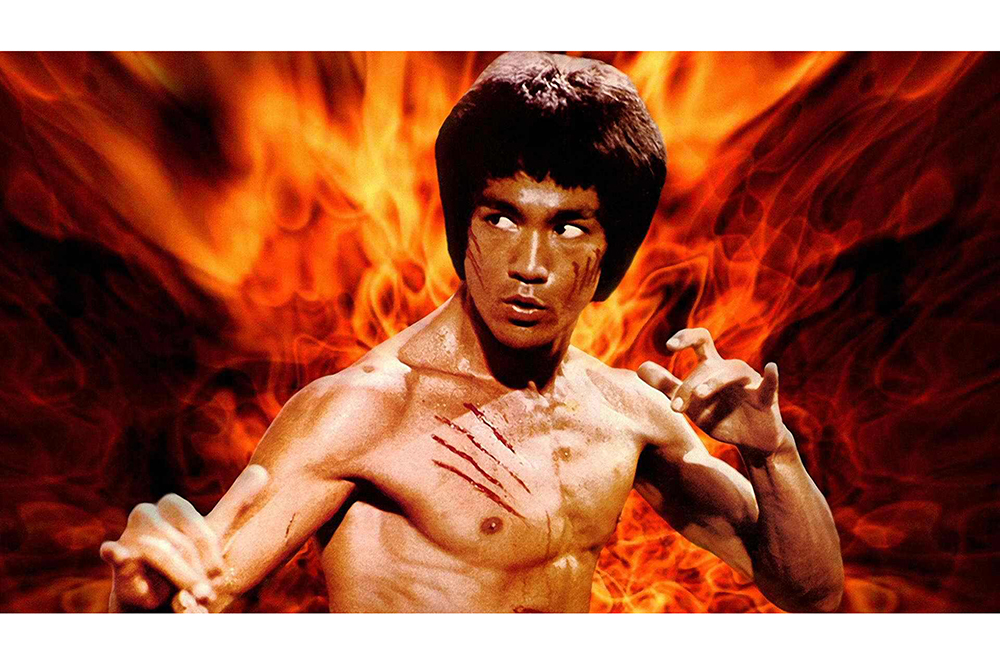

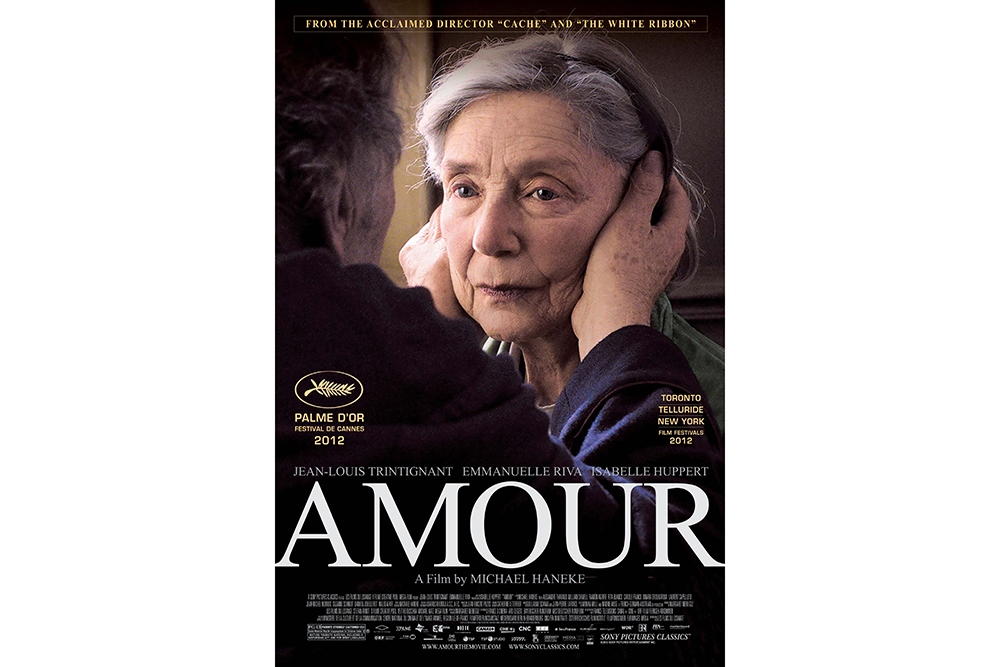
![Le corps pris au mot[1] Hélène Bonnaud répond aux questions de Marie-Christine Baillehache](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/09/BonnaudHD.jpg)