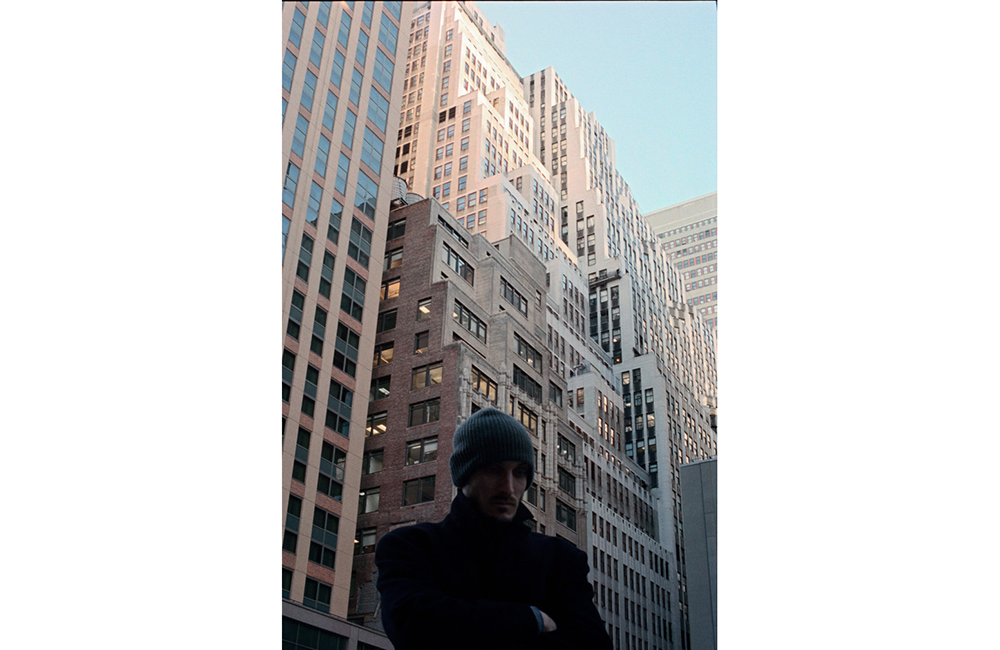Le corps, panneau-indicateur vers la conclusion de l’analyse
Le Séminaire des Échanges de l’ACF-ECA a choisi de réfléchir sur La fin d’analyse en invitant trois AE sur deux ans. Bernard Seynhaeve inaugure l’année 2015 avec des avancées sensationnelles sur la conclusion de l’analyse.
Bernard Seynhaeve a livré au public attentif de Nice ses avancées inédites pour conceptualiser la fin de l’analyse. Sous le titre « Une analyse avec le corps », il a accentué la dimension du réel du corps dans l’expérience et surtout en quoi elle ouvre sur la possibilité de conclure l’analyse.
L’enjeu de l’interprétation, a-t-il rappelé, est de permettre à l’analysant d’arracher des bouts de réel pour cerner la manière singulière dont il a incorporé les signifiants de son histoire. Il s’agit de retrouver trace de la percussion réelle du langage sur le corps, dont le sujet fait le premier signifiant de son histoire, le S1, qui lui a servi à recouvrir cette faille de sens, à l’infini.
B. Seynhaeve souligne que le S1 était présent dans les interprétations principales de son analyse, reçues « comme des gifles », c’est-à-dire accompagnées d’un événement de corps. De même, il retrouve chez la plupart des AE – qu’ils aient eu le souffle coupé ou aient été remués, secoués, taraudés – de telles interprétations déterminantes ayant fait trace sur le corps. En faisant coupure, elles isolent le sujet de son histoire, font chuter le pathos : le S1 ne représente plus rien. Lorsque le cadre du savoir tombe, le hors-cadre peut apparaître.
Pour B. Seynhaeve, il s’agissait de se séparer de l’injonction « si je meurs, occupe-toi d’L/elle » (« L » est son S1) prononcée à la génération de ses parents, et qui a eu un tel impact dans sa vie. « J’incarnais dans le réel ce ‘’L’’ proféré du lieu de l’Autre […] dont je m’emparai pour en faire le signifiant-maître qui présida à mon destin », a-t-il témoigné. Pour une autre AE, Hélène Bonnaud, conclure deviendra possible avec la découverte que la figure de cet Autre à tout instant prêt à la « jeter » (« jeter » est son S1) est corrélée à un sentiment indicible de vacillement, de chute. Elle sait maintenant qu’entrer dans le lien supposera toujours de s’arracher à ce sentiment. Chez Monique Kusnierek, les exigences de la pulsion orale (« croquez-moi ») ont construit un Autre érigé en bête féroce qui sera brusquement dégonflé lorsque, par une pantomime, l’analyste mime le monstre. Dans un rire salvateur, le cadre saute : l’Autre, devenu apparent, peut aussitôt déconsister.
Cependant, pour cerner cette dimension du réel du corps dans le transfert, il convient de ne pas oublier un deuxième versant : il concerne le corps de l’analyste. B. Seynhaeve a mis en évidence de manière très novatrice que l’interprétation décisive est celle qui vient nouer autant la langue et le corps de l’analyste que ceux de l’analysant. Il a été le premier surpris, en reprenant les témoignages récents d’AE, d’y trouver – constante restée pourtant inaperçue – de tels événements de corps chez l’analyste. Là où Lacan parle d’interprétation apophantique[1], notre invité a proposé de qualifier d’« interprétation-nœud » ces interprétations oraculaires dont l’impact sur le corps signale la valeur de vérité. Portant sur la cause du désir, leur support est le désir de l’analyste.
En d’autres termes, en cette zone où la jouissance indicible déloge le sujet de son énonciation, « Tout tient à l’événement, un événement qui doit être incarné, qui est un événement de corps – définition que Lacan donne du sinthome. Le reste, disons-le, c’est un habillage – un habillage qu’il faut, dans la plupart des cas. Mais Le noyau, le Kern au sens de Freud, le Kern de l’être, c’est cet instant, c’est l’instant de l’incarnation. »[2], estime Jacques-Alain Miller. En mettant son corps dans la balance, « l’analyste joue à incarner l’Autre appelé par le montage pulsionnel du sujet » et en fait valoir la valeur de jouissance, a résumé notre invité.
Ces avancées de B. Seynhaeve[3] sont affines au propos de J.-A. Miller pour qui les interprétations sont des créations de l’analysant, et à celui de Lacan pour qui « les psychanalystes font partie du concept de l’inconscient »[4].
Nous tenons une boussole solide en retenant que « l’interprétation-nœud » est le panneau indicateur qui indique à l’analysant la direction vers la conclusion de son analyse. Une telle interprétation décisive se reconnaît à ce qu’elle résonne dans le corps de l’analysant, produit un événement de corps, et engage aussi le corps de l’analyste.
[1] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 473.
[2] Miller J.-A., « L’inconscient et le sinthome », La Cause freudienne, Paris, Navarin, n° 71, juin 2009, p. 76.
[3] La conférence de B. Seynhaeve sera publiée dans RIVAGES, Bulletin de l’ACF-Estérel-Côte d’Azur, en octobre 2015.
[4] Lacan J., « Position de l’inconscient », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 834.