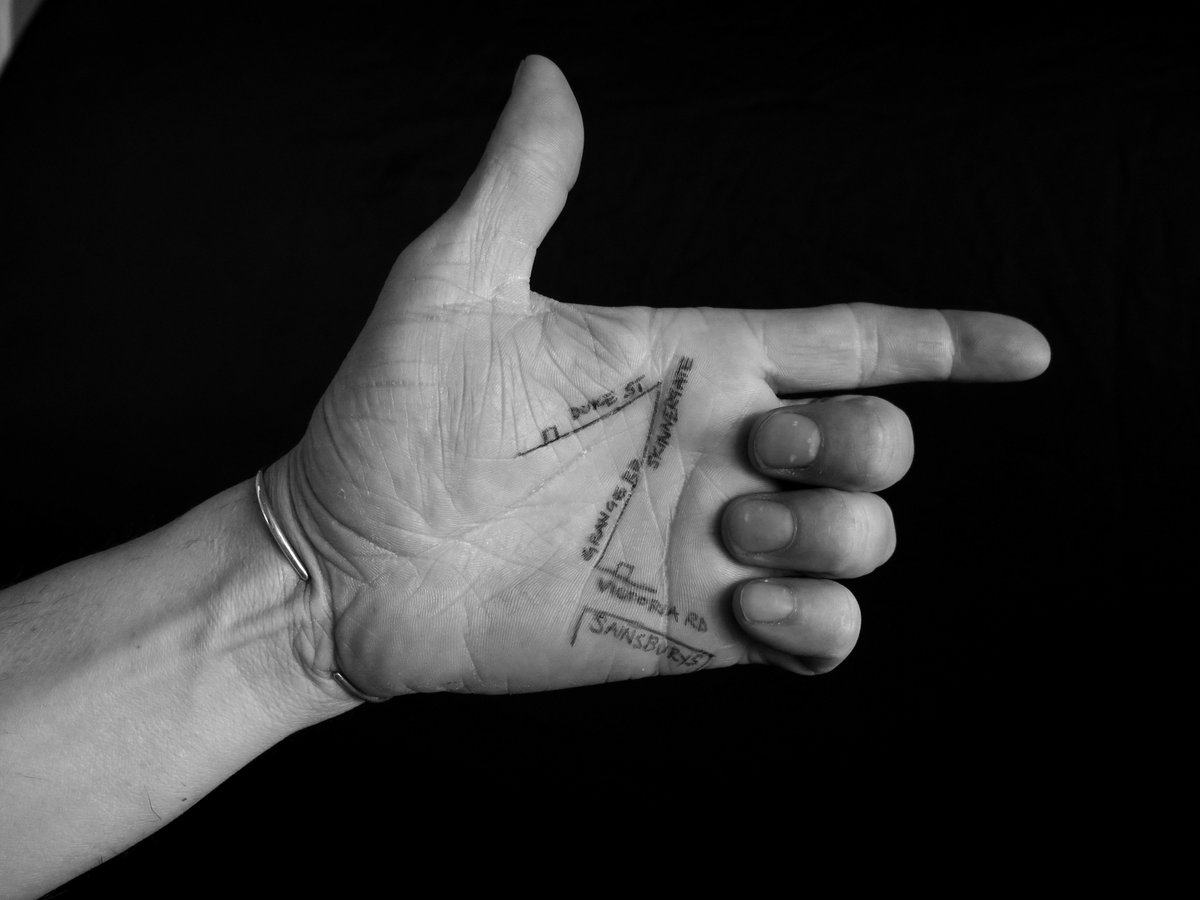La cause de l’autisme
Maintenir, un temps, cet espace où ni l’enfant ni ceux qui l’entourent ne tombent, le temps de trouver une petite solution pour que la voix du sujet se fasse entendre : telle est la cause de l’autisme que nous soutenons.
Lire la suite