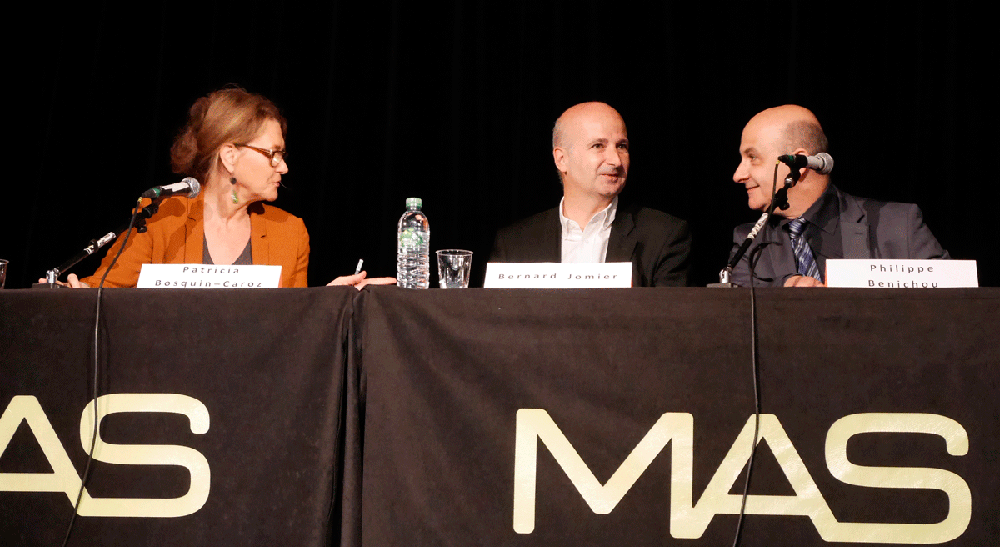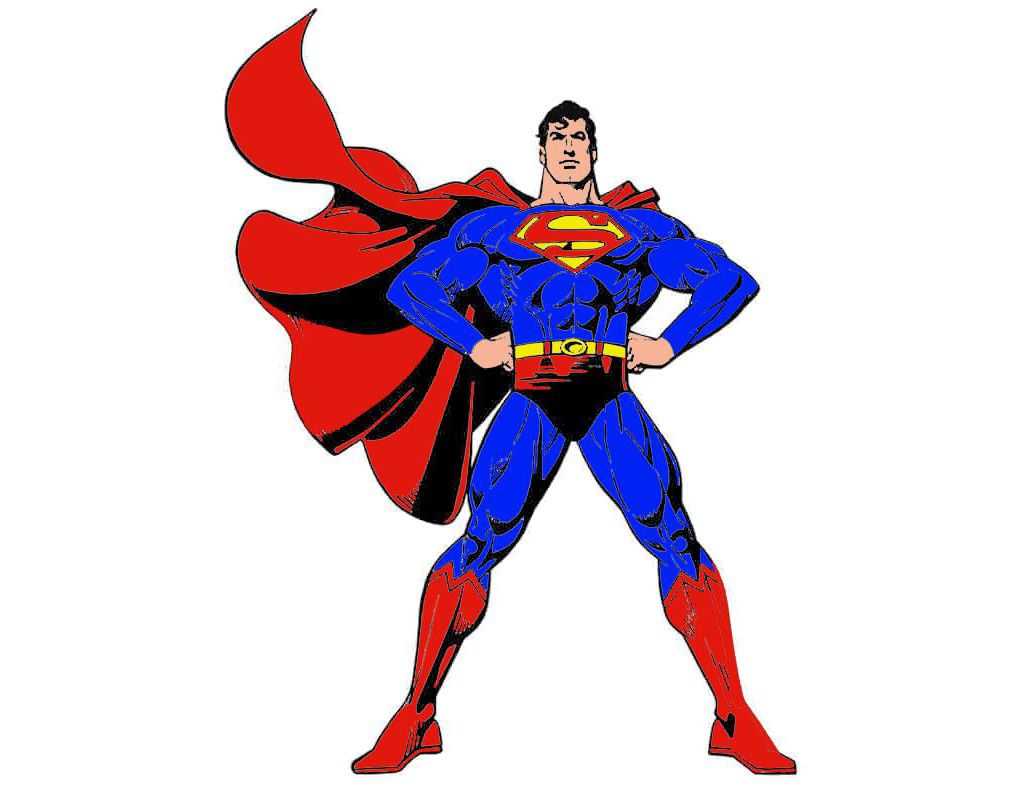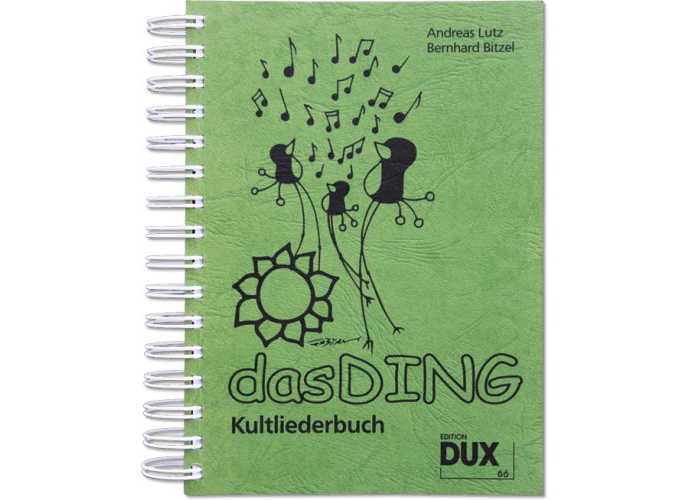« Le culte de Satie est difficile, parce qu’un des charmes de Satie,
c’est justement le peu de prise qu’il offre à la déification. »
Cocteau J. Le coq et l’arlequin – Notes autour de la musique.
Dans son introduction au prochain Congrès de l’AMP[1], Jacques-Alain Miller présentait le concept d’escabeau comme mode singulier de la sublimation « à son croisement avec le narcissisme », fondé sur le « je ne pense pas premier du parlêtre ».
Il soulignait que si Lacan s’était passionné pour l’auteur de Finnegans Wake, « c’est en raison du tour de force – ou de farce – que cela représente d’avoir su faire converger le symptôme et l’escabeau. Exactement, Joyce a fait du symptôme même, en tant que hors-sens, en tant qu’inintelligible, l’escabeau de son art ».
J.-A. Miller se demandait si la musique, la peinture, les Beaux-Arts avaient eu leur Joyce.
On sait combien la tumultueuse et iconoclaste avant-garde des Années Folles bouleversa les critères du jugement établis de l’esthétique. Mais sait-on suffisamment la place décisive qu’y occupa Erik Satie et ses compositions musicales en forme de « practical jokes » ?
« Je n’ai que faire du soleil » se plaisait à dire ce petit homme faunesque, excentrique et affable, qui n’a cessé de diviser les milieux musicaux, accusé par certains de destruction pure et simple de l’âme musicale, cette âme marquée par le symbolisme wagnérien de la fin du XIXe siècle.
Dans un éloge posthume, André Breton écrivait : « Le passage du XIXème au XXème siècle n’a déterminé aucune évolution d’esprit aussi captivante que celle de Satie. Nulle plus haute école de liberté à l’égard de toutes les conventions, nul sourire plus espiègle et, en fin de compte, si poignant par-dessus le gouffre intérieur, de l’espèce la plus noire, duquel s’échappe la nuée de ces dessins et inscriptions calligraphiées en pleine solitude. »[2]
Comment présenter l’œuvre de l’auteur des fameuses Gymnopédies ? Le compositeur Henri Sauguet écrivait : « Satie fut et doit demeurer inexplicable [… ] La musique, l’art de Satie sont inanalysables »[3].
Satie déclarait lui-même que tout ce qu’il composait ne signifiait rien, et aux tenants trop sérieux des conformismes académiques qui ne l’aimaient pas, il affirmait : « le Chaos est assez comique de lui-même »[4].
Marcel Proust, autre dandy de l’époque, disait à propos de la musique d’Erik Satie qu’elle ne pouvait faire que « rire ou crier », soulignant par ce trait le pied de nez du compositeur aux valeurs de bon goût bourgeois où se reconnaissait la communauté des mélomanes.
L’art d’Erik Satie se caractérise par une extrême économie de moyens dans ses créations, et une liberté de choix qui ignore toute barrière académique, allant jusqu’à inclure des numéros de music-hall dans ses concerts. « Le Music Hall, le Cirque, disait-il, ont l’esprit novateur »[5]. Parmi ses œuvres les plus connues, ses pièces pour piano déterminent des directions neuves, imprévues, élaguant, jetant du leste, supprimant tout superflu, refusant toute dramaturgie, réduisant au maximum la durée des périodes : l’air y circule à l’instar des haïkus japonais, léger et vif.
Il résulte de cette musique une magie sonore, un flux d’incessantes et poétiques cocasseries musicales, émergeant de la rigueur de rythmes neufs qui dessinent une structure nette à chacune de ses pièces. Debussy et Ravel s’inspireront de cette grammaire musicale novatrice, aux imprévisibles et troublantes résolutions harmoniques.
Le burlesque musical d’Erik Satie trouvera sur son chemin des compagnons d’art avides de tendances nouvelles dans leurs créations : Dada, Cocteau, Duchamp, Picabia, Diaghilev, avec qui il « paradait »[6] dans des créations scéniques ébouriffantes, ou encore Debussy et Ravel… lequel n’hésita pas à baptiser Satie de « précurseur de la musique moderne »[7].
La formule fâcha durablement Satie qui lisait dans les honneurs un embaumement avant l’heure. Satie ne pardonnera pas plus à Ravel son refus réitéré de la Légion d’honneur, un leurre à ses yeux, « quand toute sa musique l’accepte »[8].
Satie tenait bon sur le « sans pourquoi » de son art, hermétique à toute possibilité de l’interpréter. C’est d’ailleurs un paradoxe pour les interprètes de sa musique, comme le dit le pianiste Alexandre Tharaud : « Savoir se défaire d’un jeu classique, de l’envie de créer un discours, de donner un sens, de chercher le « beau son », et de marquer de son empreinte la partition. Ces considérations n’ont pas de prise sur Satie, elles font même très mauvais ménage avec son œuvre »[9].
Si le maniement ex-centrique de la lettre musicale chez Satie débarrassa l’esthétique éthérée et chargée de symboles du wagnérisme de l’époque, il tourna tout autant le dos aux diktats d’un nouvel ordre musical, le dodécaphonisme importé en France de la même Allemagne.
Par l’atmosphère sonore inédite de ses micro-compositions, « constructions en mosaïque » en perpétuel déplacement, Satie le gymnopédiste se hisse sur l’escabeau de son art avec ce seul fil phonique, faunesque, pur S1, « d’une pauvre pensée » comme il se plaisait à le souligner… soutenant son nom propre de ce travail au pied de la lettre, il s’auto-nomma « Satie, le pauvre » dans une totale identification à ses créations.
Brouillé avec la lâcheté, il se fâcha tour à tour avec ceux de ses amis qui renoncèrent dans leurs parcours artistiques à partager cette même longueur d’ondes dans leurs créations.
À ceux qui l’accusaient de n’écrire pas de la musique, Satie va ironiquement donner raison : « Ne croyez pas que mon œuvre soit de la musique, ce n’est pas mon genre : je fais, le mieux que je peux, de la phonométrie. Point autre chose. [...] Du reste, j’ai plus de plaisir à mesurer un son que je n’en ai à l’entendre. Le phonomètre à la main, je travaille joyeusement et sûrement [...] L’avenir est donc à la philophonie »[10].
Dans l’abondante correspondance adressée à ses amis et plus encore à lui-même, on retrouve un même maniement witzien de la lettre, imperméable au sens. La langue y est du pur style « Sati’ Erik », truffée de jeux de mots, équivoques, néologismes, mélange de grossièreté et de délicatesse, parfois même d’injures, tracées dans de sublimes arabesques.
Entouré de ses fidèles amis, Picasso, Picabia, Milhaud, Brancusi et Duchamp qui se relaient à son chevet, Satie rend l’âme à l’hôpital Saint-Joseph à Paris.
« La lettre… mais où est donc la lettre ? » aurait-il gémi en se débattant sur son lit de mort, renversant ses couvertures pour mettre la main sur ce mystérieux courrier. « C’était là son dernier tour de clé, verrouillant à jamais toute communication »[11], rapporte le musicologue Louis Laloy.
À l’heure venue de son dernier souffle, alors qu’il reçoit la visite de l’Abbé Saint, Satie s’exclame dans un ultime tour de farce : « Je suis heureux de voir enfin un saint de mes yeux. »[12]
Il nous reste la saveur insolite de cette œuvre gymnopédiste, sur laquelle John Cage et Merce Cunningham dans les années 1970 ont trouvé un appui sans pareille pour créer des chorégraphies nouvelles, donnant aux corps d’insoupçonnables façons de se tenir et de se mouvoir.

[1] Miller J.-A., Présentation du thème du X
e congrès de l’AMP à Rio de Janeiro en 2016. Site AMP.
[2] Transcription d’un manuscrit autographe d’André Breton de 1955. Archives Erik Satie de l’IMEC
in Erik Satie Les cahiers d’un mamifère. Chroniques et articles publiés entre 1895 et 1924. Texte établi par S. Arfouilloux. Paris, l’Escalier, 2010, préface.
[3] Olivier PH.,
Aimer Satie, Langres, Hermann, 2005, p.110.
[4] Satie E.,
Correspondance, réunie et présentée par O. Volta, Paris, Fayard/IMEC, 2000, p. 609.
[5] Volta O.
Erik Satie, Paris, Hazan, 1997, p. 69.
[6] Allusion à
Parade, ballet en acte composé par Erik Satie, poème de Jean Cocteau, costumes et rideau de scène Pablo Picasso.
[7] Ibid., p. 30.
[8] Olivier P.,
op. cit., p.1.
[9] Tharaud A., CD
Erik Satie, Avant dernières pensées, Arles, Harmonia mundi, 2009.
[10] Satie E.,
Mémoires d’un amnésique, Revue musicale S.I.M. n°4
, 15 avril 1912, p .69.
[11] Volta O.,
Erik Satie. Correspondance,
op. cit., p. 8.
[12] Ibid., p. 642.
Enregistrer
Lire la suite